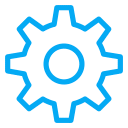Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 23 July 2025.
Bloom v European Commission.
• 62023TJ1049 • ECLI:EU:T:2025:754
- Inbound citations: 0
- •
- Cited paragraphs: 0
- •
- Outbound citations: 33
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre élargie)
23 juillet 2025 ( * )
« Politique commune de la pêche – Résolution de la CTOI relative à la gestion des dispositifs de concentration de poissons – Objection de la Commission – Rejet de la demande de réexamen interne – Article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 – Acte susceptible de faire l’objet d’une demande de réexamen interne – Notion de “dispositions qui peuvent aller à l’encontre du droit de l’environnement” – Article 2, paragraphe 1, sous f), du règlement no 1367/2006 »
Dans l’affaire T‑1049/23,
Bloom, établie à Paris (France), représentée par M e F. Lafforgue, avocat,
partie requérante,
soutenue par
Blue Marine Foundation, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M es P. de Bandt et C. Binet, avocats,
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. A. Dawes, B. Hofstötter et M me D. Milanowska, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Royaume d’Espagne, représenté par M mes A. Pérez-Zurita Gutiérrez et A. Gavela Llopis, en qualité d’agents,
et par
République française, représentée par MM. B. Fodda, M. de Lisi, M mes B. Travard et P. Chansou, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (septième chambre élargie),
composé de M me K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, MM. E. Buttigieg, G. Hesse (rapporteur), I. Dimitrakopoulos et M me B. Ricziová, juges,
greffier : M me P. Nuñez Ruiz, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 13 février 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Bloom, demande l’annulation de la décision de la Commission européenne du 30 août 2023 rejetant comme irrecevable sa demande de réexamen interne du 11 mai 2023 concernant la décision de la Commission portant objection à la résolution n o 23/02 de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) relative à la gestion des dispositifs de concentration de poissons (ci-après les « DCP ») au sein de la zone de compétence (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 La requérante est une organisation non gouvernementale (ONG) qui a vocation à contribuer à la préservation de la biodiversité marine et des habitats marins.
3 La CTOI est une organisation internationale ayant vocation à préserver les ressources de thon dans l’océan Indien dont l’Union européenne est partie contractante en vertu de la décision 95/399/CE du Conseil, du 18 septembre 1995, relative à l’adhésion de la Communauté à l’accord portant création de la [CTOI] (JO 1995, L 236, p. 24).
4 En vertu de l’article IX, paragraphe 1, de l’accord portant création de la [CTOI] (JO 1995, L 236, p. 25), celle-ci « peut adopter, à la majorité des deux tiers de ces membres [...] des mesures de conservation et d’aménagement ayant force obligatoire pour les membres de la [CTOI] ».
5 L’article IX, paragraphe 5, de l’accord portant création de la [CTOI] prévoit :
« Tout membre de la [CTOI] peut, dans les 120 jours suivant la date indiquée ou dans le délai qu’aura fixé la [CTOI] [...], présenter une objection à une mesure de conservation et d’aménagement adoptée en vertu du paragraphe 1. Un membre de la [CTOI] qui a fait objection à une mesure n’est pas tenu de l’appliquer. Tout autre membre de la [CTOI] peut présenter également une objection dans un délai supplémentaire de 60 jours à compter de l’expiration du délai de 120 jours [...] »
6 L’article IX, paragraphe 6, de dit l’accord portant création de la [CTOI] est ainsi libellé :
« Si des objections à une mesure adoptée en vertu du paragraphe 1 sont présentées par plus du tiers des membres de la [CTOI], les autres membres ne sont pas liés par cette mesure ; cela n’empêche pas tous ces membres, ou certains d’entre eux, de convenir d’y donner effet. »
7 La décision (UE) 2019/860 du Conseil, du 14 mai 2019, relative à la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la [CTOI] et abrogeant la décision du 19 mai 2014 concernant la position à adopter, au nom de l’Union, au sein de la CTOI (JO 2019, L 140, p. 33), définit la position à adopter par l’Union au sein de la CTOI pour la période 2019-2023. L’annexe I de la décision 2019/860 contient des « principes » et des « orientations ». En application du point 2, sous f), de cette annexe, l’Union s’efforce, le cas échéant, de soutenir l’adoption par la CTOI de mesures visant à gérer l’utilisation des DCP, notamment afin d’améliorer la collecte de données, de quantifier avec précision, de suivre et de surveiller l’utilisation des DCP, de réduire leur incidence sur les stocks de thon vulnérables et d’atténuer leurs effets potentiels sur les espèces ciblées et non ciblées ainsi que sur l’écosystème.
8 L’annexe II de la décision 2019/860 définit la procédure appliquée pour établir chaque année la position de l’Union et prévoit que :
« Avant chaque réunion de la CTOI, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques sur l’Union, les dispositions requises sont prises pour que la position qui sera exprimée au nom de l’Union prenne en considération les données scientifiques et autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission, conformément aux principes et orientations figurant à l’annexe I.
À cet effet, et sur la base des informations en question, la Commission transmet au Conseil, suffisamment longtemps avant chaque réunion de la CTOI, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l’Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l’Union.
Si, au cours d’une réunion de la CTOI, il est impossible, y compris sur place, de parvenir à un accord pour que la position de l’Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires. »
9 Lors de sa sixième session extraordinaire, qui s’est tenue du 3 au 5 février 2023, la CTOI a adopté la résolution n o 23/02 relative à la gestion des DCP. Les DCP sont des systèmes flottants artificiels permettant d’attirer les poissons afin de faciliter la pêche. Ladite résolution prévoyait notamment une réduction progressive du nombre de DCP dérivants autorisés par navire, la création d’un registre des DCP dérivants afin d’accroitre la transparence et le suivi de ces dispositifs et une interdiction des DCP dérivants dans l’océan Indien pendant 72 jours tous les ans.
10 Selon le deuxième considérant de la résolution n o 23/02, les articles 5 et 6 de l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO 1998, L 189, p. 17), requièrent des États qu’ils appliquent largement le principe de précaution à la conservation, à la gestion et à l’exploitation des stocks de poissons grands migrateurs afin de protéger les ressources marines vivantes et de préserver le milieu marin.
11 Selon le troisième considérant de la résolution n o 23/02, dans le cadre de l’application du principe de précaution, l’article 6 de l’accord mentionné au point 10 ci-dessus exige des États qu’ils soient plus prudents lorsque les informations sont incertaines, peu fiables ou inadéquates et interdit d’invoquer l’absence d’informations scientifiques adéquates pour remettre à plus tard ou ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion.
12 Le 11 avril 2023, la Commission a présenté, au nom de l’Union, une objection au sens de l’article IX, paragraphe 5, de l’accord portant création de la [CTOI] contre la résolution n o 23/02 (ci-après : l’« objection litigieuse ») (voir point 5 ci-dessus). Elle indique dans la lettre explicative, en substance, que la mise en œuvre de ladite résolution représente une charge disproportionnée pour les flottes de senneurs à senne coulissante, voire que cette mise en œuvre est pratiquement impossible. En outre, les mesures figurant dans cette résolution ne seraient pas appuyées par des preuves scientifiques.
13 Dix autres membres de la CTOI ont présenté des objections contre la résolution n o 23/02 dans les délais prévus par l’article IX, paragraphe 5, de l’accord portant création de la [CTOI]. Partant, cette résolution n’est pas devenue contraignante en vertu du paragraphe 6 du même article (voir points 5 et 6 ci-dessus).
14 Le 11 mai 2023, la requérante a introduit auprès de la Commission une demande de réexamen interne de l’objection litigieuse en application de l’article 10 du règlement (CE) n o 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de l’Union des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13), tel que modifié par le règlement (UE) 2021/1767 du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2021 (JO 2021, L 356, p. 1) (ci-après le « règlement Aarhus »).
15 Par la décision attaquée, la Commission a rejeté la demande de réexamen présentée par la requérante comme étant irrecevable, au motif que l’objection litigieuse n’était pas un « acte administratif » au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement Aarhus, dans la mesure où cette objection ne contenait aucune disposition susceptible d’aller à l’encontre du droit de l’environnement tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, sous f), dudit règlement. La présentation de l’objection litigieuse à l’adoption de nouvelles règles au sein de la CTOI n’entraînerait aucun effet négatif sur les objectifs de la politique environnementale de l’Union.
Conclusions des parties
16 La requérante, soutenue par Blue Marine Foundation, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
17 La Commission, soutenue par le Royaume d’Espagne et la République française, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
18 À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré, en substance, de la violation de l’article 2, paragraphe 1, sous f), du règlement Aarhus. Le deuxième moyen est tiré de la violation du principe de précaution. Le troisième moyen est tiré de la violation du règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006 (JO 2009, L 343, p. 1).
19 Par le premier moyen, la requérante, soutenue par Blue Marine Foundation, soutient, en substance, que la Commission a eu tort de rejeter comme irrecevable sa demande de réexamen de l’objection litigieuse au motif que cette dernière ne comportait pas de « dispositions qui [pouvaient] aller à l’encontre du droit de l’environnement » au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement Aarhus. En effet, l’objection litigieuse violerait, d’une part, le principe de précaution et, d’autre part, le règlement n o 1224/2009. De telles violations constitueraient bien des violations du droit de l’environnement de l’Union, indépendamment de la mise en œuvre de la résolution n o 23/02 dans l’ordre juridique de l’Union.
20 La Commission, soutenue par le Royaume d’Espagne et la République française, conteste l’argumentation de la requérante. Elle soutient, d’abord, que le premier moyen est irrecevable étant donné qu’il renvoie de manière générale à la demande de réexamen. Il ne comporterait donc pas les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels il est fondé. À titre subsidiaire, elle argue que le premier moyen n’est pas fondé. En effet, la requérante n’aurait pas démontré de quelle manière l’objection litigieuse pourrait avoir un effet négatif sur la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière d’environnement énoncés à l’article 191 TFUE.
21 La Commission souligne, à cet égard, que la décision de présenter une objection à l’adoption de nouvelles règles de la CTOI, tout en continuant à respecter le cadre juridique existant de l’Union, ne peut pas entraîner d’effets négatifs sur les objectifs de la politique environnementale de l’Union et n’est donc pas, en tant que telle, susceptible d’enfreindre le droit de l’environnement au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous f), du règlement Aarhus.
Sur la recevabilité du premier moyen
22 S’agissant de la recevabilité du premier moyen, la Commission considère, sans motivation particulière, que la requérante se borne à réitérer les motifs de sa demande de réexamen interne.
23 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens et que cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle, le cas échéant, sans autre information à l’appui (arrêt du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission, T‑194/13, EU:T:2017:144, point 191).
24 Il y a également lieu de rappeler qu’il est notamment nécessaire, pour qu’un recours devant le Tribunal soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. S’il est vrai que le corps de celle-ci peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête (voir arrêt du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission, T‑194/13, EU:T:2017:144, point 192 et jurisprudence citée).
25 En l’espèce, à la lecture des points 48 à 51 de la requête, relatifs au premier moyen, ainsi que des points 42 à 47 de celle-ci, relatifs à la notion de « dispositions qui peuvent aller à l’encontre du droit de l’environnement », force est de constater que les éléments de fait et de droit sur lesquels la requérante fonde son argumentation, telle que résumée au point 19 ci-dessus, sont immédiatement compréhensibles au vu du texte de la requête elle-même, et ce quand bien même la requérante renvoie à sa demande de réexamen interne et à ses deuxième et troisième moyens pour démontrer que l’objection litigieuse viole le principe de précaution ainsi que le règlement n o 1224/2009.
26 Il résulte des considérations qui précèdent que, contrairement à ce que soutient la Commission, le premier moyen est recevable au regard des exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
Sur le bien-fondé du premier moyen
27 En vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement Aarhus, toute ONG ou d’autres membres du public satisfaisant aux critères énoncés à l’article 11 de ce règlement sont habilités à introduire une demande de réexamen interne auprès de l’institution ou de l’organe de l’Union qui a adopté l’acte administratif ou, en cas d’allégation d’omission administrative, qui était censé avoir adopté un tel acte, au motif que ledit acte ou ladite omission va à l’encontre du droit de l’environnement au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous f), dudit règlement. Cette demande doit être formulée par écrit et doit être introduite dans un délai n’excédant pas huit semaines à compter de la date à laquelle l’acte administratif a été adopté, notifié ou publié, la plus récente de ces dates étant retenue, ou, en cas d’allégation d’omission administrative, huit semaines à compter de la date à laquelle l’acte administratif était censé avoir été adopté. Ladite demande précise les motifs de réexamen.
28 L’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement Aarhus définit la notion d’« acte administratif », aux fins dudit règlement, comme « tout acte non législatif adopté par une institution ou un organe de l’Union, ayant un effet juridique et extérieur et contenant des dispositions qui peuvent aller à l’encontre du droit de l’environnement au sens de l’article 2, paragraphe 1, [sous] f) ».
29 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous f), du règlement Aarhus, la notion de « droit de l’environnement » correspond à « toute disposition législative de l’Union qui, indépendamment de sa base juridique, contribue à la poursuite des objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement tels que prévus par le [traité] : la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de la santé des personnes, l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement ».
30 Dans ces conditions, la recevabilité d’une demande de réexamen interne est effectivement subordonnée à l’existence d’un acte administratif ou d’une omission administrative susceptible d’aller à l’encontre du droit de l’environnement au sens du règlement Aarhus (ordonnance du 6 juin 2024, Asociația pentru Energie Curată și Combaterea Schimbărilor Climatice/Conseil, T‑1151/23, non publiée, EU:T:2024:391, point 12).
31 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante et de déterminer si la Commission pouvait rejeter comme irrecevable la demande de réexamen de l’objection litigieuse au motif que cette dernière ne comportait pas de « dispositions qui [pouvaient] aller à l’encontre du droit de l’environnement » au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement Aarhus.
32 En l’espèce, dans la décision attaquée, la Commission fait valoir qu’elle s’était bornée à présenter une objection conformément à l’article IX, paragraphe 5, de l’accord portant création de la [CTOI]. Cette action aurait eu pour conséquence que la résolution n o 23/02 ne lierait pas l’Union, de sorte que celle-ci n’était pas tenue de mettre en œuvre cette résolution dans son ordre juridique.
33 Ainsi, selon la Commission, « la présentation d’une objection à l’adoption de nouvelles règles, tout en continuant à respecter le cadre juridique existant de l’Union, y compris le droit de l’Union en matière d’environnement, n’entraîn[ait] pas d’effets négatifs sur les objectifs de la politique environnementale de l’Union et [ne serait], en tant que telle, pas susceptible d’enfreindre le droit de l’environnement au sens de l’article 2, paragraphe 1, [sous] f), du règlement Aarhus » (point 2.1 de la décision attaquée).
34 Il importe de relever, d’emblée, que la Commission n’a pas rejeté la demande de réexamen comme non fondée, au motif que l’objection litigieuse n’irait pas à l’encontre du droit de l’environnement, mais comme « irrecevable », au motif que cette objection ne contenait aucune « disposition pouvant aller à l’encontre du droit de l’environnement » au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous f), du règlement Aarhus et que, par suite, elle ne constituait pas un « acte administratif » au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du même règlement.
35 À cet égard, il convient de relever que les actes administratifs pouvant faire l’objet d’une demande de réexamen interne au titre de l’article 10 du règlement Aarhus sont, conformément à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de ce règlement, les actes non législatifs adoptés par une institution ou un organe de l’Union ayant un effet juridique et extérieur et contenant des dispositions qui peuvent aller à l’encontre du droit de l’environnement au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous f) du même règlement.
36 En l’espèce, la Commission a considéré la demande de réexamen introduite par la requérante comme irrecevable au seul motif que celle-ci ne concernait pas un acte contenant des dispositions qui pouvaient aller à l’encontre du droit de l’environnement. Il convient donc de relever que la Commission n’a pas rejeté la demande de réexamen interne comme étant irrecevable en raison du fait que d’autres conditions visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement Aarhus, à l’égard de telles demandes, ou ressortant de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement Aarhus, en ce qui concerne la notion d’« acte administratif », ne seraient pas remplies en l’espèce.
37 S’agissant de la question de savoir si la demande de réexamen en cause concernait un acte pouvant aller à l’encontre du droit de l’environnement de l’Union, il y a lieu de rappeler que, selon le considérant 10 du règlement 2021/1767, lorsqu’on évalue si un acte administratif contient des dispositions qui pourraient, en raison de leurs effets, aller à l’encontre du droit de l’environnement, il est nécessaire d’examiner si ces dispositions pourraient avoir un effet négatif sur la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière d’environnement énoncés à l’article 191 TFUE, qui comprennent l’« utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles » et la « promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement ».
38 Dans sa demande de réexamen, la requérante, soutenue, déjà pendant cette phase administrative, par Blue Marine Foundation, fait valoir que l’objection litigieuse était susceptible d’aller à l’encontre du principe de précaution consacré à l’article 191 TFUE. En outre, plus spécifiquement, l’objection litigieuse violerait l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 1954/2003 et n o 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n o 2371/2002 et (CE) n o 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO 2013, L 354, p. 22), qui définit les objectifs de la politique commune de la pêche (PCP), notamment, que « la PCP applique l’approche de précaution en matière de gestion des pêches et vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable ».
39 Selon la requérante, l’objection litigieuse était également incompatible avec le règlement n o 1224/2009 portant sur le contrôle relatif à la PCP. La requérante souligne, à cet égard, que l’article 14, paragraphe 3, de ce règlement prévoit que « [l]a tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de bord des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 10 % pour toutes les espèces ». Selon la requérante, l’utilisation massive des DCP par les flottes françaises et espagnoles dans l’océan Indien pour pêcher des thons contribue au dépassement des estimations en ce sens.
40 Il en ressort que les motifs de réexamen que la requérante a présentés dans sa demande de réexamen portent sur des violations potentielles de dispositions concrètes du droit de l’environnement, consacrant notamment le principe de précaution dans le domaine de la PCP.
41 À cet égard, force est de relever que, ainsi qu’il ressort, notamment, des points 10 et 11 ci-dessus, les deuxième et troisième considérants de la résolution n o 23/02 mentionnent comme objectif la conservation des stocks halieutiques.
42 Ainsi, en présentant l’objection litigieuse, l’Union s’est activement opposée à l’adoption de mesures visant une protection accrue de certains stocks halieutiques. Plus spécifiquement, ladite objection a eu pour effet que l’Union n’était pas tenue d’établir et de mettre en œuvre, dans son ordre juridique, les mesures prévues par la résolution n o 23/02.
43 Par conséquent, contrairement à ce qu’a relevé la Commission dans la décision attaquée et alors même que l’objection litigieuse n’a entraîné aucune modification de l’état du droit de l’environnement de l’Union, cette dernière était susceptible de produire des effets négatifs sur la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière d’environnement énoncés à l’article 191 TFUE.
44 Dans ce contexte, il convient de relever qu’il ressort du considérant 11 du règlement Aarhus que même une omission peut faire l’objet d’une demande de réexamen alors que, par définition, en présence d’une telle omission, il n’existe aucune modification du droit de l’environnement de l’Union.
45 Dans ces conditions, c’est à tort que la Commission a rejeté comme étant irrecevable la demande de réexamen de la requérante au motif indiqué dans la décision attaquée sans examiner au fond si les motifs de réexamen avancés par la requérante étaient susceptibles de fonder des doutes plausibles, à savoir substantiels, quant à l’appréciation du droit de l’environnement par l’institution ou l’organe de l’Union lors de la présentation de l’objection litigieuse (voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2019, TestBioTech e.a./Commission, C‑82/17 P, EU:C:2019:719, point 69, et du 6 octobre 2021, ClientEarth/Commission, C‑458/19 P, EU:C:2021:802, point 60).
46 En conséquence, il y a lieu d’accueillir le premier moyen du recours et d’annuler la décision attaquée sans qu’il soit besoin d’examiner les deuxième et troisième moyens.
Sur les dépens
47 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il convient de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.
48 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Le Royaume d’Espagne et la République française supporteront donc leurs propres dépens.
49 En vertu de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider qu’un intervenant autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de cet article supportera ses propres dépens. Blue Marine Foundation, intervenue au soutien des conclusions de la requérante, supportera ses propres dépens, étant donné qu’elle n’a pas demandé la condamnation de la Commission aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) La décision de la Commission européenne, communiquée à Bloom par lettre du 30 août 2023, portant la référence Ares (2023) 5917994, et rejetant comme irrecevable sa demande de réexamen interne de la lettre de la Commission portant objection à la résolution n o 23/02 relative à la gestion des dispositifs de concentration de poissons au sein de la zone de compétence de la Commission des thons de l’océan Indien est annulée.
2) La Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux de Bloom.
3) Le Royaume d’Espagne, la République française et Blue Marine Foundation supporteront leurs propres dépens.
Kowalik-Bańczyk
Buttigieg
Hesse
Dimitrakopoulos
Ricziová
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 juillet 2025.
Le greffier
Le président
V. Di Bucci
L. Truchot
* Langue de procédure : le français.
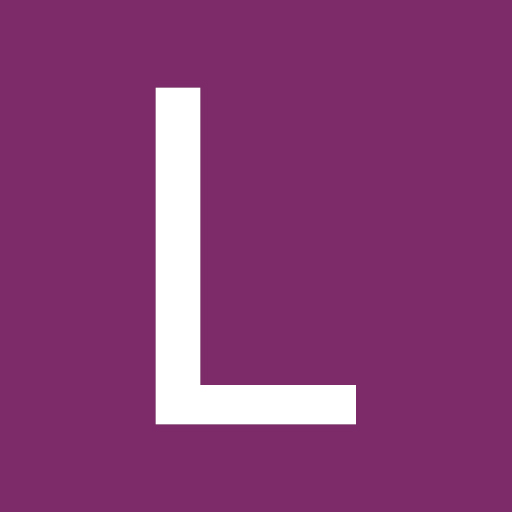
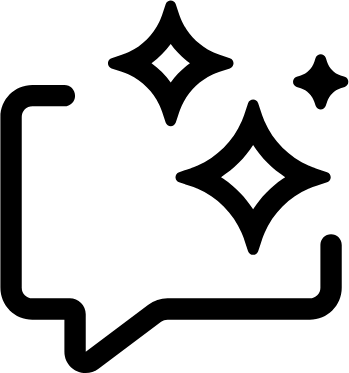 LEXI - AI Legal Assistant
LEXI - AI Legal Assistant