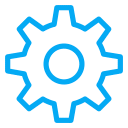Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 16 July 2025.
Victor Petrov v Council of the European Union.
• 62024TJ0344 • ECLI:EU:T:2025:727
- Inbound citations: 0
- •
- Cited paragraphs: 0
- •
- Outbound citations: 26
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
16 juillet 2025 ( * )
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison des actions déstabilisant la Moldavie – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur le territoire des États membres – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ou faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes – Atteinte au processus politique démocratique et déstabilisation de l’ordre constitutionnel – Article 1er, paragraphe 1, sous a), i), et article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la décision (PESC) 2023/891 – Article 2, paragraphe 3, sous a), i), du règlement (UE) 2023/888 – Association à des personnes inscrites sur les listes – Article 1er, paragraphe 1, sous b), et article 2, paragraphe 1, sous b), de la décision 2023/891 – Article 2, paragraphe 3, sous b), du règlement 2023/888 – Obligation de motivation – Exception d’illégalité – Erreur d’appréciation – Liberté d’entreprise – Droit de propriété – Liberté d’association – Liberté d’expression – Responsabilité non contractuelle »
Dans l’affaire T‑344/24,
Victor Petrov, demeurant à Comrat (Moldavie), représenté par M es T. Bontinck, L. Marchal, avocats, et M. C. Zatschler, SC,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M me L. Berger et M. A. Boggio-Tomasaz, en qualité d’agents, assistés de M e E. Raoult, avocate,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh et J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur), juges,
greffier : M me H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 13 mai 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours, le requérant, M. Victor Petrov, demande, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision (PESC) 2024/1242 du Conseil, du 26 avril 2024, modifiant la décision (PESC) 2023/891 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie (JO L, 2024/1242), et du règlement d’exécution (UE) 2024/1243 du Conseil, du 26 avril 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) 2023/888 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie (JO L, 2024/1243) (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »), en ce que ces actes le concernent et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, réparation du préjudice moral qu’il aurait subi.
I. Antécédents du litige
2 Le requérant est un homme politique de nationalité moldave.
3 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne, à la demande des dirigeants actuels de la République de Moldavie, en raison des actions de déstabilisation auxquelles ce pays fait face, actions qui se sont intensifiées depuis le début de la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine et qui menacent de faire obstacle à son adhésion à l’Union.
4 Le 28 avril 2023, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision (PESC) 2023/891, concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie (JO 2023, L 114, p. 15). À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) 2023/888, concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie (JO 2023, L 114, p. 1).
5 L’article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2023/891 prévoit ce qui suit :
« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire :
a) des personnes physiques qui sont responsables d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ou la démocratie, l’État de droit, la stabilité ou la sécurité dans la République de Moldavie, ou qui soutiennent ou mettent en œuvre ces actions ou politiques par l’un des agissements suivants :
i) faire obstacle ou porter atteinte au processus politique démocratique, notamment en faisant obstacle ou en portant gravement atteinte à la tenue d’élections ou en tentant de déstabiliser ou de renverser l’ordre constitutionnel ;
ii) organiser, diriger ou participer, directement ou indirectement, à des manifestations violentes ou autres actes de violence, ou apporter leur soutien à de tels manifestations ou actes ou les faciliter de toute autre manière ; ou
iii) commettre des manquements financiers graves concernant des fonds publics et procéder à l’exportation non autorisée de capitaux ;
b) des personnes physiques associées aux personnes désignées en vertu du [sous] a), dont la liste figure en annexe. »
6 L’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de la décision 2023/891 prévoit que sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, ou possédés, détenus ou contrôlés, respectivement, par des personnes physiques, des entités ou des organismes responsables d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ou la démocratie, l’État de droit, la stabilité ou la sécurité dans la République de Moldavie, ou qui soutiennent ou mettent en œuvre ces actions ou politiques par l’un des trois agissements visés au point 5 ci-dessus, et par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes associés aux personnes désignées en vertu de la disposition sous a), dont la liste figure en annexe.
7 Par la décision (PESC) 2024/740 du Conseil, du 22 février 2024, modifiant la décision 2023/891 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie (JO L, 2024/740), et par le règlement d’exécution (UE) 2024/739 du Conseil, du 22 février 2024, mettant en œuvre le règlement 2023/888 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie (JO L, 2024/739), le nom du requérant a été inscrit sur les listes des personnes, entités et organismes visés par les mesures restrictives qui figurent à l’annexe de la décision 2023/891 et à l’annexe I du règlement 2023/888 (ci-après les « listes en cause »), pour les motifs suivants :
« Victor Petrov est adjoint du Bashkan de l’Assemblée populaire de Gagaouzie et chef de [“Gagauz Halk Birlii” (Union populaire de Gagaouzie)], un mouvement sociopolitique manifestement pro-russe qui a fusionné avec le parti politique “Renaștere” [(Renaissance)]. Il bénéficie du soutien politique d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste.
Victor Petrov participe activement à la diffusion de la désinformation et à l’incitation à la violence et à la peur auprès de la population gagaouze de la République de Moldavie au sujet d’une perte potentielle d’autonomie provoquée par les autorités de Chișinău. En conséquence, les autorités de la République de Moldavie ont bloqué l’un de ses sites [I]nternet, “gagauznews.md”. La diffusion se poursuit néanmoins par l’intermédiaire d’un nouveau domaine, “gagauznews.com” et des déclarations de Petrov.
En portant atteinte au processus politique démocratique et en déstabilisant l’ordre constitutionnel, Victor Petrov soutient les actions et les politiques qui portent atteinte et qui menacent la démocratie, l’État de droit et la stabilité en République de Moldavie. Il est également associé à Ilan Shor. »
8 Le 23 février 2024, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2023/891, modifiée par la décision 2024/740, et par le règlement 2023/888, mis en œuvre par le règlement d’exécution 2024/739 (JO C, C/2024/1794). Par cet avis, les personnes faisant l’objet de ces mesures restrictives ont été informées du fait qu’elles pouvaient envoyer au Conseil une demande de réexamen de l’inscription de leurs noms sur les listes en cause.
9 Le 1 er mars 2024, le requérant a demandé la communication des éléments de preuve étayant l’inscription de son nom sur les listes en cause.
10 Le 8 mars 2024, le Conseil a communiqué au requérant le document WK 563/2024 REV 2 contenant les éléments de preuve le concernant (ci-après le « document WK 563/2024 »).
11 Le 19 mars 2024, le requérant a envoyé au Conseil une demande de réexamen de l’inscription de son nom sur les listes en cause.
12 Le 26 avril 2024, le Conseil a adopté les actes attaqués, par lesquels les mesures restrictives prises à l’égard du requérant ont été prolongées jusqu’au 29 avril 2025.
13 Le 29 avril 2024, le Conseil a répondu aux observations soumises par le requérant dans sa demande de réexamen, a communiqué sa décision de renouveler les mesures restrictives à son égard et l’a informé de la possibilité de présenter de nouvelles observations avant le 1 er novembre 2024.
14 Le 3 mai 2024, le requérant a demandé au Conseil la communication des éléments de preuve étayant le maintien de son nom sur les listes en cause qui ne lui auraient pas déjà été communiqués.
15 Le 8 mai 2024, le Conseil a confirmé au requérant que tous les documents l’ayant conduit à renouveler les mesures restrictives à son égard lui avaient déjà été communiqués au moyen du document WK 563/2024.
II. Conclusions des parties
16 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués en tant qu’ils le concernent ;
– condamner le Conseil au paiement d’une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
– condamner le Conseil aux dépens.
17 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les actes attaqués seraient annulés, ordonner le maintien des effets de la décision 2024/1242 jusqu’à ce que l’annulation partielle du règlement d’exécution 2024/1243 prenne effet.
III. En droit
A. Sur les conclusions en annulation
18 Ainsi qu’il ressort explicitement des motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause, celui-ci fait l’objet de mesures restrictives, au motif que le Conseil a considéré que, d’une part, il soutenait des actions qui compromettaient et menaçaient la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie ainsi que la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité de cet État en raison d’un des trois agissements visés à l’article 1 er , paragraphe 1, sous a), et à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2023/891 ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement 2023/888 et, d’autre part, il était associé à une personne inscrite sur les listes en cause.
19 En particulier, d’une part, le Conseil reproche au requérant de porter atteinte au processus politique démocratique et de déstabiliser l’ordre constitutionnel, au sens du critère énoncé à l’article 1 er , paragraphe 1, sous a), i), et à l’article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la décision 2023/891 ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 3, sous a), i), du règlement 2023/888 [ci-après le « critère i) »]. D’autre part, le Conseil considère que le requérant est associé à M. Ilan Mironovich Shor, dont le nom est inscrit sur les listes en cause, au sens du critère prévu à l’article 1 er , paragraphe 1, sous b), et à l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la décision 2023/891 ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 3, sous b), du règlement d’exécution 2023/888 [ci-après le « critère b) »].
20 Au vu de leur caractère alternatif, il suffit, pour que les actes attaqués soient fondés en droit, que l’un des deux critères que le Conseil a utilisés pour inscrire et maintenir le nom du requérant sur les listes en cause l’ait été à juste titre (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft , C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 et jurisprudence citée). Partant, le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord les moyens et arguments du requérant critiquant la légalité des actes attaqués en ce qu’ils reposent sur le critère i).
21 À cet égard, à l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant invoque quatre moyens, tirés, le premier, d’une exception d’illégalité de la décision 2023/891 et du règlement 2023/888, le deuxième, de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation, qu’il convient d’examiner en premier lieu, le troisième, d’erreurs d’appréciation et, le quatrième, d’une violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux.
1. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation
22 À titre liminaire, il convient de relever que, dans le cadre de son deuxième moyen, le requérant soutient que le document WK 563/2024 est incorrect et incomplet à plusieurs égards, de sorte que le Conseil n’a pas pu adopter une décision impartiale et équitable, et ce au mépris de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il en déduit une violation des formes substantielles.
23 Ainsi, le requérant conteste, en substance, la fiabilité des éléments de preuve sur lesquels le Conseil s’est fondé pour adopter les actes attaqués. En effet, il considère, notamment, que les résumés des articles sont incorrects et trompeurs tandis que les articles eux-mêmes ne sont reproduits et traduits que partiellement. Dans ces conditions, cette argumentation présente un lien étroit avec le troisième moyen, tiré d’erreurs d’appréciation, et sera donc examinée dans ce cadre (voir points 109 à 122 ci-dessous).
24 Par ailleurs, le requérant fait valoir que les actes attaqués sont entachés d’une insuffisance de motivation, ce qui l’empêche de se défendre et porte ainsi atteinte à son droit à une protection juridictionnelle effective.
25 En particulier, le requérant soutient que le Conseil n’expliquerait pas en quoi il aurait porté atteinte au processus politique démocratique et déstabilisé l’ordre constitutionnel. Les éléments mentionnés dans les motifs ne sembleraient, en effet, pas de nature à poursuivre ces objectifs.
26 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
27 Selon la jurisprudence, la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, que l’intéressé devait faire l’objet d’une telle mesure (voir arrêt du 13 septembre 2018, Sberbank of Russia/Conseil , T‑732/14, EU:T:2018:541, point 97 et jurisprudence citée).
28 Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba , C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 53 et jurisprudence citée).
29 En l’espèce, les bases juridiques des actes attaqués sont aisément identifiables, puisqu’elles ressortent explicitement des motifs rappelés au point 7 ci-dessus.
30 En effet, comme cela a été constaté au point 18 ci-dessus, le Conseil a considéré que, d’une part, le requérant soutenait des actions qui compromettaient et menaçaient la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie ainsi que la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité de cet État en raison d’un des trois agissements visés à l’article 1 er , paragraphe 1, sous a), et à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2023/891 ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement 2023/888, à savoir le critère i), et, d’autre part, il était associé à une personne inscrite sur les listes en cause, conformément au critère b).
31 S’agissant du critère i), le Conseil a exposé de manière compréhensible et non équivoque les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles il a considéré, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que la participation active du requérant à la diffusion de la désinformation et à l’incitation à la violence et à la peur auprès de la population gagaouze de la République de Moldavie portait atteinte au processus politique démocratique et déstabilisait l’ordre constitutionnel, ce qui constituait un soutien aux actions compromettant et menaçant la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie ainsi que la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité de cet État.
32 En effet, le Conseil a indiqué que le requérant diffusait auprès de la population gagaouze des informations erronées au sujet d’une perte potentielle d’autonomie provoquée par les autorités de Chișinău (Moldavie) par l’intermédiaire de déclarations et de publications sur l’un de ses sites Internet, à savoir « gagauznews.com », après que son site Internet « gagauznews.md » fut bloqué par les autorités de la République de Moldavie.
33 Conformément à la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, ces indications doivent être lues à la lumière du contexte dans lequel les actes attaqués ont été adoptés. À cet égard, il ressort, en substance, des considérants 1 à 12 de la décision 2023/891 que le Conseil s’est engagé à soutenir la République de Moldavie face aux actions de déstabilisation menées avec le concours et dans l’intérêt de la Fédération de Russie dans le but de faire obstacle à son adhésion à l’Union en ciblant notamment les personnes qui représentent une menace pour la démocratie et l’État de droit ainsi que pour la stabilité et la sécurité de la République de Moldavie (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2024, Mironovich Shor/Conseil, T‑489/23, EU:T:2024:912, point 32).
34 Compte tenu de ce contexte, la motivation des actes attaqués était suffisante pour permettre au requérant de se défendre et de comprendre les raisons spécifiques et concrètes de l’inscription et du maintien de son nom sur les listes en cause et au Tribunal de contrôler leur légalité.
35 Au vu de ce qui précède, le deuxième moyen doit être rejeté.
2. Sur le premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité de la décision 2023/891 et du règlement 2023/888
36 Le premier moyen est, en substance, divisé en cinq branches, tirées, la première, du défaut de base juridique de la décision 2023/891 et du règlement 2023/888, la deuxième, de la violation du principe de proportionnalité, la troisième, de la violation du principe de sécurité juridique, la quatrième, d’un détournement de pouvoir et, la cinquième, de violations de l’article 2, de l’article 8 et de l’article 21, paragraphe 1, TUE.
a) Sur la compétence du Tribunal
37 Le Conseil soutient que, par le premier moyen, le requérant demande au Tribunal de déclarer la décision 2023/891 et le règlement 2023/888 inapplicables dans leur ensemble. Or, en application de l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 275 TFUE, le Tribunal ne serait pas compétent pour juger de l’opportunité de l’adoption de ces actes dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC).
38 En réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, le requérant a précisé qu’il n’entendait obtenir l’inapplicabilité de la décision 2023/891 et du règlement 2023/888 qu’à son égard.
39 Il convient de relever que, selon l’article 275, premier alinéa, TFUE, le juge de l’Union n’est pas compétent en ce qui concerne les dispositions relatives à la PESC, ni en ce qui concerne les actes adoptés sur leur base.
40 Toutefois, aux termes de l’article 275, second alinéa, TFUE, le juge de l’Union est compétent pour se prononcer sur les recours formés dans les conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE concernant le contrôle de légalité des décisions prévoyant des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre 2, du traité UE. Cette disposition n’exclut pas la possibilité de contester, par la voie incidente en vertu de l’article 277 TFUE, la légalité d’un acte de portée générale à l’appui d’un recours en annulation formé contre une mesure restrictive individuelle (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, Azarov/Conseil , T‑331/14, EU:T:2016:49, point 62).
41 Cela étant, l’article 277 TFUE n’ayant pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité de quelque acte de portée générale que ce soit à la faveur d’un recours quelconque, la portée d’une exception d’illégalité doit être limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige (voir arrêt du 30 avril 2019, Wattiau/Parlement , T‑737/17, EU:T:2019:273, point 56 et jurisprudence citée). C’est ainsi qu’à l’occasion de recours en annulation intentés contre des décisions du Conseil imposant des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, le Tribunal a admis que pouvait valablement faire l’objet d’une exception d’illégalité la disposition de l’acte de portée générale énonçant le critère en vertu duquel le nom de l’intéressé avait été inscrit sur les listes en cause (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil , T‑348/14, EU:T:2016:508, points 57 à 59 et jurisprudence citée).
42 En l’espèce, dès lors, le Tribunal est compétent pour connaître d’une exception d’illégalité limitée aux dispositions de la décision 2023/891 et du règlement 2023/888 qui prévoient les critères i) et b).
43 Eu égard au point 20 ci-dessus, il y a donc lieu de procéder à l’examen du premier moyen dans la mesure où celui-ci vise à remettre en cause la légalité des dispositions qui prévoient le critère i).
b) Sur la première branche du premier moyen, tirée du défaut de base juridique de la décision 2023/891 et du règlement 2023/888, la quatrième branche du premier moyen, tirée d’un détournement de pouvoir, et la cinquième branche du premier moyen, tirée de violations de l’article 2, de l’article 8 et de l’article 21, paragraphe 1, TUE
44 Dans le cadre de la première branche, de la quatrième branche et de la cinquième branche du premier moyen, qu’il convient d’examiner ensemble, le requérant soutient, en substance, que la décision 2023/891 et le règlement 2023/888 poursuivent d’autres objectifs que ceux que le Conseil est habilité à poursuivre dans le cadre de la PESC.
45 Selon le requérant, l’objectif consistant à faciliter l’adhésion d’un État tiers à l’Union n’est pas un objectif de la PESC, le processus d’adhésion étant régi par l’article 49 TUE, qui ne figure pas dans un chapitre du traité relatif à la PESC. En outre, le Conseil poursuivrait en réalité l’objectif de fausser le processus démocratique interne d’un pays voisin, de sorte que le recours à l’article 29 TUE et à l’article 215, paragraphe 2, TFUE pour justifier l’adoption, respectivement, de la décision 2023/891 et du règlement 2023/888 constituerait un détournement de pouvoir. Selon le requérant, ces mesures restrictives ont seulement pour objet de cibler certains membres de l’opposition politique, sur demande du gouvernement moldave, ce qui est constitutif d’une ingérence dans le processus politique démocratique interne de la République de Moldavie en violation de l’article 2, de l’article 8 et de l’article 21, paragraphe 1, TUE.
46 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
47 En l’espèce, la décision 2023/891 et le règlement 2023/888 ont pour base juridique, respectivement, l’article 29 TUE et l’article 215, paragraphe 2, TFUE, c’est-à-dire les bases juridiques pertinentes en matière de PESC, ce qui n’est pas en tant que tel contesté par le requérant. L’argumentation de ce dernier implique, en effet, plutôt de vérifier si ces actes s’inscrivent effectivement dans le cadre de la PESC.
48 À cet égard, en raison de la vaste portée des buts et des objectifs de la PESC, tels qu’ils sont exprimés à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 21 TUE ainsi qu’aux dispositions spécifiques relatives à celle‑ci, notamment les articles 23 et 24 TUE, le juge de l’Union reconnaît au Conseil une grande latitude aux fins de définir l’objet des mesures restrictives que l’Union adopte dans le domaine de la PESC (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil , T‑125/22, EU:T:2022:483, point 52 et jurisprudence citée).
49 C’est au regard d’éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de l’acte en cause, qu’il convient de contrôler le choix de la base juridique de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil , C‑220/14 P, EU:C:2015:147, point 42 et jurisprudence citée).
50 En l’occurrence, selon son considérant 11, la décision 2023/891 a pour finalité d’imposer des restrictions au déplacement et des mesures de gel des avoirs à l’encontre des personnes responsables d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie ainsi que la démocratie, l’État de droit, la stabilité ou la sécurité dans cet État, ou qui soutiennent ou mettent en œuvre ces actions ou politiques et des personnes, entités ou organismes qui leur sont associés.
51 Selon le considérant 2 de la décision 2023/891, ces mesures restrictives s’inscrivent dans le cadre d’une politique de soutien aux dirigeants actuels de la République de Moldavie, pays candidat à l’adhésion à l’Union, visant à renforcer la résilience, la sécurité, la stabilité, l’économie et l’approvisionnement énergétique de ce pays face aux activités de déstabilisation menées par des acteurs extérieurs.
52 Cette politique de soutien s’inscrit elle-même dans le contexte rappelé aux considérants 3 et 4 de la décision 2023/891, selon lequel le gouvernement moldave a accompli des progrès importants dans le renforcement de la démocratie et de l’État de droit ainsi que dans la lutte contre la corruption, mais fait face à de multiples crises et est de plus en plus confronté à des menaces directes pour sa stabilité, émanant à la fois de groupes internes ayant des intérêts particuliers et de la Fédération de Russie, qui concourent souvent à détourner le pays de sa trajectoire de réformes. Il ressort également du considérant 6 de ladite décision que, selon l’appréciation du Conseil, de telles actions de déstabilisation appelaient une réaction immédiate au regard de l’importance que revêtait la stabilité de la République de Moldavie en tant que pays candidat à l’adhésion à l’Union situé aux frontières de celle-ci.
53 C’est dans ce contexte que, au considérant 7 de la décision 2023/891, le Conseil a indiqué que les personnes qui font obstacle ou portent atteinte à la tenue d’élections ou tentent de renverser l’ordre constitutionnel, y compris par des actes de violence, représentaient une menace pour la démocratie et l’État de droit ainsi que pour la stabilité et la sécurité de la République de Moldavie.
54 Au regard de la finalité et du contenu de la décision 2023/891, il apparaît donc que cette décision est directement liée aux finalités de la PESC énoncées à l’article 21, paragraphe 2, sous b), TUE, en ce que celle-ci vise, en substance, à consolider et à soutenir la démocratie et l’État de droit en République de Moldavie.
55 Dans ce cadre, il y a lieu de considérer que la propagande et les campagnes de désinformation, qui sont de nature à remettre en cause les fondements de sociétés démocratiques (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 56), peuvent justifier, en raison notamment de la menace qu’elles représentent pour la stabilité d’un État, une action de l’Union dans le cadre de la PESC fondée sur l’objectif de consolider et de soutenir la démocratie et l’État de droit dans un pays tiers.
56 Il en découle que le critère i) pouvait être introduit dans l’ordre juridique de l’Union par la décision 2023/891 et le règlement 2023/888 fondés, respectivement, sur l’article 29 TUE et l’article 215, paragraphe 2, TFUE.
57 Cette conclusion n’est pas infirmée par les arguments du requérant.
58 Tout d’abord, il y a lieu d’écarter l’argument selon lequel, en cherchant à faciliter l’adhésion à l’Union d’un pays candidat, le Conseil poursuivrait un objectif qui serait sans lien avec la PESC.
59 En effet, le respect de l’État de droit, qui est une valeur essentielle sur laquelle repose l’Union, est une condition préalable à l’adhésion à l’Union et l’article 21, paragraphe 2, sous b), TUE habilite le Conseil à adopter des mesures restrictives pour soutenir, notamment, l’État de droit dans un pays tiers. Partant, le Conseil est compétent pour adopter des mesures restrictives visant à soutenir l’État de droit dans un pays tiers candidat à l’adhésion à l’Union.
60 Ensuite, ne saurait prospérer l’argument du requérant tiré d’un détournement de pouvoir. En effet, selon une jurisprudence constante, un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, qu’il a été pris exclusivement, ou à tout le moins de manière déterminante, à des fins autres que celles pour lesquelles le pouvoir en cause a été conféré ou dans le but d’éluder une procédure spécialement prévue par les traités pour parer aux circonstances de l’espèce (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil , T‑193/22, EU:T:2023:716, point 208 et jurisprudence citée).
61 Or, le requérant n’a pas fourni de tels indices susceptibles d’établir que le Conseil poursuivait d’autres objectifs que celui qui ressortait de la décision 2023/891. En particulier, le simple fait que le Conseil ait répondu positivement à une demande de soutien de l’Union face aux actions qui menaçaient de déstabiliser la République de Moldavie ne signifie pas que les actes adoptés à ce titre sont entachés d’un détournement de pouvoir. De même, l’allégation selon laquelle les mesures restrictives auraient été conçues « pour cibler […] spécifiquement [les] principaux leaders de l’opposition » et feraient partie intégrante d’une répression plus large de l’opposition en Moldavie est contredite par la formulation générale des critères d’inscription en cause, formulation qui les rend susceptibles de s’appliquer à d’autres catégories de personnes que des personnalités politiques.
62 Enfin, dès lors qu’il est établi que le Conseil était habilité à adopter la décision 2023/891 et le règlement 2023/888, notamment afin de soutenir la démocratie et l’État de droit en République de Moldavie conformément à l’article 21, paragraphe 2, sous b), TUE, l’argumentation tirée de violations de l’article 2, de l’article 8 et de l’article 21, paragraphe 1, de ce traité ne saurait prospérer.
63 Partant, la première branche, la quatrième branche et la cinquième branche du premier moyen doivent être écartées comme étant non fondées.
c) Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation du principe de proportionnalité
64 Le requérant soutient que l’exigence d’appliquer « à titre conservatoire » des mesures de gel de fonds dans l’Union ou d’interdiction d’entrée sur le territoire de l’Union ne sauraient avoir un impact sur le processus politique ou sur l’organisation de manifestations en Moldavie. Par conséquent, les mesures restrictives ne seraient pas aptes à atteindre l’objectif poursuivi.
65 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
66 À cet égard, s’agissant du contrôle juridictionnel du respect du principe de proportionnalité, la Cour a jugé qu’il convenait de reconnaître un large pouvoir d’appréciation au législateur de l’Union dans les domaines qui impliquaient de la part de ce dernier des choix de nature politique, économique et sociale, et dans lesquels celui-ci était appelé à effectuer des appréciations complexes. Elle en a déduit que seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure adoptée dans ces domaines, au regard de l’objectif que l’institution compétente entendait poursuivre, pouvait affecter la légalité d’une telle mesure (voir arrêt du 28 mars 2017, Rosneft , C‑72/15, EU:C:2017:236, point 146 et jurisprudence citée).
67 Or, force est de constater que le requérant se limite à contester le caractère proportionné des mesures prises, mais n’explique pas en quoi lesdites mesures seraient disproportionnées. Ainsi, s’il considère que, contrairement aux régimes de mesures restrictives adoptées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans lesquels le gel des fonds permet d’éviter que les fonds soient utilisés pour financer le terrorisme, le gel des fonds ou l’interdiction d’entrée sur le territoire de l’Union ne peuvent pas avoir un impact sur le processus politique ou l’organisation de manifestations en Moldavie, il n’étaye son propos d’aucun argument ni d’aucun élément de preuve.
68 Le requérant ne soutient pas non plus que d’autres mesures, moins contraignantes, auraient pu être adoptées par le Conseil pour parvenir aux mêmes objectifs et les identifie encore moins.
69 Dans ces conditions, il convient de rejeter la deuxième branche du premier moyen.
d) Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de la violation du principe de sécurité juridique
70 Le requérant soutient que le Conseil a violé le principe de sécurité juridique au motif que les critères énoncés par la décision 2023/891 et le règlement 2023/888 rendraient impossible pour une personne visée d’échapper aux mesures restrictives, quel que soit son comportement. De plus, le critère i) viserait à imposer rétroactivement des sanctions pénales en raison d’un comportement passé et il ne serait pas suffisamment clair.
71 Par ailleurs, le principe de sécurité juridique s’opposerait à une interprétation du critère i) selon laquelle n’importe quel acteur politique pourrait se voir infliger des mesures restrictives, pour le seul fait d’être en désaccord avec les orientations politiques du Conseil.
72 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
73 Le principe de sécurité juridique implique que la législation de l’Union soit certaine et que son application soit prévisible pour les justiciables (voir arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil , T‑14/14 et T‑87/14, EU:T:2017:102, point 192 et jurisprudence citée). Cette législation doit être claire et précise, afin que les justiciables puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (voir arrêt du 28 mars 2017, Rosneft , C‑72/15, EU:C:2017:236, point 161 et jurisprudence citée).
74 En l’espèce, tout d’abord, le requérant n’a pas identifié les aspects du critère i) qui, selon lui, manquaient de clarté ou de précision.
75 Ensuite, doit être écartée l’allégation selon laquelle le critère i) viserait à sanctionner pénalement certaines personnes en raison de leur comportement passé.
76 En effet, d’une manière générale, les mesures restrictives n’ont pas le caractère d’une sanction pénale, les fonds en cause étant gelés à titre conservatoire et, donc, provisoire.
77 En l’occurrence, la nature conservatoire des mesures restrictives en cause est attestée par les considérants 4, 5 et 7 à 10 de la décision 2023/891, dont il ressort que les différents critères d’inscription qu’elle prévoit visent à combattre les actes de déstabilisation qui représentent une « menace » pour la démocratie et l’État de droit en République de Moldavie.
78 En d’autres termes, les personnes responsables de telles actions de déstabilisation ou celles qui les soutiennent ne sont pas sanctionnées en raison de leur comportement passé, mais font l’objet de mesures restrictives parce que le Conseil a considéré que, en raison de leurs agissements, elles représentaient, au jour de l’adoption de ces mesures, une menace pour la démocratie et l’État de droit dans ce pays.
79 En cela, les mesures visent essentiellement à prévenir la perpétration de tels actes ou leur répétition et elles sont davantage fondées sur l’évaluation d’une menace actuelle ou future que sur l’appréciation d’un comportement passé (voir, par analogie, arrêt du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil , T‑256/07, EU:T:2008:461, point 110). Toute autre interprétation aurait pour conséquence d’imposer au Conseil de se fonder uniquement sur des agissements postérieurs à l’instauration des critères en cause, privant ainsi d’efficacité les compétences qui lui sont conférées par l’article 29 TUE et l’article 215 TFUE.
80 Par ailleurs, l’allégation selon laquelle la formulation de ce critère entraînerait l’impossibilité d’échapper aux mesures restrictives ne saurait prospérer.
81 En effet, la validité des mesures restrictives est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste en cause ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil , T‑193/22, EU:T:2023:716, point 168 et jurisprudence citée).
82 Enfin, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le principe de sécurité juridique s’oppose à une interprétation du critère i) selon laquelle n’importe quel acteur politique pourrait se voir infliger des mesures restrictives, pour le seul fait d’être en désaccord avec les orientations politiques du Conseil, il convient de le rejeter.
83 En effet, ce faisant, le requérant critique une hypothétique interprétation du critère i), mais ne soutient pas que, en raison d’une formulation imprécise, différentes interprétations dudit critère seraient possibles, de sorte qu’il y aurait lieu de constater une violation du principe de sécurité juridique.
84 Partant, la troisième branche du premier moyen doit être écartée comme étant non fondée.
85 Au vu de ce qui précède, le premier moyen doit être écarté dans son intégralité comme étant non fondé.
3. Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs d’appréciation
86 Le requérant s’étonne de la « légèreté » du document WK 563/2024, uniquement constitué d’extraits de presse et de captures d’écran de sites Internet. Il reproche au Conseil de n’avoir fourni aucun effort d’analyse ni d’enquête sur les liens entre ces éléments et les critères justifiant de lui imposer des mesures restrictives. Par ailleurs, le requérant conteste l’application des critères d’inscription retenus à son encontre et considère que le Conseil a commis des erreurs d’appréciation.
87 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
a) Sur les éléments de preuve pris en considération par le Conseil
88 Le requérant remet en cause, d’une part, le type de preuves pris en considération par le Conseil et, d’autre part, la fiabilité des preuves contenues dans le document WK 563/2024.
1) Sur le type de preuves pris en considération par le Conseil
89 Selon le requérant, c’est seulement lorsque le Conseil ne dispose pas de pouvoirs d’enquête dans un pays tiers qu’il pourrait se fonder sur des articles de presse. En l’occurrence, la délégation de l’Union en République de Moldavie aurait parfaitement été en mesure de mener des enquêtes sur le terrain. En outre, et dès lors qu’il existerait des liens de coopération étroits avec le gouvernement moldave, le Conseil ne saurait procéder de la même manière que dans le cadre des régimes de mesures restrictives russe ou syrien, en fondant les mesures restrictives sur des articles de presse. En effet, lorsque les institutions disposeraient de plusieurs méthodes de preuve, celles-ci seraient dans l’obligation de se baser sur la méthode la plus fiable.
90 Cela serait d’autant plus vrai lorsqu’il s’agirait de faits qui constitueraient des infractions pénales graves. Dans ce cas, il serait attendu que les autorités nationales de l’État concerné s’intéressent à la question et enquêtent, de sorte qu’il ne soit pas nécessaire de se fonder sur des articles de presse. De plus, lorsqu’une enquête pénale est menée au niveau national, la présomption d’innocence et les droits de la défense lieraient également les institutions de l’Union, qui ne pourraient pas simplement s’appuyer sur des reportages de seconde main pour imposer des mesures restrictives.
91 Par ailleurs, les éléments de preuve fournis par le Conseil ne correspondraient pas aux exigences relatives aux règles procédurales concernant le régime linguistique. À cet égard, tout d’abord, le russe, langue dans laquelle une bonne partie des éléments de preuve fournis par le Conseil sont rédigés, ne figurerait pas parmi les langues officielles reprises dans le règlement n o 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), tel que modifié. Ensuite, l’intégralité des procédures de mesures restrictives se déroulant en anglais, il serait peu probable qu’un document en langue roumaine, langue dans laquelle d’autres éléments de preuve fournis par le Conseil sont rédigés, soit compris sans traduction par un nombre significatif de délégations, et encore moins par une majorité d’entre elles.
92 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
93 Premièrement, s’agissant de la question de savoir si le Conseil pouvait adopter les actes attaqués sans procéder lui-même à des vérifications sur le terrain, il convient de rappeler que, en l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union adoptant des mesures restrictives doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse ou d’autres sources d’information similaires [voir arrêt du 20 mars 2024, Belshyna/Conseil , T‑115/22, EU:T:2024:187, point 68 (non publié) et jurisprudence citée].
94 En l’occurrence, le fait que l’Union dispose d’une délégation en République de Moldavie n’implique pas qu’elle aurait des pouvoirs d’enquête dans ce pays. En effet, cette délégation n’a pas la compétence de mener des enquêtes sur le territoire moldave afin de rechercher les éléments de preuve susceptibles de fonder l’adoption de mesures restrictives par le Conseil.
95 Le fait que le régime de mesures restrictives en cause ait été adopté en réponse à une demande de soutien de la République de Moldavie tout comme la circonstance qu’il s’agit d’un pays candidat à l’adhésion à l’Union n’infirment pas le constat de l’absence de pouvoirs d’enquête de l’Union dans ce pays tiers.
96 Quant à la possibilité pour le Conseil de demander aux autorités moldaves leur coopération afin de rassembler des éléments de preuve qui ne seraient pas forcément accessibles au public, invoquée par le requérant, il convient, certes, de relever que l’exigence d’un examen diligent et impartial qui s’impose aux institutions, en vertu du principe de bonne administration, principe général du droit de l’Union, oblige celles-ci à mettre tout en œuvre afin de disposer des éléments les plus complets et fiables possibles avant l’adoption d’une décision (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, point 90 et jurisprudence citée ; du 14 mai 2020, Agrobet CZ, C‑446/18, EU:C:2020:369, points 43 et 44, et du 12 mai 2022, Klein/Commission, C‑430/20 P, EU:C:2022:377, points 87 et 88).
97 Par ailleurs, dans le contexte particulier des régimes de mesures restrictives, il y a lieu de rappeler que, pour apprécier la nature, le mode et l’intensité de la preuve qui peut être exigée du Conseil, il convient de tenir compte de la nature et de la portée spécifique des mesures restrictives, du contexte dans lequel elles s’inscrivent ainsi que de leur objectif (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2017, Ben Ali/Conseil, T‑149/15, non publié, EU:T:2017:693, point 130, et conclusions de l’avocat général Bot dans les affaires Anbouba/Conseil, C‑605/13 P et C‑630/13 P, EU:C:2015:248, point 123).
98 Toutefois, en l’espèce, il convient de constater que le type de preuves apportées par le Conseil est suffisant au regard de la charge de la preuve qui lui incombe.
99 En effet, pour ce qui est du critère i), il convient de relever que le Conseil se fonde sur des articles de presse, mais aussi sur des articles publiés directement sur les sites Internet « gagauznews.md » et « gagauznews.com ». Or, afin de démontrer que le requérant participe activement à la diffusion de la désinformation et à l’incitation à la violence et à la peur auprès de la population gagaouze de la République de Moldavie, il peut être considéré comme étant suffisant pour le Conseil d’avoir recueilli des éléments provenant de sources d’informations accessibles au public et d’avoir apporté des éléments de preuve directs, c’est-à-dire les éléments de preuve provenant de la source de la diffusion de la désinformation et de l’incitation à la violence et à la peur, sans qu’il ait été nécessaire, en l’espèce, de recueillir des éléments de preuve auprès des autorités moldaves. En effet, de telles preuves permettent au Conseil d’apprécier et de qualifier le contenu diffusé par le requérant.
100 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance, avancée par le requérant, que les actions qui lui sont reprochées sont susceptibles de poursuites pénales dans l’ensemble des États membres de l’Union, de sorte que le niveau de preuve exigé du Conseil devrait être plus élevé. En effet, le fait que le nom du requérant soit inscrit sur les listes en cause en raison de certains agissements ne préjuge pas de la qualification que des juridictions nationales seraient susceptibles de retenir à leur égard. Dans ces conditions et compte tenu, d’une part, du principe de libre appréciation des preuves qui régit l’activité de la Cour et du Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2018, Infineon Technologies/Commission, C‑99/17 P, EU:C:2018:773, point 65 et jurisprudence citée), et, d’autre part, du fait que les mesures restrictives de gel de fonds ne sont pas de nature pénale (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2014, Sport-pari/Conseil, T‑439/11, non publié, EU:T:2014:1043, point 89 et jurisprudence citée), le niveau de preuve exigé du Conseil ne saurait dépendre de celui des ordres juridiques nationaux pour l’établissement d’infractions pénales.
101 Deuxièmement, quant à la circonstance que la majorité des éléments de preuve seraient rédigés en langue russe, qui n’est pas une langue officielle de l’Union européenne, et en langue roumaine, qui serait peu usitée au sein du Conseil, il convient de relever que, s’agissant des preuves rédigées en langue russe, le Conseil en a fourni une traduction anglaise. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère peu usité ou non de la langue roumaine au sein du Conseil, il y a lieu de constater que le Conseil a bien délibéré et adopté les actes attaqués sur la base d’un document – le document WK 563/2024 – établi dans les langues prévues par le régime linguistique en vigueur, conformément aux exigences posées par l’article 14, paragraphe 1, de son règlement intérieur, annexé à sa décision 2009/937/UE, du 1 er décembre 2009, portant adoption de son règlement intérieur (JO 2009, L 325, p. 35). Par conséquent, l’argument du requérant doit être rejeté.
102 Partant, aux fins de l’adoption des actes attaqués, le Conseil pouvait se fonder sur des éléments d’information publiquement accessibles, tels que des liens vers des sites Internet et des articles de presse.
2) Sur la fiabilité des preuves contenues dans le document WK 563/2024
103 Le requérant reproche, en substance, au Conseil d’avoir fondé les actes attaqués sur de simples extraits ou des captures d’écran partielles, dont certains ne font pas état du contexte pertinent, et de n’avoir fourni que des traductions partielles qui, pour certaines, ne couvriraient même pas l’intégralité des parties des documents visibles dans les captures d’écran. De surcroît, ces extraits proviendraient d’une presse de type « tabloïds » peu crédible.
104 En outre, les résumés des éléments de preuve contenus dans le document WK 563/2024 seraient incorrects et trompeurs, dans la mesure où il ne s’agirait pas de résumés objectifs, mais d’une sélection subjective des interprétations les plus dommageables qui peuvent être tirées du dossier.
105 Or, la fourniture d’un lien Internet permettant d’accéder à une source d’information sur laquelle le Conseil se fonde ne saurait remédier au caractère incorrect et trompeur des résumés.
106 En effet, d’une part, il serait irréaliste de soutenir que les représentants des États membres consulteraient les liens Internet fournis. D’autre part, les sites Internet seraient susceptibles d’être modifiés à tout moment, sans nécessairement laisser des traces de la modification.
107 Le requérant précise que le Conseil ne saurait, au stade de la procédure devant le Tribunal, remédier aux défauts ainsi constatés en complétant le dossier ou en corrigeant les résumés.
108 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
109 Ainsi qu’il a été rappelé au point 100 ci-dessus, le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre appréciation des preuves dont il découle que, dès lors qu’un élément de preuve a été obtenu régulièrement, le seul critère pertinent pour apprécier la force probante des preuves régulièrement produites réside dans leur crédibilité (voir arrêt du 26 septembre 2018, Infineon Technologies/Commission , C‑99/17 P, EU:C:2018:773, point 65 et jurisprudence citée).
110 En réponse à une mesure d’organisation de la procédure, le Conseil a fourni un bref descriptif des différents journaux et des différents organismes dont il a utilisé les articles comme éléments de preuve reproduits dans le document WK 563/2024. Il en ressort que les éléments dont la force probante est contestée par le requérant émanent de sources d’information numériques d’origines variées, non seulement locales, comme le site Internet Moldova Curată, décrit comme une plateforme d’information moldave gérée par l’Association de la presse indépendante de la République de Moldavie, ou le journal Gazeta de Chișinău, institution de presse libre et indépendante qui couvre les nouvelles nationales, mais également étrangères, telles que le site Internet Carnegie Europe, bénéficiant d’un prestige international, le Centre for Eastern Studios, une institution publique polonaise, l’Institute for War & Peace Reporting, une organisation indépendante à but non lucratif avec un profil international, Lossi 36, une organisation non gouvernementale basée en Suède, ou encore le site Internet Deutsche Welle, diffuseur d’informations international basé en Allemagne avec une large visibilité opérant au niveau international.
111 Cela étant, c’est à la partie requérante qu’il revient d’identifier avec précision les éléments de preuve qui pourraient soulever des doutes quant à leur fiabilité (voir arrêt du 8 mars 2023, Assaad/Conseil , T‑426/21, EU:T:2023:114, point 86 et jurisprudence citée).
112 Premièrement, en ce que le requérant prétend que les éléments de preuve proviendraient d’une presse de type « tabloïds » peu crédible, il convient de constater qu’il s’agit d’une allégation générale et déclarative qu’il n’étaye par aucun élément concret. De même, doit être écarté l’argument du requérant selon lequel les sites Internet seraient susceptibles d’être modifiés à tout moment, sans nécessairement laisser des traces de la modification, faute d’être étayé.
113 Deuxièmement, lors de l’audience, le requérant a eu l’opportunité de soumettre ses observations sur la réponse donnée par le Conseil à la mesure d’organisation de la procédure, rappelée au point 110 ci-dessus.
114 À cet égard, le requérant reproche, en substance, au Conseil de ne pas avoir été précis sur l’origine des sources utilisées et de ne pas avoir documenté sa réponse. De plus, il constate que sur les seize sources identifiées par le Conseil, neuf sont des organismes d’études ou des organisations non gouvernementales qui sont soit affiliées à des organisations de défense de causes particulières soit soutenues par des intérêts politiques spécifiques. Autrement dit, il s’agirait de sources qui manqueraient d’impartialité.
115 Il convient de relever que, ce faisant, le requérant se contente d’avancer des allégations générales. En outre, il n’explicite pas quelles causes particulières ou quels intérêts politiques spécifiques seraient respectivement défendues et poursuivis ni en quoi cela démontrerait le manque d’impartialité des sources utilisées par le Conseil.
116 Or, dès lors que les éléments de preuve soumis par le Conseil, communiqués au requérant, proviennent de sources publiquement accessibles et que, de surcroît, le Conseil a fourni des éléments permettant au requérant d’avoir des informations plus précises sur le type de sources utilisées, il lui était possible d’indiquer lesquelles, selon lui, manquaient d’impartialité et pour quelles raisons.
117 Troisièmement, s’agissant du fait que les éléments de preuve ne seraient pas crédibles, car ils ne seraient constitués que d’extraits et de captures d’écran, il y a lieu de relever que lesdits extraits et les captures d’écran étaient accompagnés de liens hypertextes permettant de consulter l’intégralité des articles dont certains passages ont été reproduits dans le document WK 563/2024. Or, d’une part, force est de constater que le requérant n’allègue pas que les extraits et les captures d’écran reproduits dans le document WK 563/2024 ne correspondent pas à ce qui est accessible via les liens hypertextes fournis.
118 D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, les articles accessibles par un lien hypertexte, bien que non reproduits dans leur intégralité dans le document WK 563/2024, doivent être considérés comme des preuves sur lesquelles s’est fondé le Conseil pour adopter les actes attaqués [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 24 novembre 2021, Al Zoubi/Conseil, T‑257/19, EU:T:2021:819, points 59 à 62 (non publiés), et du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T‑744/22, EU:T:2024:608, point 70].
119 La circonstance, au demeurant spéculative, qu’il serait irréaliste de soutenir que les représentants des États membres consulteraient les liens Internet fournis n’est pas à même de remettre en cause cette conclusion.
120 Par ailleurs, le Tribunal a déjà accepté la possibilité pour le Conseil de produire devant le Tribunal les documents correspondant aux liens hypertextes contenus dans les dossiers de preuves constitués en vue de l’inscription ou du maintien du nom d’une personne ou d’une entité sur des listes de mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêts du 6 avril 2017, Alkarim for Trade and Industry/Conseil, T‑35/15, non publié, EU:T:2017:262, point 44, et du 1 er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T‑723/20, non publié, EU:T:2022:317, points 53 à 55).
121 Par conséquent, le requérant ne saurait se prévaloir du fait que le Conseil n’a reproduit que des extraits ou des captures d’écran dans le document WK 563/2024 pour contester la fiabilité des éléments de preuve qui y sont contenus.
122 Quatrièmement, quant au fait que les résumés rédigés par le Conseil seraient trompeurs et incorrects, il convient de relever que, même à supposer que tel soit le cas, cela ne serait pas de nature à remettre en cause la fiabilité des éléments de preuve. En effet, celle-ci s’apprécie au regard de la vraisemblance de l’information qui est contenue dans l’élément de preuve en question et, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2023, Assaad/Conseil , T‑426/21, EU:T:2023:114, point 85 et jurisprudence citée). En revanche, le fait allégué que le Conseil ait fourni un résumé erroné du contenu des éléments de preuve peut être de nature à démontrer une erreur d’appréciation du Conseil, de sorte qu’il conviendra de tenir compte de cette allégation du requérant lors de l’analyse du bien-fondé des motifs d’inscription.
b) Sur le bien-fondé des motifs justifiant le maintien du nom du requérant sur les listes en cause au titre du critère i)
123 Il convient d’examiner si le Conseil a satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait en faisant état d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir que le requérant participe activement à la diffusion de la désinformation et à l’incitation à la violence et à la peur auprès de la population gagaouze de la République de Moldavie au sujet d’une perte potentielle d’autonomie provoquée par les autorités de Chișinău.
124 Il ressort tant des motifs d’inscription que des éléments de preuve produits par le Conseil que, en l’espèce, la diffusion de la désinformation et l’incitation à la violence et à la peur auprès de la population gagaouze se réalisent au moyen, d’une part, des informations émises par le site Internet « gagauznews.com » et, d’autre part, des déclarations du requérant.
1) Sur le site Internet « gagauznews.com »
125 En premier lieu, il ressort des éléments de preuve n os 9, 17, 18 et 21 à 26 du document WK 563/2024 que c’est principalement le site Internet « gagauznews.com » qui diffuse de la désinformation et incite à la violence et à la peur auprès de la population gagaouze de la République de Moldavie au sujet d’une perte potentielle d’autonomie provoquée par les autorités de Chișinău.
126 À titre d’exemple, l’élément de preuve n o 18 du document WK 563/2024, à savoir un article publié le 28 novembre 2023 sur le site Internet « gagauznews.com », se faisant l’écho de rumeurs, dénonce l’engagement, prévu par la présidente de la République de Moldavie, de militants ukrainiens afin de ramener l’ordre à Chișinău et d’intimider la population, déboursant, à cet effet, de larges sommes d’argent, et ce alors que le régime en place se plaindrait qu’il n’y a pas assez d’argent pour l’indexation des pensions de retraite. L’article considère que, ce faisant, le régime en place dévoile son « sourire nazi ».
127 De même, l’élément de preuve n o 21 du document WK 563/2024, à savoir un article publié le 30 janvier 2024 sur le site Internet « gagauznews.com », relaie l’appel du parti « Renaștere » à rejoindre une manifestation contre le régime en place, considéré « anti-peuple », ainsi que les déclarations d’un membre du bureau politique de ce parti qui accuse le gouvernement en place de « mettre en œuvre la volonté des ennemis du peuple de Moldavie » et de constituer « une menace quotidienne à la guerre, dans laquelle les lobbys de l’Ouest [voudraient] entraîner la République de Moldavie par le col ».
128 Par ailleurs, l’élément de preuve n o 24 du document WK 563/2024, à savoir un article publié le 28 novembre 2024 sur le site Internet « gagauznews.com », rapporte les propos d’un des membres du bureau politique du parti « Renaștere » mentionnant que « la Moldavie est devenue un terrain d’essai sur lequel les puissances mondiales mesurent leur force, elles essaient d’éloigner le pays du partenariat avec la Russie » et que le Parti action et solidarité (PAS) au pouvoir est devenu « un exécuteur très efficace de la volonté de quelqu’un d’autre ». Il mentionne également que « la République de Moldavie répète le scénario de “l’expérience ukrainienne” ».
129 Enfin, il ressort de l’élément de preuve n o 26 du document WK 563/2024 que, sur sa page Facebook, consultée le 7 février 2024, le site Internet « gagauznews.com » a posté des publications visant à associer la présidente de la République de Moldavie à des créatures démoniaques et la ministre de la Santé moldave à la mort d’enfants, ainsi qu’à accuser la présidente d’être la « marionnette » de l’Ouest et les autorités moldaves d’être un régime fasciste.
130 En second lieu, il ressort de l’élément de preuve n o 3 du document WK 563/2024, à savoir un article publié par le site Internet du Centre for Eastern Studies le 23 août 2022 et intitulé « Separatism and gas : Russian attempts to destabilise Moldova » (Séparatisme et gaz : tentatives russes de déstabiliser la Moldavie), que le requérant a fondé l’organisation « Centrul Comunitar Anticriză » (centre communautaire anti-crise), qui comprend le site Internet « gagauznews.md », bloqué par les autorités moldaves après l’invasion russe de l’Ukraine pour promouvoir du contenu incitant à la haine et à la guerre. De même, selon l’élément de preuve n o 6 du document WK 563/2024, à savoir un article publié sur le site Internet Lossi 36 le 17 août 2023 et intitulé « Techno-populism trumps geopolitics : How Moldovan oligarch Ilan Shor won local elections in Gagauzia » (Le techno-populisme l’emporte sur la géopolitique : comment l’oligarque moldave Ilan Shor a remporté les élections locales en Gagaouzie), l’équipe du requérant contrôlait le site Internet « gagauznews.md », bloqué par les autorités moldaves avant de réapparaître sous le nom de domaine « gagauznews.com ».
131 À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que le requérant ne conteste pas que le site Internet « gagauznews.md » a été bloqué par les autorités moldaves et est réapparu sous le nom de domaine « gagauznews.com ». Ensuite, il ne conteste pas non plus que le site Internet « gagauznews.com » a diffusé les articles produits en tant qu’éléments de preuve n os 9, 17, 18 et 21 à 25 du document WK 563/2024. Enfin, à l’exception de l’élément de preuve n o 9 (voir points 158 à 160 ci-après), il ne conteste pas le contenu de ces différents éléments de preuve.
132 En revanche, le requérant nie avoir un lien avec le site Internet « gagauznews.com ».
133 À cet égard, premièrement, il convient de relever que le requérant reproche au Conseil de ne pas avoir produit d’éléments de preuve provenant du registre officiel de noms de domaine.
134 Or, force est de constater que, en réponse à cet argument, le Conseil a produit l’annexe B.9, qui est une capture d’écran du registre d’enregistrement des noms de domaine « .md », ccTLD Registry. Il en ressort que le titulaire du nom de domaine « gagauznews.md » est l’organisation « Centrul Comunitar Anticriză », qui, selon le Conseil, aurait été fondée par le requérant.
135 Deuxièmement, afin de prouver l’absence de lien avec le site Internet en cause, le requérant fournit une déclaration émise par un cabinet d’avocats, du 31 octobre 2024, faute, pour lui, de ne pas avoir pu obtenir de documents officiels.
136 Il ressort de cette déclaration et des preuves qui y sont annexées, à savoir un document délivré par le département de l’enregistrement et de l’agrément des personnes morales de l’agence de service public de la République de Moldavie du 30 octobre 2024 et la liste des membres de l’organisation « Centrul Comunitar Anticriză » en date du 15 juin 2020 et une autre en date du 15 février 2022, que le requérant a été président de cette organisation, fondée le 15 juin 2020, de sa création au 17 février 2021, mais n’en était pas membre.
137 Interrogé lors de l’audience sur l’annexe B.10, à savoir une page du site Internet de l’organisation « Centrul Comunitar Anticriză », le requérant n’a pas contesté qu’il y était effectivement mentionné comme le fondateur de cette organisation, mais considère que cela n’est pas juridiquement correct. Selon lui, il conviendrait de distinguer entre sa « position formelle » en termes de droit des sociétés, selon laquelle il n’est pas le fondateur de cette organisation, et la « position publique » qu’il prend, en tant que personnage public.
138 Or, la circonstance que le requérant soit désigné comme fondateur de l’organisation « Centrul Comunitar Anticriză » sur la page du site Internet de celle-ci n’est pas suffisante, eu égard aux éléments de preuve produits par le requérant, à savoir des documents officiels émanant d’une autorité administrative moldave et des registres de l’organisation elle-même, et à l’absence d’autres éléments de preuve produits par le Conseil pour établir à suffisance de droit sa qualité de fondateur de ladite organisation.
139 En effet, contrairement à ce que soutient le Conseil, l’extrait Orbis produit en réponse aux arguments du requérant en tant qu’annexe B.11 n’indique pas que celui-ci aurait été le fondateur de cette organisation, mais le mentionne seulement une fois, dans la catégorie « Previous directors & managers » (directeurs et gestionnaires précédents), ce qui tend à corroborer l’affirmation du requérant selon laquelle il a été seulement un temps président de ladite organisation.
140 Faute d’éléments de preuve plus probants, tels que des extraits de registres officiels, il y a lieu de constater que le Conseil n’a pas apporté un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants démontrant que le requérant était le propriétaire du nom de domaine « gagauznews.md », devenu, après son interdiction par les autorités moldaves, « gagauznews.com », en raison de son statut de fondateur de l’organisation « Centrul Comunitar Anticriză ».
2) Sur les déclarations du requérant
141 Les éléments de preuve n os 2, 3, 4, 9 et 12 du document WK 563/2024 relaient des propos tenus par le requérant.
142 Premièrement, selon l’élément de preuve n o 2 du document WK 563/2024, à savoir un article publié le 27 avril 2023 sur le site Internet Carnegie Europe et intitulé « Gagauzia’s Election Could Help Russia Destabilize Moldova » (Les élections en Gagaouzie pourraient aider la Russie à déstabiliser la Moldavie), le requérant « a été jusqu’à condamner l’armée ukrainienne pour avoir prétendument planifié des incursions armées en Moldavie » et même remis en question la réalité du massacre de Boutcha (Ukraine).
143 Deuxièmement, il ressort de l’élément de preuve n o 3 du document WK 563/2024 que le requérant a déclaré que lui-même, ainsi que plusieurs autres députés, avaient envoyé une lettre au président Vladimir Poutine afin de demander de l’aide humanitaire pour la Gagaouzie sous forme de gaz gratuit ou de gaz distribué à un prix inférieur à celui du reste de la Moldavie.
144 Troisièmement, l’élément de preuve n o 4 du document WK 563/2024, à savoir un article publié par le site Internet Institute for War & Peace Reporting le 3 octobre 2022 et intitulé « Russian Propaganda Dominates Moldova » (La propagande russe domine la Moldavie), indique qu’un site Internet du requérant a prétendu que ce qui était, en réalité, un exercice militaire des forces spéciales moldaves était une action visant à « rétablir l’ordre » dans la région de Gagaouzie et à faire peur à ses habitants.
145 Quatrièmement, selon l’élément de preuve n o 9 du document WK 563/2024, à savoir un article publié par le site Internet « gagauznews.com » le 23 août 2023, le requérant a déclaré qu’il pouvait être attendu que le peuple de Gagaouzie devienne bientôt la victime d’une trahison ignoble. Selon le requérant, le régime en place, dont les plans seraient de liquider l’autonomie de la Gagaouzie, serait prêt à transformer les habitants en chair à canon, les incitant à des actions de désobéissance.
146 Cinquièmement, l’élément de preuve n o 12 du document WK 563/2024, à savoir le profil du requérant publié le 23 août 2022 par le site Internet Moldova Curată, relate que le requérant a annoncé que si l’Ouest essayait de déstabiliser la situation en République de Moldavie, les forces d’État de Gagaouzie seraient prêtes à défendre l’ancien président, M. Igor Dodon.
147 Ces propos visent à inciter le peuple de Gagaouzie à la peur en cherchant à leur faire croire que le gouvernement en place en République de Moldavie pourrait prendre, ou a déjà pris, des décisions qui leur sont hautement préjudiciables et qui auraient un impact sur leur autonomie. Ils ont également pour objectif de les encourager à se tenir prêts à se défendre, en employant des mots aux connotations violentes et alarmistes.
148 À cet égard, le requérant reproche au Conseil de ne pas avoir reproduit l’intégralité des discours qu’il a prononcés alors qu’ils sont facilement accessibles. À ce titre, il estime que ses propos ont été dénaturés.
149 Premièrement, le requérant conteste avoir commenté ou évalué les événements à Boutcha, ainsi que cela est indiqué par l’élément de preuve n o 2 du document WK 563/2024. Le requérant indique avoir seulement déclaré que ce sujet devrait être évalué par des experts internationaux et que les responsables des crimes devaient être punis. Il aurait seulement commenté le fait que la présidente de la République de Moldavie a fait des commentaires sur Boutcha plus rapidement que la communauté internationale et les experts.
150 Force est de constater que le requérant n’apporte aucune preuve afin d’étayer ses allégations. En particulier, il ne produit pas la déclaration qu’il aurait effectivement tenue et dont le contenu aurait été dénaturé.
151 Deuxièmement, s’agissant de l’élément de preuve n o 3 du document WK 563/2024, le requérant ne conteste pas avoir envoyé la lettre au président Vladimir Poutine, mais l’explique par la circonstance qu’il a été nommé président du groupe de négociations sur la distribution du gaz avec la Fédération de Russie. Il considère qu’il n’existe pas de lien entre cette lettre et les motifs d’inscription de son nom sur les listes en cause.
152 Il convient de relever que cet élément de preuve démontre les liens entretenus par le requérant avec la Fédération de Russie, liens qu’il ne nie pas, et prouve également que celle-ci a été sollicitée pour une « aide humanitaire ». Or, l’utilisation de tels propos ne saurait être considérée comme étant anodine. En effet, la notion d’« aide humanitaire » renvoie à des situations dans lesquelles, à la suite d’une crise, telle qu’une catastrophe naturelle ou un événement d’origine humaine, comme une guerre ou un conflit, de l’aide extérieure au pays touché est apportée pour soulager les populations locales.
153 Par conséquent, en sollicitant une aide humanitaire de la Fédération de Russie, le requérant a exprimé deux idées : la première, que la région de Gagaouzie connaissait une crise particulièrement grave et, la seconde, qu’une aide extérieure était nécessaire, suggérant ainsi que le gouvernement moldave en place n’était pas à même de gérer cette crise.
154 Partant, contrairement à ce que soutient le requérant, il existe un lien entre une telle lettre et les motifs d’inscription selon lesquels il inciterait la population gagaouze à la peur. De tels propos sont également de nature à nourrir la défiance de la population gagaouze vis-à-vis du gouvernement en place.
155 Troisièmement, s’agissant de l’élément de preuve n o 4 du document WK 563/2024, il convient de relever, à l’instar du requérant, que celui-ci ne permet pas d’identifier le site Internet du requérant sur lequel auraient été diffusés ses propos relatifs à l’exercice entrepris par les forces spéciales moldaves.
156 Or, il convient de constater, d’une part, qu’aucun autre élément de preuve du document WK 563/2024 ne corrobore cette information et, d’autre part, que le Conseil n’a pas, dans ses écritures ni lors de l’audience, apporté de précisions sur ce point.
157 Dans ces conditions, l’élément de preuve n o 4 du document WK 563/2024 ne saurait être retenu afin de démontrer que, par ses déclarations, le requérant participe activement à la diffusion de la désinformation et à l’incitation à la violence et à la peur auprès de la population gagaouze.
158 Quatrièmement, concernant l’élément de preuve n o 9 du document WK 563/2024, le requérant considère que ses propos ont été dénaturés et qu’il s’est simplement prononcé comme étant opposé aux conflits et pour l’intégrité de la République de Moldavie.
159 Or, force est de constater que le requérant n’étaye pas ses propos à l’aide d’éléments concrets. En particulier, il ne fournit pas au Tribunal la déclaration qu’il a pourtant lui-même tenue, se limitant à indiquer que les propos en question sont disponibles sur Internet.
160 Sur ce dernier point, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher sur Internet des documents non annexés aux actes de procédure (ordonnance du 23 janvier 2025, Hilpisch/ECHA, T‑346/24, non publiée, EU:T:2025:96, point 36).
161 Cinquièmement, quant à l’élément de preuve n o 12 du document WK 563/2024, le requérant confirme les affirmations qui y sont contenues.
3) Conclusion sur le faisceau d’indices produit par le Conseil
162 Au vu de ce qui précède, si le Conseil n’a pas apporté de faisceau d’indices suffisamment précis et concordants permettant de démontrer que le requérant est le propriétaire du site Internet « gagauznews.com », anciennement « gagauznews.md », il est, en revanche, parvenu à démontrer que, par ses déclarations, le requérant participe activement à la diffusion de la désinformation et à l’incitation à la violence et à la peur auprès de la population gagaouze de la République de Moldavie.
163 En effet, selon les informations diffusées par le requérant, le gouvernement moldave chercherait à faire peur à la population gagaouze, qu’il entendrait ramener à l’ordre, et ne ferait rien pour les aider en ce qui concerne notamment l’approvisionnement en gaz de cette région.
164 Ainsi, le Conseil a satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait en faisant état d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir que le requérant participe activement à la diffusion de la désinformation et à l’incitation à la violence et à la peur auprès de la population gagaouze de la République de Moldavie au sujet d’une perte potentielle d’autonomie provoquée par les autorités de Chișinău.
4) Sur la responsabilité du requérant dans la réalisation d’actions compromettant ou menaçant la démocratie, l’État de droit et la stabilité en République de Moldavie
165 Il reste à apprécier si le fait d’avoir activement participé à la diffusion de la désinformation et à l’incitation à la violence et à la peur auprès de la population gagaouze au sujet d’une perte potentielle d’autonomie provoquée par les autorités de Chișinău suffit à considérer que le requérant soutient des actions qui compromettent ou menacent la démocratie, l’État de droit et la stabilité en République de Moldavie au sens de l’article 1 er , paragraphe 1, sous a), et de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2023/891.
166 Cette appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non pas de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil , C‑605/13 P, EU:C:2015:248, point 50 et jurisprudence citée).
167 À cet égard, en premier lieu, il ressort des considérants 1 à 7 de la décision 2023/891 que la République de Moldavie fait face à des actions de déstabilisation qui, d’une part, visent à faire obstacle à son adhésion à l’Union et, d’autre part, émanent d’acteurs extérieurs, tels que la Fédération de Russie, dont les actions se sont intensifiées depuis le début de sa guerre d’agression contre l’Ukraine.
168 Les éléments de preuve n os 2, 4 et 11 du document WK 563/2024, à savoir, respectivement, les articles mentionnés aux points 142 et 144 ci-dessus et un article publié par le site Internet Centre for Eastern Studies, le 23 août 2022 et intitulé « Separatism and gas : Russian attempts to destabilise Moldova » (Séparatisme et gaz : tentatives russes de déstabiliser la Moldavie), font apparaître que la Fédération de Russie tente de déstabiliser la République de Moldavie en diffusant sa propagande, mais également en augmentant le prix du gaz pour attiser le mécontentement de la population à l’égard du gouvernement actuel et en finançant des manifestations contre le gouvernement en place.
169 En substance, il ressort de ces éléments de preuve que la Fédération de Russie cherche à créer les conditions nécessaires pour attiser le mécontentement de la population à l’égard du gouvernement moldave actuel dans l’objectif de le renverser, en plongeant le pays dans une crise énergétique.
170 En deuxième lieu, les liens entre la Fédération de Russie et le requérant, que ce dernier ne nie pas, sont étayés par différents documents.
171 À cet égard, l’élément de preuve n o 2 du document WK 563/2024 décrit le requérant comme étant probablement l’une des voix les plus actives pour restaurer les relations avec la Fédération de Russie. De même, l’élément de preuve n o 3 du document WK 563/2024 indique que le requérant et plusieurs autres députés ont envoyé une lettre au président Vladimir Poutine afin de solliciter une aide humanitaire pour la Gagaouzie sous forme de gaz gratuit ou de gaz distribué à un prix inférieur à celui du reste de la Moldavie. D’après l’élément de preuve n o 11 du document WK 563/2024, le mouvement sociopolitique du requérant, « Gagauz Halk Birlii », pro-russe, a bénéficié d’une large publicité de la part des médias russes. Enfin, il ressort des éléments de preuve n os 10 et 15 du document WK 563/2024, à savoir un article publié par le journal Gazeta de Chișinău le 14 septembre 2021 et intitulé « Un activist cu afaceri obscure, candidat la alegerile din Găgăuzia, vrea referendum național pentru limba rusă » (Un militant aux affaires douteuses, candidat aux élections en Gagaouzie, veut un référendum national sur la langue russe) et un article publié par le site Internet Deutsche Welle le 18 avril 2023 et intitulé « Rusia vrea haos și control absolut în Găgăuzia » (La Russie veut le chaos et un contrôle absolu en Gagaouzie), que le requérant souhaite que la langue russe devienne la seconde langue de l’État moldave.
172 En troisième lieu, il convient de relever que, ainsi qu’il a été rappelé au point 55 ci-dessus, la propagande et les campagnes de désinformation sont de nature à remettre en cause les fondements de sociétés démocratiques. En l’occurrence, les déclarations du requérant cherchent à inciter à la violence et à la peur auprès de la population gagaouze, en attisant son mécontentement à l’égard du gouvernement moldave actuel dans l’objectif de le renverser. Il s’agit donc d’actions graves susceptibles de faire obstacle ou de porter atteinte au processus politique démocratique en tentant de déstabiliser ou de renverser l’ordre constitutionnel.
173 À la lumière de ce contexte, le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la diffusion de la désinformation et l’incitation à la violence et à la peur auprès de la population gagaouze au sujet d’une perte potentielle d’autonomie provoquée par les autorités de Chișinău suffit à considérer que le requérant soutient des actions qui compromettent ou menacent la démocratie, l’État de droit et la stabilité en République de Moldavie au sens de l’article 1 er , paragraphe 1, sous a), et de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2023/891.
174 Cette conclusion ne saurait être remise en question par les autres arguments soulevés par le requérant.
175 Premièrement, le requérant fait valoir que, en tout état de cause, les propos qu’il a tenus relèvent de sa liberté d’expression.
176 Or, indépendamment de la question de savoir si les propos tenus par le requérant relèvent ou non de sa liberté d’expression, le Conseil a démontré que ceux-ci participaient à la diffusion de la désinformation et à l’incitation à la violence et à la peur auprès de la population gagaouze ce qui, compte tenu du contexte existant en République de Moldavie, compromet ou menace la démocratie, l’État de droit et la stabilité en République de Moldavie au sens de l’article 1 er , paragraphe 1, sous a), et de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2023/891.
177 Pour autant que, par son argument, le requérant entend soutenir que le Conseil n’était pas fondé à adopter des mesures restrictives à son égard dans la mesure où il n’a fait qu’exercer sa liberté d’expression, il y a lieu de relever que celui-ci a trait à la violation alléguée du principe de proportionnalité. Dans ces conditions, cet argument sera examiné dans le cadre du quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux.
178 Deuxièmement, le requérant soutient que le critère i), tel qu’il est formulé, ne peut s’appliquer qu’aux actes les plus extrêmes portant atteinte à la démocratie et à l’ordre constitutionnel et ayant trait aux infractions les plus graves connues par le code pénal, telles que la trahison et l’insurrection.
179 À l’appui de son argumentation, le requérant mentionne différents régimes de mesures restrictives existants ou ayant existé.
180 À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que la qualification des agissements du requérant comme soutenant les actions compromettant ou menaçant la démocratie, l’État de droit et la stabilité en République de Moldavie, au sens de l’article 1 er , paragraphe 1, sous a), et de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2023/891, doit s’apprécier à l’égard du seul régime de mesures restrictives prises en raison des actions déstabilisant la Moldavie et ne saurait être appréciée en fonction des critères d’inscription établis par le Conseil dans le cadre d’autres régimes de mesures restrictives.
181 D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant et ainsi qu’il a été établi au point 172 ci-dessus, la propagande et les campagnes de désinformation sont des actions graves, car elles sont susceptibles de faire obstacle ou de porter atteinte au processus politique démocratique en tentant de déstabiliser ou de renverser l’ordre constitutionnel.
182 Troisièmement, le requérant prétend que les éléments de preuve avancés par le Conseil étant issus de la presse écrite et non des médias audiovisuels, leur impact potentiel doit être considéré comme étant moins important.
183 Certes, il convient de relever que, dans l’arrêt de la Cour EDH du 5 avril 2022, NIT S.R.L. c. République de Moldova (CE:ECHR:2022:0405JUD002847012, points 181 et 182 et jurisprudence citée), ladite juridiction a effectivement indiqué que les médias audiovisuels, qui peuvent, notamment, suggérer, par la façon de présenter les informations, comment les destinataires devraient les apprécier, avaient des effets beaucoup plus immédiats et puissants que la presse écrite, dès lors que, par les images, ils peuvent transmettre des messages que l’écrit n’est pas apte à faire passer.
184 Toutefois, il ne s’agissait pas, ce faisant, de minimiser l’impact que pouvait avoir, par ailleurs, l’écrit. En tout état de cause, que la désinformation ou l’incitation à la violence et à la peur se fassent au moyen de médias audiovisuels ou de l’écrit, elles peuvent avoir un impact négatif et grave sur les sociétés démocratiques et ne sauraient, dans les deux cas, être tolérées.
185 Quatrièmement, concernant l’argument du requérant selon lequel le gouvernement moldave a été à l’origine d’actions qui pourraient être considérées comme des atteintes à la tenue d’élections ou du renversement de l’ordre constitutionnel, il suffit de constater que cet argument est inopérant afin d’apprécier le bien-fondé des motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause.
186 Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le troisième moyen du requérant.
4. Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux
187 Le requérant considère que l’adoption de mesures restrictives individuelles à son égard est disproportionnée en ce qu’elle porte atteinte à sa liberté d’entreprise, à son droit de propriété ainsi qu’à son droit à la liberté d’association et à la liberté d’expression.
188 Par ailleurs, s’il a souligné, dans la réplique, qu’il était aussi un ressortissant de l’Union européenne dès lors qu’il avait la nationalité bulgare, le requérant a reconnu, lors de l’audience, qu’il s’agissait d’un argument nouveau qu’il ne pouvait pas valablement soulever.
189 Le Conseil estime que le quatrième moyen est irrecevable en raison de son manque de clarté. En tout état de cause, il considère que ledit moyen n’est pas fondé.
190 Le Conseil ayant été en mesure de répondre sur le fond aux arguments invoqués à l’appui de ce moyen et le Tribunal étant, par ailleurs, en mesure d’exercer son contrôle, la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu manque de clarté des écritures du requérant ne peut qu’être écartée.
191 Sur le fond, il y a lieu de rappeler que les droits fondamentaux, tels que ceux invoqués par le requérant, ne sont pas des prérogatives absolues et que leur exercice peut faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union, à condition que ces restrictions répondent effectivement auxdits objectifs d’intérêt général et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2018, National Iranian Tanker Company/Conseil , C‑600/16 P, EU:C:2018:966, point 83 et jurisprudence citée).
192 Ainsi, pour être conforme au droit de l’Union, une atteinte aux droits fondamentaux en cause doit être prévue par la loi, respecter le contenu essentiel de ceux-ci, viser un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union, et ne pas être disproportionnée (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil , T‑125/22, EU:T:2022:483, point 222 et jurisprudence citée).
193 En l’espèce, ces quatre conditions sont remplies.
194 En premier lieu, les mesures restrictives en cause sont « prévues par la loi », puisqu’elles sont énoncées dans des actes ayant notamment une portée générale et disposant d’une base juridique claire en droit de l’Union ainsi que d’une prévisibilité suffisante.
195 En deuxième lieu, les actes attaqués s’appliquent pour une durée déterminée et font l’objet d’un suivi constant, comme cela est prévu à l’article 8, deuxième alinéa, de la décision 2023/891. Dès lors que lesdites mesures sont temporaires et réversibles, il y a lieu de considérer qu’elles ne portent pas atteinte au contenu essentiel des libertés invoquées. En outre, la décision 2023/891 et le règlement 2023/888 prévoient la possibilité d’accorder des dérogations aux mesures restrictives appliquées. En particulier, concernant les gels des fonds et des ressources économiques, l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la décision 2023/891 et l’article 3, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 2, l’article 5, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2023/888 prévoient la possibilité, d’une part, d’autoriser l’utilisation de fonds gelés pour faire face à des besoins essentiels ou pour satisfaire à certains engagements et, d’autre part, d’accorder des autorisations spécifiques permettant de dégeler des fonds, d’autres avoirs financiers ou d’autres ressources économiques.
196 En troisième lieu, les mesures restrictives en cause répondent à un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union, de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs. En effet, elles visent à apporter un soutien aux autorités moldaves face aux actions de déstabilisation auxquelles elles sont confrontées et qui sont susceptibles de faire obstacle à l’adhésion de cet État à l’Union, en ciblant, notamment, les personnes qui représentent une menace pour la démocratie et l’État de droit en République de Moldavie.
197 En quatrième lieu, s’agissant du caractère approprié des mesures restrictives en cause, il convient de relever que, au regard d’objectifs d’intérêt général aussi fondamentaux que ceux mentionnés au point 196 ci-dessus, celles-ci ne sauraient, en tant que telles, passer pour inadéquates. Par ailleurs, le requérant n’a pas fait valoir que des mesures moins contraignantes auraient permis d’atteindre aussi efficacement les objectifs poursuivis.
198 Dans ce cadre, les inconvénients causés au requérant ne sauraient être regardés comme étant démesurés par rapport à l’importance des objectifs poursuivis par les actes attaqués.
199 À cet égard, doit être écarté l’argument selon lequel l’adoption de mesures restrictives à l’égard de membres de partis politiques d’opposition ne permettrait pas de soutenir l’État de droit en République de Moldavie. De même, l’argument du requérant selon lequel, en tant qu’homme politique, il est normal qu’il fasse des déclarations et participe à des débats dont les opinions ne seront pas partagées par tous, mais auront pour but de promouvoir et d’associer les citoyens au processus de décision politique quant à l’avenir de leur région et pays, doit être rejeté. En effet, les mesures restrictives en cause ont été adoptées non pas au motif que le requérant était membre d’un parti politique d’opposition ou s’était exprimé contre le gouvernement en place, mais parce qu’il avait activement participé à la diffusion de la désinformation et à l’incitation à la violence et à la peur auprès de la population gagaouze au sujet d’une perte potentielle d’autonomie provoquée par les autorités de Chișinău, ce qui constituait un soutien aux actions compromettant ou menaçant la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie ainsi que la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité dans cet État.
200 Au demeurant, les mesures restrictives adoptées à l’encontre du requérant ne font pas irrémédiablement obstacle à ce qu’il poursuive une activité politique d’opposition en République de Moldavie, le cas échéant en faisant des déclarations critiques à l’égard du gouvernement actuel.
201 Partant, le quatrième moyen doit être écarté comme étant non fondé. Au vu de ce qui précède, les conclusions en annulation doivent être rejetées.
B. Sur les conclusions indemnitaires
202 Le requérant demande au Tribunal de condamner le Conseil à réparer le préjudice porté à sa réputation du fait de l’adoption des actes attaqués en lui versant une somme d’un montant de 100 000 euros à titre provisionnel.
203 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
204 Il y a lieu de rappeler que la responsabilité non contractuelle de l’Union ne saurait être engagée que si la partie requérante a effectivement subi un préjudice « réel et certain » et, à cet égard, il incombe à l’intéressé d’apporter des preuves concluantes tant de l’existence que de l’étendue du préjudice allégué (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil , C‑45/15 P, EU:C:2017:402, points 61 et 62).
205 En l’occurrence, le requérant s’est borné à alléguer que les actes attaqués avaient porté atteinte à sa réputation, sans produire aucun commencement de preuve de l’existence et de l’étendue d’un tel préjudice.
206 Partant, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
207 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les demandes de mesures d’organisation de la procédure que le requérant a sollicitées, le Tribunal étant suffisamment éclairé par les éléments versés au dossier pour statuer sur le litige.
IV. Sur les dépens
208 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, le requérant ayant succombé, il convient de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Victor Petrov est condamné aux dépens.
Svenningsen
Mac Eochaidh
Martín y Pérez de Nanclares
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juillet 2025.
Le greffier
Le président
V. Di Bucci
M. van der Woude
Table des matières
I. Antécédents du litige
II. Conclusions des parties
III. En droit
A. Sur les conclusions en annulation
1. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation
2. Sur le premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité de la décision 2023/891 et du règlement 2023/888
a) Sur la compétence du Tribunal
b) Sur la première branche du premier moyen, tirée du défaut de base juridique de la décision 2023/891 et du règlement 2023/888, la quatrième branche du premier moyen, tirée d’un détournement de pouvoir, et la cinquième branche du premier moyen, tirée de violations de l’article 2, de l’article 8 et de l’article 21, paragraphe 1, TUE
c) Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation du principe de proportionnalité
d) Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de la violation du principe de sécurité juridique
3. Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs d’appréciation
a) Sur les éléments de preuve pris en considération par le Conseil
1) Sur le type de preuves pris en considération par le Conseil
2) Sur la fiabilité des preuves contenues dans le document WK 563/2024
b) Sur le bien-fondé des motifs justifiant le maintien du nom du requérant sur les listes en cause au titre du critère i)
1) Sur le site Internet « gagauznews.com »
2) Sur les déclarations du requérant
3) Conclusion sur le faisceau d’indices produit par le Conseil
4) Sur la responsabilité du requérant dans la réalisation d’actions compromettant ou menaçant la démocratie, l’État de droit et la stabilité en République de Moldavie
4. Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux
B. Sur les conclusions indemnitaires
IV. Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
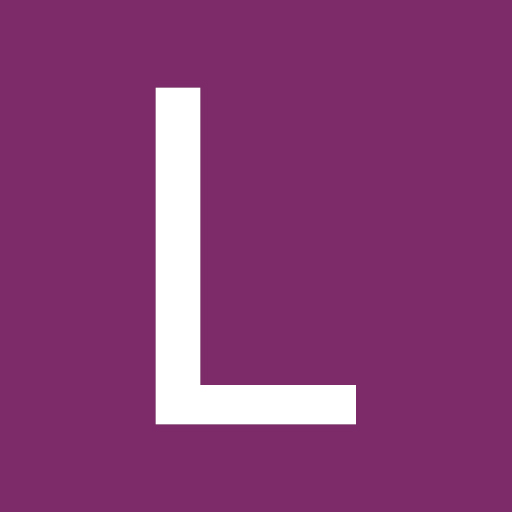
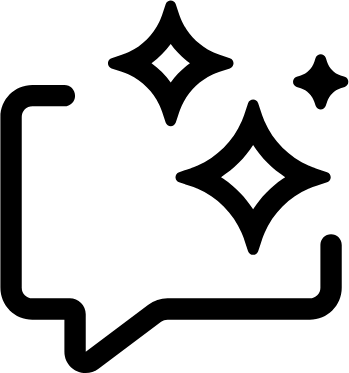 LEXI - AI Legal Assistant
LEXI - AI Legal Assistant