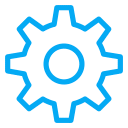HASLE c. FRANCE
Doc ref: 36556/19 • ECHR ID: 001-218716
Document date: July 6, 2022
- Inbound citations: 0
- •
- Cited paragraphs: 0
- •
- Outbound citations: 3
Publié le 25 juillet 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête n o 36556/19 Nicolas HASLE contre la France introduite le 2 juillet 2019 communiquée le 6 juillet 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la vocation successorale du requérant, enfant né d’une relation extraconjugale d’Ossip Zadkine, célèbre sculpteur russe, avec A.H.
Le père du requérant est décédé en 1967, en laissant pour lui succéder son épouse V.P. en l’état de testaments confirmant la donation de la pleine propriété de l’universalité des biens composant sa succession qu’il avait consentie à celle-ci par acte notarié du 16 avril 1941. V.P. est décédée en 1981, en l’état d’un testament instituant la ville de Paris légataire universelle. En 1982, la ville de Paris a créé le musée Zadkine. Par jugement du 1 er mars 1983, le requérant a vu sa filiation paternelle judiciairement reconnue.
Après sa condamnation par la Cour dans l’affaire Mazurek c. France , n o 34406/97, CEDH 2000-II) , la France a modifié, par la loi n o 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral (la loi de 2001), sa législation et supprima les discriminations successorales applicables aux enfants adultérins.
En 2008, le requérant a engagé une première procédure contre la ville de Paris afin de se voir reconnaître un droit moral sur les œuvres de son père. Au cours de cette instance, il a revendiqué des droits patrimoniaux dans la succession de son père. Cette dernière demande a été rejetée comme étant nouvelle et en tout état de cause non fondée dès lors que les dispositions transitoires de la loi de 2001 n’étaient pas applicables à une succession déjà liquidée.
En 2015, le requérant a engagé une seconde procédure aux fins de faire reconnaître sa qualité d’héritier de son père et les droits patrimoniaux lui revenant dans la succession. Le 23 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré ses demandes irrecevables en raison de l’autorité de chose jugée. Par jugement du 19 octobre 2016, la cour d’appel de Paris a dit n’y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par le requérant à l’occasion de l’appel de ce jugement quant à la compatibilité des dispositions transitoires de la loi de 2001 avec le principe d’égalité des citoyens et le respect du droit de propriété. Le 22 novembre 2017, la cour d’appel de Paris a considéré que les demandes du requérant étaient irrecevables car prescrites, le requérant ayant revendiqué pour la première fois la reconnaissance de ses droits patrimoniaux en 2010, soit plus de trente ans après sa majorité, alors que les dispositions transitoires de la loi de 2001 ne comportent aucune disposition modificative des règles de prescription. Le 30 janvier 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant, considérant que « son exclusion du bénéfice de la loi de 2001, qui poursuit le but légitime de garantir le principe de sécurité juridique et les droits acquis de longue date par les héritiers, n’a pas porté une atteinte excessive à ses droits garantis par les articles 8 et 14 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 ».
Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 et l’article 8 de la Convention, pris isolément et combinés avec l’article 14, le requérant soutient que le refus de lui reconnaître des droits patrimoniaux sur la succession de son père plus de dix-huit ans après la modification de la loi française consacrant l’égalité successorale entre tous les enfants constitue une discrimination injustifiée.
QUESTIONS AUX PARTIES
À la lumière des arrêts Mazurek c. France (n o 34406/97, CEDH 2000-II), Fabris c. France ([GC], n o 16574/08, CEDH 2013 (extraits)) et Quilichini c. France (n o 38299/15, 14 mars 2019), l’exclusion du requérant de la succession de son père, sur le fondement de dispositions du code civil antérieures à la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, porte ‑ elle atteinte à ses droits garantis par les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, combinés avec l’article 14 de la Convention ?
Dans l’affirmative, cette atteinte a-t-elle été disproportionnée au regard desdites dispositions de la Convention et/ou de l’article 1 du Protocole n o 1 ?
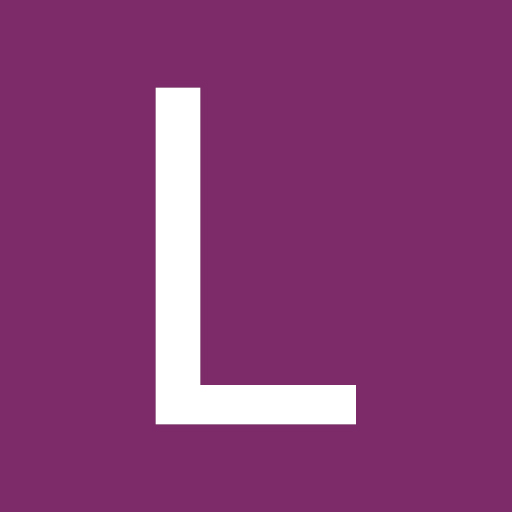
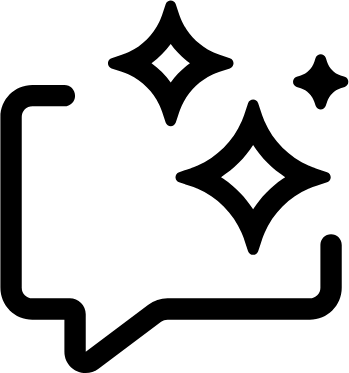 LEXI - AI Legal Assistant
LEXI - AI Legal Assistant