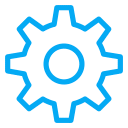BOZCAADA KIMISIS TEODOKU RUM ORTODOKS KILISESI VAKFI v. TURKEY
Doc ref: 22522/03;28903/03;28904/03;28906/03;28907/03;28908/03;28909/03;28910/03 • ECHR ID: 001-90913
Document date: December 9, 2008
- Inbound citations: 0
- •
- Cited paragraphs: 0
- •
- Outbound citations: 4
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de s requête s n os 22522/03, 28903/03, 28904/03, 28906/03, 28907/03, 28908/03, 28909/03 et 28910/03 présentée s par BOZCAADA KİMİSİS TEODOKU RUM ORTODOKS KİLİSESİ VAKFI contre la Turquie
La Cour européenne des d roits de l ’ h omme (deuxième section) , siégeant le 9 décembre 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens , présidente, Ireneu Cabral Barreto , Vladimiro Zagrebelsky , Danutė Jočienė , András Sajó , Nona Tsotsoria , Işıl Karakaş , juges, et de Sally Dollé , greffière de section ,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 3 juin 2003 (n o 22522/03 concernant la parcelle n o 532/43), le 18 juin 2003 (n o 22522/03 concernant la parcelle n o 474/38) et le 21 juillet 2003 (n os 28903/03, 28904/03, 28906/03, 28907/03, 28908/03, 28909/03 et 28910/03),
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı (Fondation de l ’ Eglise orthodoxe grecque Bozcaada Kimisis Teodoku), est une fondation de droit turc située à Çanakkale. Son statut est conforme aux dispositions du Traité de Lausanne concernant les fondations appartenant aux minorités religieuses. Elle est représentée devant la Cour par M e A. Sakmar, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
A. Les circonstances de l ’ espèce
Les faits de la cause, tels qu ’ ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par des plans cadastraux de 1991, 1992 et 1993, il fut établi qu ’ aucun titre de propriété n ’ avait été inscrit au registre foncier au nom de la requérante concernant les parcelles sises à Bozcaada-Çanakkale. La Direction générale du registre foncier et du cadastre constata que l ’ intéressée n ’ avait pas déposé dans les délais sa déclaration sur le patrimoine de la fondation prévue par la loi n o 2762 de 1936.
La requérante n ’ ayant pas fait opposition dans le délai légal de trente jours, lesdits plans cadastraux furent publiés et devinrent définitifs.
Par une lettre du 27 novembre 2000, la Direction générale des fondations invita la requérante à saisir les tribunaux compétents en vue de l ’ inscription de ses biens immobiliers au registre foncier.
En juillet 2001, la requérante introduisit devant le tribunal cadastral de Bozcaada, pour chaque parcelle de terrain, des recours tendant à l ’ inscription des biens en question à son nom au registre foncier.
1. Faits relatifs à chacune des parcelles
Les faits relatifs à chacune des parcelles peuvent se résumer comme suit :
a) Parcelles n os 474 ‑ 38, 167 ‑ 13, 527 ‑ 38, 527 ‑ 99, 186 ‑ 4, 385 ‑ 17, 133 ‑ 28 et 107 ‑ 88 (requêtes n os 22522/03, 28903/03, 28904/03, 28906/03, 28907/03, 28908/03, 28909/03 et 28910/03)
Dans le cadre de la procédure intentée devant lui, le tribunal cadastral de Bozcaada ordonna des expertises agricoles et entendit des témoins et des experts locaux et techniques. Il recueillit les croquis cadastraux ainsi que les registres d ’ impôts et du cadastre relatifs aux biens en question.
Par des jugements rendus le 6 décembre 2001 (n o 28908/03) ainsi que le 14 janvier (n o 22522/03 – parcelle n o 474 ‑ 38 – , n os 28903/03, 28904/03, 28906/03, 28909/03 et 28910/03) et le 24 janvier 2002 (n o 28907/03), le tribunal débouta la requérante au motif qu ’ elle n ’ avait pas prouvé la possession des biens en question de manière suffisamment certaine pour pouvoir en obtenir la propriété par le jeu de la prescription acquisitive. Il releva tout d ’ abord que la fondation, qui était dotée de la personnalité juridique, disposait de la capacité d ’ acquérir des biens immobiliers. Cependant, il observa que les biens en question n ’ étaient pas inscrits au registre foncier et que la fondation n ’ était que simple demanderesse. A cet égard, le tribunal souligna que la possession alléguée ne résultait d ’ aucun acte concret. S ’ agissant des champs agricoles (parcelles n os 474 ‑ 38, 167 ‑ 13, 527 ‑ 38, 527 ‑ 99, 186 ‑ 4, 385 ‑ 17, 133 ‑ 28 et 107 ‑ 88), l ’ expertise agricole avait établi qu ’ ils n ’ avaient pas été cultivés depuis de longues années. Quant à l ’ ancien monastère, l ’ objet de la requête n o 28907/03 (parcelle n o 186 ‑ 4), le tribunal constata que, selon les experts locaux, ledit immeuble était en ruine et abandonné depuis plus de dix ans.
Par ailleurs, s ’ agissant des parcelles n os 474 ‑ 38, 385 ‑ 17 et 133 ‑ 28, compte tenu de l ’ absence de documents ou de témoins susceptibles de confirmer un acte de location, le tribunal n ’ accueillit pas la thèse selon laquelle les biens en question se trouvaient en possession de la fondation, qui aurait exercé son droit de propriété en les louant à des tiers. Le tribunal conclut que, faute de possession véritable, les quittances des t ax es foncières payées par la requérante ne suffisaient pas à établir un droit de propriété sur les biens question. En outre, s ’ agissant de la parcelle n o 385 ‑ 17, il constata qu ’ il n ’ était pas établi que les documents produits par la requérante concernant les quittances des t ax es foncières concernaient le bien en question et indiqua qu ’ il en allait de même s ’ agissant des parcelles n os 167 ‑ 13, 527 ‑ 38 et 527 ‑ 99.
Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation. Celle-ci précisa également qu ’ en droit interne, la législation ne permettait pas aux fondations d ’ acquérir la propriété par prescription acquisitive.
b) Parcelle n o 532-43 (requête n o 22522/03)
En ce qui concerne la parcelle n o 532-43, par un jugement du 28 mars 2002, le tribunal débouta la requérante au motif que les conditions d ’ acquisition de la propriété par voie de possession n ’ étaient pas réunies et ordonna l ’ inscription du bien au nom d ’ H.E, partie intervenante au procès, qui avait acquis le bien en question et le terrain contigu à titre onéreux vingt-cinq ans auparavant et était restée en possession du bien litigieux pendant plus de vingt ans.
Le 17 octobre 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante et confirma ainsi le jugement de première instance.
2. Détails de la procédure
Les détails de la procédure suivie devant les juridictions nationales figurent dans le tableau ci-dessous :
REQUÊTES
PARCELLES
DATE DU PLAN CADASTRAL
DATE DE LA SAISINE DU TRIBUNAL CADASTRAL
DATE DE L ’ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
(rejet du pourvoi)
DATE DE L ’ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION (rejet de la demande en rectification de l ’ arrêt)
DATE DE LA NOTIFI-
CATION
22522/03
22522/03
474 – 38
532 – 43
22/6/1992
1/4/1993
30/7/2001
30/7/2001
29/4/2002
17/10/2002
15/11/2002
-------------
23/12/2002
4/12/2002
28903/03
167 – 13
31/5/1991
6/7/2001
29/4/2002
27/12/2002
24/01/2003
28904/03
527 – 38
1/4/1993
30/7/2001
9/5/2002
30/12/2002
7/2/2003
28906/03
527 – 99
1/4/1993
30/7/2001
7/5/2002
30/12/2002
7/2/2003
28907/03
186 – 4
31/5/1991
30/7/2001
7/5/2002
30/12/2002
7/2/2003
28908/03
385 – 17
16/6/1992
30/7/2001
11/4/2002
30/12/2002
7/2/2003
28909/03
133 – 28
31/5/1991
6/7/2001
29/4/2002
27/12/2002
28/1/2003
28910/03
107 – 88
30/5/1991
6/7/2001
29/4/2002
30/12/2002
7/2/2003
3. Saisine des tribunaux administratifs
Entre-temps, la loi n o 4771 du 9 août 2002 était entrée en vigueur et ouvrait aux fondations la possibilité de demander l ’ inscription au registre foncier des biens immeubles dont la possession était établie.
Le 13 janvier 2003, sur le fondement de l ’ article 4 de ladite loi, la requérante introduisit auprès de la Direction générale des fondations une demande visant à l ’ inscription des biens en question au registre foncier à son nom. Cependant, sa demande fut rejetée le 26 mars 2006 au motif que les biens étaient inscrits au registre foncier au nom du Trésor ou de tierces personnes.
Par un jugement du 6 mai 2004, le tribunal administratif d ’ Ankara rejeta le recours en annulation de la décision susmentionnée introduit par la requérante. Le tribunal considéra notamment que lorsque des biens litigieux étaient inscrits au registre foncier au nom de tierces personnes ou du Trésor ou qu ’ un litige portant sur le titre de propriété demeurait pendant devant les instances internes, l ’ administration ne pouvait procéder à l ’ inscription des biens en cause au nom de prétendu possesseur.
Le 30 mai 2007, le Conseil d ’ Etat confirma le jugement de première instance.
Le 8 novembre 2007, la requérante forma un recours en rectification de l ’ arrêt du 30 mai 2007. Cette procédure est toujours pendante devant le Conseil d ’ Etat.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l ’ arrêt Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı c. Turquie (n o 34478/97, §§ 23 ‑ 30 , CEDH 2007 ‑ ... ).
La législation régissant le statut des fondations subit une modification en 2002. L ’ article 4 de la loi n o 4771 du 9 août 2002 dispose comme suit :
« A. Les alinéas ci-dessous sont ajoutés à la fin de l ’ article 1 de la loi n o 2762 du 5 juin 1935 sur les fondations.
Les fondations des minorités religieuses, qu ’ elles soient ou non dotées de statuts, peuvent acquérir ou posséder des biens immeubles, avec l ’ autorisation du Conseil des ministres, pour faire face à leurs besoins dans les domaines religieux, de bienfaisance, sociaux, éducatifs, sanitaires et culturels.
Si la demande est introduite dans les six mois à partir de l ’ entrée en vigueur de la présente loi, les biens immeubles dont la possession, sous quelque forme que ce soit, est établie par des registres fiscaux, des baux ou autres documents, sont inscrits au registre foncier au nom de la fondation pour faire face aux besoins de cette dernière dans les domaines religieux, de bienfaisance, sociaux, éducatifs, sanitaires et culturels. Les biens qui ont été donnés ou légués à la fondation sont soumis aux dispositions de cet article. »
Par ailleurs, l ’ article 3 de la loi n o 4778 du 2 janvier 2003 prévoit que les « fondations des minorités religieuses » peuvent désormais acquérir des biens immobiliers et en disposer et ce, qu ’ elles soient ou non dotées de statuts (acte de fondation).
De nombreuses modifications à la législation régissant les fondations ont été apportées par les lois n o 4771 du 9 août 2002 et n o 4778 du 2 janvier 2003, ainsi que par le règlement du 24 janvier 2003 relatif à l ’ acquisition de biens immeubles par les fondations des communautés.
La loi n o 5737 sur les fondations, adoptée le 20 février 2008 et publiée au Journal officiel le 27 février 2008, a abrogé la loi n o 2762 sur les fondations.
Aux termes de l ’ article 13 de la loi sur le cadastre, un bien immobilier non encore inscrit est inscrit au registre foncier au nom de celui qui prouve, au moyen de documents, d ’ expertises ou de déclarations de témoins, l ’ avoir possédé à titre de propriétaire, sans interruption et paisiblement, pendant plus de vingt ans.
GRIEFS
La requérante soutient qu ’ en refusant l ’ inscription de ses biens immobiliers au registre foncier, les juridictions internes ont violé son droit au respect de ses biens. Elle prétend que la législation et son interprétation par les juridictions nationales impliquent, pour des fondations appartenant à des minorités religieuses non musulmanes au sens du Traité de Lausanne, l ’ incapacité d ’ acquérir des biens immobiliers. Elle estime que cette incapacité constitue une discrimination par rapport aux autres fondations. Elle invoque à ces égards l ’ article 14 de la Convention et l ’ article 1 du Protocole n o 1.
Invoquant l ’ article 9 de la Convention, la requérante se plaint également d ’ une atteinte à sa liberté de culte.
EN DROIT
A titre préliminaire, la Cour constate que les huit requêtes sont similaires en ce qui concerne les faits et les griefs soulevés. En conséquence, elle juge approprié de procéder à leur jonction, en application de l ’ article 42 § 1 du règlement.
La requérante, invoquant l ’ article 14 de la Convention et l ’ article 1 du Protocole n o 1, se plaint du refus de sa demande tendant à l ’ inscription au registre foncier des biens immobiliers dont elle était possesseur. Par ailleurs, invoquant l ’ article 9 de la Convention, elle se plaint d ’ une atteinte à sa liberté de culte.
Le Gouvernement excipe pour sa part du non-respect du délai de six mois et du non-épuisement des voies de recours internes.
La Cour n ’ estime pas nécessaire d ’ examiner en l ’ espèce la question de savoir si la requérante a satisfait à la condition relative à l ’ épuisement des voies de recours internes ou au respect du délai de six mois, les requêtes étant en tout état de cause irrecevables pour les motifs indiqués ci-dessous.
La requérante soutient qu ’ à la suite de la demande de la Direction générale des fondations, elle avait introduit devant le tribunal compétent des recours tendant à l ’ inscription de ses biens immobiliers au registre foncier à son nom. Pour ce faire, elle s ’ était fondée notamment sur le critère de la possession sans interruption. Selon elle, les preuves présentées à l ’ appui de son action, en particulier les quittances des t ax es foncières et les déclarations des experts locaux, établissaient suffisamment sa qualité de propriétaire prima facie des biens en question. En effet, elle affirme qu ’ elle possédait lesdits biens depuis près d ’ un siècle et qu ’ elle pouvait ainsi légitimement espérer obtenir gain de cause, de sorte que l ’ article 1 du Protocole n o 1 était bien applicable en l ’ affaire. Ce n ’ est que par une appréciation arbitraire des preuves en présence que les tribunaux auraient choisi de s ’ appuyer, au contraire, sur les expertises agricoles pour la débouter de son action. En lui faisant ainsi porter un fardeau excessif quant à l ’ administration de la preuve, les juridictions internes auraient donc porté atteinte à son droit au respect de ses biens.
Le Gouvernement observe que la requérante, en tant que demanderesse, n ’ a pas su assumer le fardeau de la preuve et démontrer son droit de propriété. Selon lui, les éléments de preuve présentés par la requérante ne sauraient suffire à établir une possession ou un droit de propriété. Se référant aux principes de la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement soutient que les griefs de la requérante sont manifestement mal fondés, puisque l ’ intéressée ne pouvait se prévaloir d ’ avoir disposé de « biens actuels ». Il ajoute qu ’ elle n ’ avait pas davantage d ’ « espérance légitime » de voir ses recours aboutir.
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l ’ article 1 du Protocole n o 1 ne vaut que pour les biens actuels. Un attribut futur ne peut ainsi être considéré comme un « bien » que s ’ il a déjà été gagné ou s ’ il fait l ’ objet d ’ une créance certaine. En outre, l ’ espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l ’ on est dans l ’ impossibilité d ’ exercer effectivement ne peut non plus être considéré comme un « bien », et il en va de même d ’ une créance conditionnelle s ’ éteignant du fait de la non-réalisation de la condition (voir Gratzinger et Gratzingerová c. République tchèque (déc.) [GC], n o 39794/98, § 69, CEDH 2002 ‑ VII). Cependant, dans certaines circonstances, l ’ « espérance légitime » d ’ obtenir une valeur patrimoniale peut également bénéficier de la protection de l ’ article 1 du Protocole n o 1. Ainsi, lorsque l ’ intérêt patrimonial est de l ’ ordre de la créance, l ’ on peut considérer que l ’ intéressé dispose d ’ une espérance légitime si un tel intérêt présente une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu ’ il est confirmé par une jurisprudence bien établie des tribunaux. Toutefois, on ne peut conclure à l ’ existence d ’ une « espérance légitime » lorsqu ’ il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales (voir Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, §§ 50 et 52, CEDH 2004 ‑ IX ).
D ’ emblée, la Cour observe que la présente espèce se distingue de l ’ affaire Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı précitée, où la controverse portait sur l ’ annulation des titres de propriété des biens immobiliers appartenant à une fondation, en application d ’ une jurisprudence en vertu de laquelle les fondations ne disposent pas de la capacité d ’ acquérir des biens immeubles. En l ’ espèce, il ne fait pas de doute que la requérante, fondation appartenant à une minorité religieuse, est dotée de cette capacité. La question principale que la Cour est appelée à trancher est de savoir si en refusant l ’ inscription des biens immobiliers de l ’ intéressée au registre foncier, les juridictions internes ont violé le droit de celle-ci au respect de ses biens.
A cet égard, la Cour relève qu ’ en introduisant des recours, la requérante espérait obtenir les titres de propriété des biens en question qu ’ elle prétendait posséder sans interruption depuis plus de vingt ans. Toutefois, l ’ espoir que les juridictions nationales trancheraient en sa faveur ne peut pas être considéré comme une forme d ’ « espérance légitime » au sens de l ’ article 1 du Protocole n o 1. Comme la Cour l ’ a énoncé à de multiples reprises, il y a une différence entre un simple espoir, aussi compréhensible soit-il, et une espérance légitime, qui doit être de nature plus concrète et se fonder sur une disposition légale ou avoir une base jurisprudentielle solide en droit interne (voir Kopecký , précité, § 52).
A cet égard, l ’ intéressée se plaint de l ’ issue des procédures introduites contre le Trésor pour revendiquer des titres de propriété dont elle prétendait qu ’ ils étaient siens. Or les procédures en question ne portaient pas sur un « bien actuel », la requérante ne se trouvant que dans la position de simple demanderesse (voir, mutatis mutandis , Gratzinger et Gratzingerová, décision précitée, ainsi que Glaser c. République tchèque , n o 55179/00, § 54, CEDH 2008 ‑ ... ).
Dans ses jugements, le tribunal du cadastre, après avoir ordonné des expertises agricoles et entendu des témoins ainsi que des experts locaux et techniques, et après avoir examiné un certain nombre de documents dont les croquis cadastraux, les registres d ’ impôts et du cadastre relatifs aux biens en question présentés par les parties ou recueillis d ’ office, a conclu que les conditions d ’ acquisition de la propriété par voie de possession n ’ étaient pas réunies. Il a en particulier relevé que la possession alléguée ne résultait d ’ aucun acte concret. En effet, les champs agricoles n ’ avaient pas été cultivés depuis des longues années ou n ’ étaient pas loués à des tierces personnes par la requérante. L ’ ancien monastère en ruine était abandonné. Par ailleurs, il n ’ était pas établi que l ’ ensemble des quittances des t ax es foncières présentées par la requérante concernaient les biens en cause. De même, s ’ agissant de la parcelle n o 532-43, le tribunal a ordonné son inscription au nom d ’ une tierce personne, considérant que cette dernière, qui avait acquis le bien en question et le terrain avoisinant, l ’ avait possédé pendant plus de vingt ans .
La Cour relève que dans le cas d ’ espèce, la requérante se plaint essentiellement de la manière dont les tribunaux nationaux ont appréhendé la question centrale du litige, à savoir sa qualité de possesseur, et apprécié les preuves qu ’ elle a produites dans la limite des moyens dont elle disposait. La Cour estime qu ’ il s ’ agit là de questions qui relèvent a priori de l ’ appréciation des juridictions nationales. Ces dernières, après avoir examiné minutieusement les faits de la cause et les arguments des parties, ont conclu que la requérante n ’ avait pas prouvé la possession des biens en question de manière suffisamment certaine pour en obtenir la propriété par le jeu de la prescription acquisitive. Rappelant sa compétence limitée pour connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les tribunaux internes, la Cour n ’ aperçoit aucune apparence d ’ arbitraire dans la manière dont les juridictions internes ont statué sur les demandes de la requérante.
A la lumière de ces considérations, la requérante ne peut être regardée comme ayant montré qu ’ elle était titulaire d ’ une créance suffisamment établie pour être exigible, et ne peut donc pas se prévaloir de l ’ existence de « biens » au sens de l ’ article 1 du Protocole n o 1. Dès lors, les décisions des tribunaux nationaux rendues sur les recours concernés n ’ ont pu constituer une ingérence dans la jouissance des biens de l ’ intéressée. Il s ’ ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l ’ article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
En ce qui concerne les griefs tirés de l ’ article 14, combiné avec l ’ article 1 du Protocole n o 1 et l ’ article 9 de la Convention, la Cour observe qu ’ ils ne sont pas étayés par la requérante. Au surplus, elle relève qu ’ il ne ressort pas du dossier que la requérante ait soulevé ces griefs, expressément ou en substance, devant les juridictions nationales saisies. Il s ’ ensuit qu ’ au vu du dossier et dans la mesure où les griefs ne sont pas étayés, cette partie de la requête doit également être rejetée comme manifestement mal fondée , en application de l ’ article 35 § § 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l ’ unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Sally Dollé Françoise Tulkens Greffière Présidente
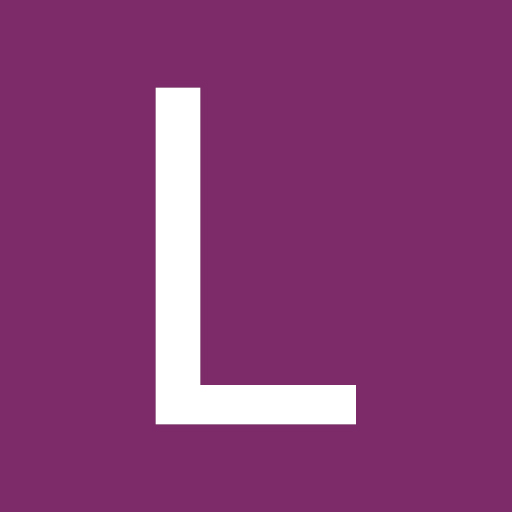
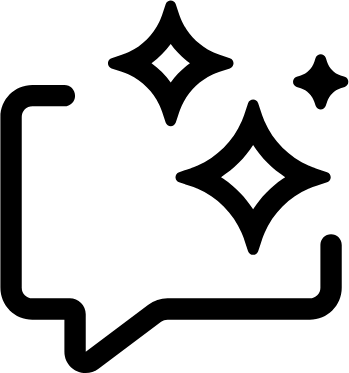 LEXI - AI Legal Assistant
LEXI - AI Legal Assistant