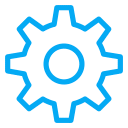Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 19 November 2025.
DI v European Parliament.
• 62024TJ0173 • ECLI:EU:T:2025:1044
- Inbound citations: 0
- •
- Cited paragraphs: 0
- •
- Outbound citations: 11
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
19 novembre 2025 ( * )
« Droit institutionnel – Membre du Parlement – Harcèlement moral – Décisions de la présidente du Parlement concluant à l’existence d’un harcèlement moral à l’égard d’un assistant parlementaire accrédité et infligeant un blâme à un membre du Parlement – Droits de la défense – Principe de bonne administration – Délais de procédure – Détournement de pouvoir – Notion de “harcèlement” – Article 12 bis du statut – Erreur d’appréciation »
Dans l’affaire T‑173/24,
DI, représenté par M es S. Rodríguez Bajón et A. Gómez-Acebo Dennes, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M mes E. Despotopoulou, D. Boytha et M. I. Lázaro Betancor, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé, lors des délibérations, de M. R. da Silva Passos, président, M mes I. Reine et T. Pynnä (rapporteure), juges,
greffier : M me P. Núñez Ruiz, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 8 mai 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, DI, demande l’annulation des décisions de la présidente du Parlement européen du 30 janvier 2024 par lesquelles cette dernière, premièrement, a considéré que certains comportements invoqués à son égard, pris individuellement et dans leur ensemble, étaient constitutifs, au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), d’un harcèlement moral (ci-après la « décision constatant le harcèlement ») et, deuxièmement, lui a imposé un blâme (ci-après la « décision sur la sanction »).
I. Antécédents du litige
2 Le requérant a été membre du Parlement durant la législature 2019-2024.
3 Le 18 juillet 2022, une personne (ci-après le « plaignant ») exerçant les fonctions d’assistant parlementaire accrédité (ci-après l’« APA ») auprès du requérant a présenté contre ce dernier une plainte sous forme de demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut pour harcèlement moral, devant la direction générale (DG) du personnel du Parlement.
4 La DG du personnel a procédé à une étude préliminaire sur les faits allégués par le plaignant. Dans ce contexte, le plaignant a été auditionné le 26 août 2022.
5 Le 31 août 2022, la DG du personnel a transmis au comité consultatif du Parlement chargé d’examiner les plaintes pour harcèlement (ci-après le « comité ») son étude préliminaire afin d’établir l’existence d’un commencement de preuve de harcèlement moral.
6 Le 15 septembre 2022, le plaignant a complété sa plainte avec de nouveaux éléments de preuve.
7 Le 11 octobre 2022, le comité a décidé d’ouvrir une enquête et a fourni au requérant un résumé de la plainte et des preuves non confidentielles servant de fondement à la plainte.
8 Le 24 octobre 2022, le requérant a transmis ses observations écrites sur le résumé de la plainte et sur les preuves fournies.
9 Le 15 novembre 2022, le requérant a comparu devant le comité.
10 Le 6 janvier 2023, le plaignant a transmis une réponse à une demande d’informations supplémentaires du Parlement.
11 Le 8 mars 2023, le comité a rendu son rapport final.
12 Le 3 mai 2023, la présidente du Parlement a transmis une version non confidentielle du rapport du comité au requérant.
13 Le 7 juin 2023, la présidente du Parlement a entendu le requérant sur le rapport du comité.
14 Le 29 juin 2023, le Parlement a envoyé une version non confidentielle du rapport du comité, traduite en espagnol, au requérant.
15 Le 20 juillet 2023, le requérant a soumis ses observations à la présidente du Parlement. Celles-ci ont été traduites, puis transmises au comité, qui les a examinées lors de ses réunions des 26 septembre et 11 octobre 2023.
16 Le 12 octobre 2023, le comité a donné son avis à la présidente du Parlement sur les observations du requérant.
17 Le 30 janvier 2024, la présidente du Parlement a adopté la décision constatant le harcèlement et la décision sur la sanction (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »). Dans la décision constatant le harcèlement, la présidente du Parlement a considéré que le requérant avait commis un harcèlement moral à l’égard du plaignant en ce que, premièrement, il avait exigé de celui-ci une disponibilité 24h/24 et 7j/7, y compris pendant les jours fériés et les congés, deuxièmement, il lui avait adressé à plusieurs reprises des commentaires menaçants, insultants ou blessants, troisièmement, il lui avait demandé de réaliser des tâches domestiques étrangères à ses fonctions et, quatrièmement, il lui avait donné un ordre contradictoire. Dans la décision sur la sanction, la présidente du Parlement a infligé au requérant la sanction de blâme en raison de son comportement envers le plaignant.
18 Le 28 février 2024, la décision sur la sanction a été prononcée en séance plénière par la présidente du Parlement.
II. Conclusions des parties
19 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions attaquées ;
– annuler « tout acte ou toute action lié(e) » aux décisions attaquées ;
– condamner le Parlement aux dépens.
20 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
III. En droit
21 Au soutien de son recours, le requérant soulève cinq moyens, tirés, le premier, d’une violation des droits de la défense et du droit à une bonne administration, le deuxième, d’un non-respect des délais de procédure, le troisième, d’un détournement de pouvoir, le quatrième, d’erreurs d’appréciation et, le cinquième, d’une violation de l’obligation de confidentialité en raison de fuites concernant l’enquête du comité.
A. Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions
22 Par son deuxième chef de conclusions, le requérant demande l’annulation de « tout acte ou toute action lié(e) » aux décisions attaquées, à savoir ceux fondés sur celles-ci.
23 Le Parlement considère que le deuxième chef de conclusions doit être rejeté comme irrecevable, car il incombe au requérant d’identifier avec précision les actes dont il demande l’annulation par le Tribunal.
24 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel, le cas échéant, sans autres informations à l’appui (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2024, RS/BEI, T‑624/22, non publié, EU:T:2024:461, point 49).
25 En l’espèce, le requérant n’identifie pas d’autre acte lié aux décisions attaquées que la lecture publique de la sanction lui ayant été infligée. Selon lui, l’annulation ou la révocation de ladite lecture serait seulement une conséquence de l’annulation des décisions attaquées.
26 Le requérant n’a pas identifié, dans la requête, les actes visés par son deuxième chef de conclusions, de sorte que ce chef de conclusions doit être déclaré irrecevable pour manque de précision quant à son objet. S’agissant des précisions apportées au stade de la réplique, celles-ci sont tardives. Elles ne sauraient donc pallier le manque de précision constaté.
27 Par conséquent, le deuxième chef de conclusions doit être rejeté comme étant irrecevable.
B. Sur le premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense et du droit à une bonne administration
28 Par son premier moyen, le requérant soutient que, à plusieurs reprises, lors du déroulement de la procédure, ses droits de la défense tels que prévus à l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que son droit à une bonne administration prévu à l’article 41 de la Charte n’ont pas été respectés par le comité. Le premier moyen comporte, en substance, six branches.
29 Premièrement, la décision du comité d’appeler seulement un des cinq témoins que le requérant avait proposés aurait violé ses droits de la défense. Les témoignages proposés auraient été pertinents et importants pour sa défense, car les témoins auraient fait partie de son équipe et auraient été directement liés aux faits de la présente affaire.
30 Deuxièmement, le comité aurait dû indiquer la raison pour laquelle il avait rejeté quatre des témoins proposés par le requérant.
31 Troisièmement, le requérant fait valoir que l’appréciation selon laquelle la déclaration du témoin qu’il avait proposé n’était pas crédible compte tenu de sa situation professionnelle aurait dû également s’appliquer aux témoins proposés par le plaignant.
32 Quatrièmement, le requérant considère qu’il n’a pas eu la possibilité de prendre connaissance de certaines preuves fournies par le plaignant relatives à ses allégations concernant la réalisation de tâches domestiques. Il ressortirait du rapport du comité que le plaignant aurait élargi sa plainte dans son mémoire du 6 janvier 2023 en introduisant de nouveaux éléments factuels relatifs à la réalisation de tâches étrangères à ses fonctions. Le requérant n’en aurait pris connaissance que lorsqu’il aurait reçu le rapport du comité. Ainsi, le requérant n’aurait pas pu élaborer une défense efficace pour réfuter ces nouveaux éléments.
33 Cinquièmement, le requérant estime qu’il n’a pas eu la possibilité de développer sa défense dans la même mesure que le plaignant. Ce dernier aurait complété sa plainte le 15 septembre 2022 alors que l’étude préliminaire avait déjà été présentée au comité. Le requérant n’aurait pas bénéficié d’autant de possibilités pour actualiser ses arguments.
34 Sixièmement, le requérant considère qu’il n’a pas pu prendre connaissance du procès-verbal ou, à tout le moins, d’un résumé des déclarations des témoins entendus par le comité. Le rapport du comité ne comporterait pas la transcription même partielle des déclarations des témoins. Dans l’annexe II de la version non confidentielle envoyée au requérant, le résumé de leur comparution aurait été supprimé. Par conséquent, le requérant n’aurait pas pu formuler de manière efficace ses observations.
35 Le Parlement conteste cette argumentation.
1. Sur l’applicabilité de l’article 48 , paragraphe 2, de la Charte
36 Selon le Parlement, le requérant n’est pas recevable à invoquer un grief tiré de la violation des droits de la défense au sens de l’article 48 de la Charte lorsqu’est en cause la procédure devant le comité.
37 Pour l’ensemble de ce moyen, le requérant invoque une violation de ses droits de la défense consacrés à l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, et de son droit à une bonne administration, consacré à l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la Charte.
38 À cet égard, le Tribunal a déjà constaté que la procédure en cause ne présentait pas un caractère pénal, de sorte que l’article 48, paragraphe 2, de la Charte ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce (arrêt du 15 octobre 2025, VZ/Parlement, T‑223/23, non publié, EU:T:2025:958, point 59). En revanche, il ressort de la jurisprudence que le principe général du respect des droits de la défense s’applique dès lors que, comme en l’espèce, la procédure ouverte est susceptible d’aboutir, et a abouti, à une sanction à l’encontre d’un membre du Parlement pour un harcèlement (voir, en ce sens, arrêt du 3 février 2021, Moi/Parlement, T‑17/19, EU:T:2021:51, points 97 à 102 et jurisprudence citée).
39 Les droits de la défense comportent le droit d’être entendu et le droit d’accès au dossier. S’agissant plus précisément d’une procédure visant à établir l’existence d’un harcèlement, le principe général du respect des droits de la défense implique que, dans le respect d’éventuelles exigences de confidentialité, la personne mise en cause se voie, préalablement à l’adoption de la décision lui faisant grief, communiquer toutes les pièces du dossier, à charge et à décharge, concernant ledit harcèlement et qu’elle soit entendue sur celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 3 février 2021, Moi/Parlement, T‑17/19, EU:T:2021:51, points 101 et 103 et jurisprudence citée).
40 En outre, il importe de rappeler que l’article 41, paragraphe 2, sous a) et b), de la Charte, qui trouve également à s’appliquer en l’espèce, dispose que le droit à une bonne administration comporte le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise contre elle et également le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires.
41 Par conséquent, il y a lieu d’examiner si le principe général du respect des droits de la défense et l’article 41, paragraphe 2, de la Charte ont été violés en l’espèce ainsi que l’avance le requérant.
2. Sur la première branche du premier moyen, relative au refus du Parlement d’auditionner des témoins proposés par le requérant
42 Selon le requérant, quatre des témoins proposés par lui et refusés par le comité auraient été pertinents et importants pour sa défense.
43 En ce qui concerne ces témoignages proposés par le requérant et refusés par le comité, il y a lieu de noter que, selon le requérant, ces derniers auraient été pertinents pour les raisons suivantes.
44 Le premier témoin, remplaçant du plaignant, aurait eu connaissance du type de travail exigé par le poste et de l’ambiance de travail qui régnait dans l’équipe.
45 Le deuxième témoin, membre du bureau du requérant et puis cheffe de ce bureau, aurait pu rendre compte de la charge de travail et du type de relation que le requérant avait avec son équipe.
46 Le troisième témoin, cheffe des services administratifs de la délégation du parti politique du requérant, aurait su que le plaignant essayait d’obtenir un autre poste. De plus, il aurait pu préciser qu’il n’avait jamais été question de licencier le plaignant.
47 Le quatrième témoin, ami du plaignant, aurait pu attester que le plaignant s’excusait auprès de tiers en affirmant qu’il travaillait, alors que, en réalité, il participait à de nombreuses rencontres entre amis et collègues après ses journées de travail ou pendant les week-ends. Le requérant considère que ce type d’attitude aurait mis en cause la crédibilité des déclarations du plaignant.
48 À cet égard, en vertu de l’article 9, paragraphe 4, de la décision du bureau du 2 juillet 2018, relative au fonctionnement du comité et aux procédures en la matière (ci-après la « décision du bureau »), en se fondant sur l’étude préliminaire, le comité évalue notamment s’il convient d’entendre des témoins.
49 En outre, selon la jurisprudence, l’entité chargée d’une enquête administrative, à laquelle il incombe d’instruire de façon proportionnée les dossiers qui lui sont soumis, dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la conduite de l’enquête et, en particulier, l’évaluation de la qualité et de l’utilité de la coopération fournie par des témoins (voir arrêt du 3 octobre 2019, DQ e.a./Parlement, T‑730/18, EU:T:2019:725, point 77 et jurisprudence citée). Par ailleurs, elle n’est nullement tenue de convoquer tous les témoins proposés par les parties de l’affaire (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2012, Donati/BCE, F‑63/09, EU:F:2012:193, point 187).
50 À cet égard, il ressort de la décision constatant le harcèlement que le choix de ne pas entendre quatre des témoins présentés par le requérant résulte de l’examen de leur qualité et de l’utilité de leurs témoignages aux fins de la conduite de l’enquête. Ainsi que l’avance le Parlement, présentent pour le comité une utilité, au sens de la jurisprudence précitée, les témoignages des personnes qui ont observé directement les situations ayant existé entre les parties, ainsi que le comportement du membre du Parlement envers la partie plaignante, afin de vérifier les allégations formulées dans la plainte.
51 Or, en ce qui concerne les premier et deuxième témoins, le Parlement expose, sans être contredit par le requérant, que ces personnes ont été recrutées après le départ en congé de maladie du plaignant et n’ont donc pas pu assister aux interactions mentionnées dans la plainte. Concernant les troisième et quatrième témoins, le requérant ne fait pas valoir qu’ils ont assisté à des interactions mentionnées dans la plainte. De plus, le témoignage de ces derniers ne semble pas concerner concrètement des allégations formulées dans la plainte, mais plutôt les ambitions professionnelles du plaignant et la manière dont il occupait son temps libre. Partant, le comité a pu considérer valablement que la coopération de ces quatre témoins n’aurait présenté aucune utilité, au sens de la jurisprudence citée au point 49 ci-dessus, aux fins de la conduite de l’enquête.
52 Dès lors, le requérant n’est pas en mesure de démontrer que le comité aurait outrepassé son large pouvoir d’appréciation en ne recueillant pas les témoignages de ces quatre témoins.
53 À la lumière de ces considérations, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen.
3. Sur la deuxième branche du premier moyen, relative au prétendu manque de motivation du choix des témoins
54 Le requérant fait valoir que le comité aurait dû indiquer la raison pour laquelle il a rejeté quatre de ses témoins.
55 L’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte prévoit que le droit à une bonne administration comporte l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.
56 Selon l’article 10 de la décision du bureau, le comité communique au président du Parlement son avis motivé sur l’existence ou non de la situation de harcèlement alléguée.
57 Partant, il convient de considérer que le rapport du comité n’est qu’un avis sur le prétendu harcèlement destiné au président du Parlement et non pas une décision. En outre, la décision du bureau n’oblige pas le comité à motiver la conduite de sa procédure.
58 En tout état de cause, dans la décision constatant le harcèlement, la présidente du Parlement a répondu, de manière concise, à l’observation du requérant sur le manque de motivation en ce qui concerne le choix du comité de ne pas auditionner quatre des témoins proposés par lui. Elle a informé le requérant, en substance, sur le fait que le comité n’était pas tenu de convoquer tous les témoins proposés par les parties et que le choix qu’il avait fait de ne pas recueillir les témoignages de l’ensemble des témoins proposés par le requérant résultait d’un examen de la qualité et de l’utilité de ces témoignages. Ainsi, la décision constatant le harcèlement comporte une explication en ce qui concerne le choix des témoins.
59 Il s’ensuit que la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée.
4. Sur la troisième branche du premier moyen, relative à la crédibilité des témoins
60 Selon le requérant, le Parlement aurait considéré la déclaration d’un témoin proposé par lui comme n’étant pas crédible compte tenu de sa situation professionnelle et, plus précisément, du lien existant entre eux. Or, les liens existants entre un témoin et la partie concernée ne pourraient être un critère afin d’apprécier la crédibilité du premier. En outre, une telle objection aurait également dû s’appliquer aux témoins proposés par le plaignant.
61 À cet égard, il y a lieu d’observer que, au point 5.1.3 du rapport du comité, concernant les témoins, il est indiqué ce qui suit :
« Parmi les trois témoins entendus par le comité, un a été considéré comme crédible. Parmi les deux autres témoins, un témoin a été jugé partiellement crédible et un témoin n’a pas été jugé crédible, en raison de certaines contradictions flagrantes entre son témoignage et les preuves écrites ainsi que les témoignages du député et du plaignant. Lors de l’évaluation du témoignage des témoins, le comité a également tenu compte de leur situation professionnelle. »
62 À la lumière de cette constatation, l’allégation du requérant ne repose que sur des suppositions, étant donné que la crédibilité des témoins a été évaluée sur la base de leur cohérence avec les preuves écrites et avec son témoignage ainsi qu’avec celui du plaignant. Le comité ne fait pas de distinction entre les témoins en mentionnant la situation professionnelle comme un élément ayant été pris en compte.
63 Partant, la troisième branche du premier moyen doit être rejetée.
5. Sur la quatrième branche du premier moyen, relative à un manque d’accès au mémoire du 6 janvier 2023
64 Le requérant fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de se défendre face à des éléments nouveaux relatifs aux tâches domestiques présentés dans le mémoire du 6 janvier 2023, dont il a pris connaissance lorsqu’il a reçu le rapport du comité.
65 Il convient d’observer que, au point 1.1 du rapport du comité, il est indiqué que, le 16 décembre 2022, le comité a demandé des informations additionnelles au plaignant et que, le 6 janvier 2023, le plaignant a fourni sa réponse. Dans le rapport du comité, il n’y a pas d’autres références à cet échange. Dans la décision constatant le harcèlement, la présidente du Parlement a précisé que le plaignant n’avait pas présenté de nouvelles allégations ni de nouvelles preuves dans son mémoire du 6 janvier 2023.
66 À cet égard, il convient de relever que, en déposant ses observations sur le rapport du comité, le requérant a pu présenter utilement son point de vue sur les éléments que le Parlement entendait utiliser contre lui (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2022, WT/Commission, T‑91/20, non publié, EU:T:2022:510, point 67 et jurisprudence citée). En outre, le requérant ne précise ni quels étaient les éléments qu’il n’a pas pu contester avant la réception du rapport du comité ni quelle était leur pertinence pour la constatation de harcèlement.
67 Partant, la quatrième branche du premier moyen doit être rejetée.
6. Sur la cinquième branche du premier moyen, relative à l’impossibilité pour le requérant de compléter sa défense dans la même mesure que le plaignant
68 Le requérant allègue qu’il y a eu un déséquilibre entre lui et le plaignant dans les possibilités de soulever des arguments devant le comité, de sorte que le principe de l’égalité des armes aurait été méconnu. Plus précisément, le plaignant aurait pu élargir sa plainte à deux reprises alors que cette possibilité n’aurait pas été offerte au requérant dans le cadre de sa défense.
69 À cet égard, le déroulement de la procédure au comité est régi par l’article 9, paragraphe 2, de la décision du bureau, selon lequel le comité informe le membre du Parlement concerné de la plainte et lui transmet un résumé des allégations portées contre lui afin de lui permettre d’en prendre connaissance et, s’il le souhaite, de faire part de sa position et de ses arguments. Le comité laisse au membre du Parlement concerné un délai raisonnable pour répondre avant que la partie plaignante ne soit entendue par le comité. Selon l’article 9, paragraphe 3, de la décision du bureau, la partie plaignante est invitée à être entendue seule dès que possible.
70 En l’espèce, il ressort du rapport du comité que le plaignant a pu compléter sa plainte le 15 septembre 2022 et qu’il a été auditionné le 15 novembre 2022. Il ressort également dudit rapport que, le 24 octobre 2022, le requérant a transmis ses observations écrites sur le résumé de la plainte et sur les preuves et que, ensuite, le comité l’a auditionné le 15 novembre 2022. S’agissant des informations supplémentaires envoyées par le plaignant le 6 janvier 2023, il s’agit d’une réponse à une demande du comité et des informations n’ayant pas été retenues dans le rapport du comité.
71 Partant, il convient de constater que le comité a respecté les dispositions de la décision du bureau susmentionnées. En outre, le requérant n’identifie pas d’éléments concrets dans le rapport du comité sur lesquels il aurait été privé de s’exprimer lors du traitement de la plainte. Dès lors, la prétendue violation des droits de la défense n’a pas été établie et la cinquième branche du premier moyen doit être rejetée.
7. Sur la sixième branche du premier moyen, relative au refus d’accès aux déclarations des témoins
72 Le requérant fait valoir qu’il n’a pas pu prendre connaissance du procès-verbal ou d’un résumé des déclarations des témoins entendus par le comité, puisque l’annexe II du rapport du comité avait été entièrement occultée dans la version de ce rapport qui lui a été transmise.
73 Selon la jurisprudence, dans une procédure visant à établir l’existence d’un harcèlement, le principe général du respect des droits de la défense implique que, dans le respect d’éventuelles exigences de confidentialité, la personne mise en cause se voie, préalablement à l’adoption de la décision lui faisant grief, communiquer toutes les pièces du dossier, à charge et à décharge, concernant ledit harcèlement et qu’elle soit entendue sur celle-ci (voir arrêt du 12 mars 2025, Semedo/Parlement, T‑349/23, EU:T:2025:252, point 30 et jurisprudence citée).
74 Il ressort également de la jurisprudence que, afin de pouvoir présenter utilement ses observations, la personne accusée de harcèlement est en droit de se faire communiquer, à tout le moins, un résumé des déclarations des différentes personnes consultées au cours de la procédure d’enquête, dans la mesure où ces déclarations ont été utilisées par le comité dans son rapport pour formuler des recommandations à la présidente du Parlement, la communication de ce résumé devant être effectuée, le cas échéant, dans le respect du principe de confidentialité (voir arrêt du 12 mars 2025, Semedo/Parlement, T‑349/23, EU:T:2025:252, point 31 et jurisprudence citée).
75 Afin de garantir la confidentialité des témoignages et les objectifs que celle-ci protège, tout en s’assurant que le requérant soit utilement entendu avant qu’une décision lui faisant grief ne soit adoptée, il peut être recouru à certaines techniques, telles que l’anonymisation, voire la divulgation de la substance des témoignages sous la forme d’un résumé, ou encore le masquage de certaines parties du contenu des témoignages (voir arrêt du 12 mars 2025, Semedo/Parlement, T‑349/23, EU:T:2025:252, point 32 et jurisprudence citée).
76 En l’espèce, il convient de relever que la version non confidentielle du rapport du comité comporte une évaluation de trois témoignages citée au point 61 ci-dessus. De plus, le comité a, à deux reprises, cité les déclarations des témoins qui avaient été utilisées pour formuler les recommandations.
77 Lors de la transmission de la version non confidentielle du rapport du comité afin de recueillir les observations du requérant, la présidente du Parlement a indiqué au requérant les points contenant un résumé des déclarations des témoins. Celles-ci ont été reprises comme il est indiqué ci-après dans ladite version.
78 En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le requérant a demandé une disponibilité 24h/24 et 7j/7, y compris durant les jours fériés et les congés, à la page 16 du rapport du comité, il est indiqué ce qui suit :
« Outre les preuves écrites importantes étayant l’allégation du plaignant, le témoignage oral de deux des témoins a également étayé [cette] allégation. L’un des témoins a indiqué qu’il s’agissait parfois de conversations ayant lieu [le week-end ou en dehors des heures de travail] et de tâches devant être effectuées pendant [lesdites périodes], d’autant plus que le comité “AFET” était concerné. Lorsque le[s membres du] personnel étai[en]t en congé, ils devaient toujours nettoyer la boîte de réception, de sorte qu’ils ne pouvaient pas complètement se déconnecter de tout[,] comme ils devaient toujours être au courant de choses. Cela a également été confirmé par un autre témoin qui a attesté qu’on leur a[vait] dit que le député ne cessait pas de travailler pendant les vacances, en particulier lorsqu’il s’agissait des réseaux sociaux, de sorte que le personnel [devait] continuer à travailler et à publier sur les réseaux sociaux pour le député. L’un des témoins a été explicitement informé lors d’un entretien avec le député avant son engagement qu’il serait attendu d’eux [qu’ils] travaille[nt] aussi en dehors des heures de travail et qu’ils soient toujours prêts en cas d[e] demande en ce sens. »
79 S’agissant de l’allégation concernant des commentaires menaçants, offensants et blessants, à la page 21 du rapport du comité, il est indiqué ce qui suit :
« L’affirmation du plaignant selon laquelle le député a menacé de renvoyer les APA au cours de la réunion du 1 er septembre 2021 est indirectement confirmée par des éléments de preuve écrits, à savoir un échange de WhatsApp du 9 septembre 2021, selon lequel il y a une semaine que le plaignant aurait été renvoyé. Le témoignage oral confirme que, au cours de ladite réunion, le député a déclaré que le temps de réaction des APA sur certains événements ayant eu lieu au cours de l’été n’était pas satisfaisant[, que l’]on aurait dû faire plus sur les réseaux sociaux pour faire connaître la position du député [et] que, même si les APA étaient en vacances, ils devaient jeter un œil sur ce qui se passe et être dans le coup. Toutefois, il n’a pas pu être établi que le député évoquait la pile de candidatures reçues afin de faire pression sur les APA pour qu’ils travaillent plus dur. »
80 À la page 22 de son rapport, le comité a constaté avoir pris en compte « les preuves écrites et orales mentionnées ci-dessus étayant directement ou indirectement les allégations du plaignant, ainsi que les contradictions entre les preuves écrites et certaines des déclarations faites par le membre dans ses observations et lors de son audition ».
81 À cet égard, il y a lieu de constater que le comité a décrit en détail les témoignages dans la version non confidentielle de son rapport, dans la mesure où ils ont été utilisés pour formuler des recommandations à la présidente du Parlement. Ainsi, le requérant s’est vu communiquer la substance des témoignages utilisée par le comité, conformément à la jurisprudence citée au point 74 ci-dessus, et a été en mesure de faire utilement valoir ses observations sur ces déclarations.
82 S’agissant de l’annexe II du rapport du comité, intitulée « Résumé des auditions de trois témoins », il est vrai que celle-ci a été entièrement occultée dans la version non confidentielle du rapport du comité. La non-communication du contenu d’une telle annexe à la personne mise en cause est de nature à provoquer une confusion chez cette dernière, qui, conformément à la jurisprudence citée au point 74 ci-dessus, est en droit de se faire communiquer un résumé des déclarations des témoins.
83 Toutefois, selon la jurisprudence citée au point 75 ci-dessus, les exigences de confidentialité des témoignages permettent à l’institution en cause de recourir à certaines techniques telles que l’anonymisation et la divulgation de la substance des témoignages sous la forme d’un résumé, dans la mesure où les déclarations ont été utilisées par le comité dans son rapport pour formuler des recommandations au président du Parlement. Selon le Parlement, il s’est conformé à ces exigences afin de respecter les intérêts légitimes de confidentialité. Malgré le fait que l’annexe II du rapport du comité ait été occultée, le requérant s’est vu communiquer la substance des témoignages pertinente pour les recommandations du comité, ainsi qu’il est précisé au point 81 ci-dessus.
84 En outre, le requérant ne conteste pas les faits établis sur les preuves orales par le comité et la requête ne suscite pas non plus de doutes sur le contenu des témoignages repris dans la version non confidentielle du rapport du comité. Dans ces circonstances, l’information communiquée au requérant dans la version non confidentielle du rapport du comité doit être considérée comme étant suffisante pour rendre possible l’exercice de ses droits de la défense.
85 Il s’ensuit qu’une mesure d’instruction concernant la communication de l’annexe II du rapport du comité, ainsi que le demande le requérant, n’aurait pas pour objet de préciser les reproches concrets soulevés par le requérant ou de prouver la véracité de ses allégations factuelles. Partant, la mesure d’instruction demandée par le requérant ne s’avère pas nécessaire aux fins de la solution du litige.
86 Par conséquent, la sixième branche du premier moyen ainsi que le premier moyen dans son ensemble doivent être rejetés.
C. Sur le deuxième moyen, tiré du non-respect des délais de procédure
87 Le deuxième moyen se divise en deux branches.
88 Premièrement, le requérant fait valoir que, à la suite du dépôt de la plainte, le 18 juillet 2022, l’étude préliminaire n’a été présentée que le 31 août 2022, à savoir dans un délai de 45 jours, lequel est supérieur au délai de 40 jours prescrit par l’article 4, paragraphe 2, de la décision du bureau.
89 Deuxièmement, le délai de six semaines entre la réception du rapport du comité et la communication de la décision de la présidente du Parlement, prévu à l’article 11, paragraphe 1, de la décision du bureau, n’aurait pas été respecté. En effet, la présidente du Parlement a transmis une version non confidentielle du rapport final au requérant le 3 mai 2023 et les décisions attaquées ont été rendues le 30 janvier 2024. Le non-respect de ce délai entraînerait une situation d’incertitude et d’insécurité juridique. En l’espèce, un changement à la tête de la présidence du comité se serait produit après l’audition des parties et des témoins et juste avant que le comité ne rende son rapport, mettant à mal le principe d’immédiateté.
90 Le Parlement conteste cette argumentation.
1. Sur la première branche, relative au délai pour présenter une étude préliminaire
91 À titre liminaire, il convient de relever que, si le Parlement indique que la première branche du deuxième moyen est irrecevable, il soulève, en réalité, des arguments relatifs au bien-fondé de la présente branche et à son caractère opérant.
92 Cela étant, il convient de rappeler que l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de la décision du bureau prévoit que, « [d]ans un délai de 40 jours à compter de la réception de la plainte, le service responsable présente une étude préliminaire au comité et à l’[autorité investie du pouvoir de nomination] ».
93 En l’espèce, la date de la réception de la plainte est le 18 juillet 2022. La DG du personnel a transmis au comité son étude préliminaire le 31 août 2022, soit quelques jours après l’expiration du délai de 40 jours, le 27 août 2022.
94 Cependant, selon une jurisprudence constante, une irrégularité procédurale ne saurait être sanctionnée par l’annulation de la décision attaquée que s’il est établi que cette irrégularité procédurale a pu influer sur le contenu de ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, LW/Commission, T‑232/23, non publié, EU:T:2024:482, point 71 et jurisprudence citée).
95 Le requérant n’a ni soutenu ni démontré que, sans cette irrégularité procédurale, les décisions attaquées auraient pu aboutir à un résultat différent.
96 Dans ces circonstances, la première branche du deuxième moyen doit être rejetée.
2. Sur la seconde branche, relative au délai pour communiquer la décision de la présidente du Parlement
97 L’article 11, paragraphe 1, de la décision du bureau prévoit que, « [au] vu de l’avis du comité, le [p]résident arrête une décision motivée sur la question de l’existence ou non d’une situation de harcèlement » et qu'« [i]l s’efforce de communiquer sa décision au plaignant et au député concerné dans les six semaines qui suivent la réception du rapport et en informe le comité et l’[autorité investie du pouvoir de nomination] ».
98 En l’espèce, le comité a remis son rapport à la présidente du Parlement le 8 mars 2023 et cette dernière a adopté les décisions attaquées le 30 janvier 2024, soit près de onze mois après la réception dudit rapport. Il s’ensuit que la présidente du Parlement n’a pas communiqué ses décisions au requérant dans le délai mentionné à l’article 11, paragraphe 1, de la décision du bureau. Une telle situation est regrettable au vu des faits reprochés au requérant.
99 Toutefois, l’emploi du terme « s’efforcer » à l’article 11, paragraphe 1, de la décision du bureau indique qu’il ne s’agit pas d’un délai strict, mais d’un délai indicatif. Le caractère indicatif de ce délai n’exonère cependant pas la présidente du Parlement d’adopter ses décisions dans un délai raisonnable.
100 À cet égard, il y a lieu d’observer, tout d’abord, que la plainte était fondée sur de nombreuses allégations et qu’un nombre conséquent d’éléments de preuve avait été produit par le plaignant et le requérant, à savoir plus de 400 pages. Ensuite, ainsi que le précise le Parlement sans être contredit par le requérant, la présidente du Parlement a invité, le 3 mai 2023, le requérant à un entretien, le 7 juin 2023, afin qu’il présente ses observations sur la version non confidentielle du rapport du comité. À la suite de cet entretien, le requérant a demandé à soumettre des observations par écrit et à obtenir, à cette fin, une traduction en espagnol du rapport du comité, qui lui a été transmise le 29 juin 2023. Ayant reçu les observations du requérant le 20 juillet 2023, la présidente du Parlement a jugé nécessaire de les soumettre au comité, afin que celui-ci en évalue l’incidence sur les conclusions de son rapport. À la suite de la traduction des observations du requérant, le comité a pu les examiner lors de ses réunions des 26 septembre et 11 octobre 2023. Le comité a fait parvenir à la présidente du Parlement son avis sur les observations du requérant le 12 octobre 2023. Celle-ci a adopté les décisions attaquées le 30 janvier 2024.
101 Il ressort de ce qui précède que les étapes procédurales mentionnées ci-dessus et la soumission d’observations écrites ainsi que les délais de traduction ont certes contribué à la longueur de la procédure. Il est aussi vrai que la plainte contenait de nombreuses allégations, le plaignant et le requérant ayant soumis au comité plus de 400 pages de preuves qui ont dû être traduites en espagnol. Il n’en demeure pas moins que la sensibilité des affaires de harcèlement exige un traitement diligent avec toute la célérité requise, dont le délai prévu à l’article 11, paragraphe 1, de la décision du bureau est une expression. Partant, la procédure auprès de la présidente du Parlement ne devrait pas, sauf dans des cas exceptionnels et bien justifiés, durer onze mois.
102 Au vu de ces circonstances, l’écoulement du temps dans le traitement de l’affaire par la présidente du Parlement doit être considéré comme excessif.
103 Cela étant, ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée au point 94 ci-dessus, le fait que les décisions attaquées n’aient pas été communiquées dans un délai raisonnable ne saurait, dans les circonstances propres de l’affaire, affecter, par lui-même, leur légalité. À cet égard, le requérant semble soutenir que l’écoulement excessif du temps entre la réception du rapport du comité et la décision constatant le harcèlement a eu une incidence sur le contenu de cette décision en raison d’un changement à la tête de la présidence du comité. Le Parlement fait valoir, sans être contredit utilement par le requérant, qu’un changement dans la composition du comité a eu lieu en novembre 2023, de sorte que le comité a mené son enquête à terme dans une composition identique. L’argument du requérant selon lequel la présidence du comité ne voulait pas assumer les conclusions du rapport est fondé sur une interprétation purement hypothétique des conclusions du rapport du comité, sans rapport avec la légalité des décisions attaquées.
104 Dans ces circonstances, le requérant ne démontre pas que le délai entre la communication du rapport du comité et la notification des décisions attaquées aurait pu influer sur le contenu de ces dernières. Partant, le fait que la présidente du Parlement n’a pas communiqué ses décisions au requérant dans un délai raisonnable ne saurait, en tout état de cause, justifier l’annulation des décisions attaquées.
105 Il s’ensuit que la seconde branche du deuxième moyen et, partant, le deuxième moyen dans son ensemble doivent être rejetés.
D. Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de présomption d’innocence et d’un détournement de pouvoir
106 Le requérant fait valoir que les décisions attaquées constituent une violation du principe de présomption d’innocence prévu par l’article 48, paragraphe 1, de la Charte et un détournement de pouvoir, dans la mesure où elles reconnaîtraient que toutes les allégations n’auraient pas été établies. Plus précisément, d’une part, s’agissant de la violation du principe de présomption d’innocence, le requérant considère que cette présomption n’a pas été renversée, dès lors que la décision sur la sanction constate, au considérant 7, que sa culpabilité n’a pas été solidement établie. D’autre part, s’agissant du détournement de pouvoir, le requérant soutient que, alors qu’il a été considéré que sa culpabilité n’était pas démontrée, la présidente du Parlement a néanmoins adopté la décision sur la sanction. Ce faisant, la présidente du Parlement aurait usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été conférés.
107 Le Parlement conteste cette argumentation.
108 Le principe de la présomption d’innocence, invoqué par le requérant, exige que toute personne accusée d’une infraction soit présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. La présomption d’innocence constitue un principe général du droit de l’Union, qui est énoncé à l’article 48, paragraphe 1, de la Charte (voir arrêt du 22 juin 2023, DI/BCE, C‑513/21 P, EU:C:2023:500, point 80 et jurisprudence citée).
109 Selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir se réfère au fait, pour une autorité administrative, d’avoir usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise à une telle fin (voir arrêt du 21 septembre 2005, EDP/Commission, T‑87/05, EU:T:2005:333, point 87 et jurisprudence citée).
110 Au considérant 7 de la décision sur la sanction, il est indiqué ce qui suit :
« Sur la base du rapport final et à la lumière des observations du député et [de] la position du comité sur les observations supplémentaires, la présidente [du Parlement] a conclu, dans sa décision du 30 janvier 2024, que, conformément à l’article 11 de la décision du bureau, le comportement décrit par le plaignant est constitutif d’un harcèlement moral de la part du député au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires. C’est la première fois qu’une situation de harcèlement est établie en ce qui concerne le député et certaines des allégations portées contre lui n’ont pas été prouvées. »
111 Il convient de remarquer que l’argumentation du requérant procède d’une lecture erronée du considérant 7 de la décision sur la sanction. Ainsi, tout en reconnaissant que le requérant a adopté un comportement constitutif d’un harcèlement moral, la dernière phrase du considérant 7 indique que c’est la première fois qu’un comportement de harcèlement est établi en ce qui concerne le requérant et que certaines allégations du plaignant n’ont pas été établies. Dans le contexte de la détermination de la sanction, cette phrase ne remet pas en cause la conclusion selon laquelle le requérant avait eu des comportements constituant des faits de harcèlement moral, mais vise à justifier, au vu notamment du fait que toutes les allégations exposées dans la plainte n’ont pas été établies, le caractère modéré de la sanction retenue.
112 Partant, contrairement à ce que prétend le requérant, sa culpabilité a été reconnue dans la décision constatant le harcèlement et aucune violation du principe de présomption d’innocence ni aucun détournement de pouvoir ne sauraient être retenus, les arguments soulevés au soutien de ces allégations reposant sur une prémisse erronée.
113 Le troisième moyen doit donc être rejeté.
E. Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs d’appréciation
114 Le quatrième moyen se divise, en substance, en deux branches, dont la première comporte cinq griefs visant chacun des faits considérés par le Parlement comme établis, à savoir la disponibilité exigée en dehors des heures de travail, les commentaires menaçants, les commentaires insultants, la réalisation de tâches domestiques et les instructions contradictoires.
115 En premier lieu, le requérant fait valoir des erreurs d’appréciation dans la décision constatant le harcèlement. Il estime qu’il n’existe pas de preuves suffisantes pour établir sa culpabilité.
116 Premièrement, en ce qui concerne la disponibilité exigée par le requérant en dehors des heures de travail, il aurait fallu tenir compte du fait que, dans le contexte des fonctions du requérant, les événements internationaux, sur lesquels il aurait exigé une activité plus intense au plaignant, y compris le week-end et pendant les vacances, auraient eu une importance considérable. Les demandes du requérant à cet égard n’auraient pas été constantes, répétitives ou systématiques. Le comité et la présidente du Parlement n’auraient pas non plus suffisamment tenu compte du fait que les travaux exigés ponctuellement par lui auraient correspondu habituellement à des textes très brefs destinés à être publiés sur les réseaux sociaux. Enfin, les exemples produits par le requérant indiqueraient un manque d’organisation dans la remise des travaux du plaignant.
117 Deuxièmement, s’agissant des commentaires menaçants, le requérant estime que les commentaires en cause avaient été adressés à toute l’équipe et visaient à souligner la réalisation incorrecte d’un travail ou la nécessité d’une amélioration.
118 Troisièmement, en ce qui concerne les commentaires insultants ou blessants, le requérant critique l’appréciation par le comité de ses déclarations des 23 et 24 mai 2021, du 15 août 2021, du 6 janvier 2022 et du 4 avril 2022. Il fait valoir qu’elles n’avaient pas pour but de dénigrer, mais de corriger des erreurs telles que des manques évidents de coordination de l’équipe et des défaillances dans l’exécution des tâches. En ce qui concerne les commentaires du 6 janvier 2022, aucun commentaire blessant n’aurait été proféré. La critique d’un supérieur hiérarchique sur l’accomplissement d’un travail par un subordonné ne serait pas, en soi, un comportement inapproprié.
119 Quatrièmement, concernant les tâches domestiques, le requérant aurait demandé quelques rares fois, au cours d’une période de trois ans, la collaboration de son équipe pour résoudre certains problèmes inattendus de type personnel. Le plaignant aurait proposé de lui fournir cette aide, qui aurait consisté à se rendre à un rendez-vous, à récupérer des rideaux et à ouvrir la porte de son appartement aux installateurs d’une machine à laver. Quant à l’épisode de la réception d’un paquet, le 16 juin 2021, cela relèverait de la sphère d’activité professionnelle, car ce paquet aurait été livré au Parlement et, de plus, il aurait été récupéré par un autre assistant que le plaignant.
120 Cinquièmement, s’agissant des instructions contradictoires du 23 mai 2021, le comité ne préciserait pas en quoi consiste la contradiction reprochée. En tout état de cause, il s’agirait d’une situation trop ponctuelle pour pouvoir étayer l’accusation de harcèlement.
121 En second lieu, le requérant fait valoir que les faits ne peuvent pas relever de la notion de « harcèlement moral ». Un observateur impartial et raisonnable n’aurait pas perçu le comportement du requérant comme abusif. Le caractère intentionnel ne serait pas établi. De plus, il ne faudrait pas confondre l’état de fatigue ou d’épuisement psychologique causé par le stress professionnel, propre au poste occupé par le plaignant, avec le harcèlement moral, caractérisé par un comportement intentionnel et répété, qui n’aurait pas eu lieu en l’espèce.
122 Le Parlement conteste cette argumentation.
123 Par son argumentation le requérant ne remet en cause aucun des faits établis par le comité, mais il conteste leur appréciation.
124 Selon l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, applicable par analogie aux APA en vertu de l’article 127 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), « [p]ar harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne ».
125 S’agissant de la notion de harcèlement moral, celle-ci est définie, au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, comme une « conduite abusive » qui, premièrement, se matérialise par des comportements, paroles, actes, gestes ou écrits manifestés « de façon durable, répétitive ou systématique », ce qui implique que le harcèlement moral doit être compris comme un processus s’inscrivant nécessairement dans le temps et suppose l’existence d’agissements répétés ou continus et qui sont « intentionnels », par opposition à « accidentels ». Deuxièmement, pour relever de cette notion, ces comportements, paroles, actes, gestes ou écrits doivent avoir pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’établir que les comportements, paroles, actes, gestes ou écrits en cause ont été commis avec l’intention de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne. En d’autres termes, il peut y avoir harcèlement moral sans qu’il soit démontré que le harceleur ait entendu, par ses agissements, discréditer la victime ou dégrader intentionnellement ses conditions de travail. Il suffit que ces agissements, dès lors qu’ils ont été commis volontairement, aient entraîné objectivement de telles conséquences (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, points 76 et 77).
126 Enfin, l’agissement en cause devant, en vertu de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, présenter un caractère abusif, il s’ensuit que la qualification de « harcèlement » est subordonnée à la condition que celui-ci revête une réalité objective suffisante, au sens où un observateur impartial et raisonnable, doté d’une sensibilité normale et placé dans les mêmes conditions, considérerait le comportement ou l’acte en cause comme excessif et critiquable (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 78).
127 S’agissant de la question de savoir si des faits sont constitutifs ou non d’un harcèlement moral, l’administration ne dispose pas d’un large pouvoir d’appréciation. Dès lors, en présence d’une allégation de harcèlement moral, il convient de rechercher si l’administration a commis une erreur d’appréciation des faits et non une erreur manifeste d’appréciation de ces faits. Sur la qualification juridique des faits opérée par l’autorité investie du pouvoir de nomination quant à l’existence d’un harcèlement moral, le contrôle du juge de l’Union est un contrôle entier et non pas restreint (voir arrêt du 23 février 2022, OA/CESE, T‑671/20, non publié, EU:T:2022:82, points 50 et 51 et jurisprudence citée).
128 En l’espèce, il revient au Tribunal de vérifier si le Parlement a commis une erreur d’appréciation des faits et si c’est à juste titre que le Parlement a considéré que les faits établis étaient constitutifs d’un harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut.
1. Sur la première branche du quatrième moyen, liée à l’appréciation des faits
a) Sur le premier grief, lié à la disponibilité exigée par le requérant
129 Le requérant fait valoir qu’il aurait fallu tenir compte du contexte de ses fonctions. Les demandes correspondant à des tâches à effectuer en dehors des heures de travail en ce qui concernait des événements internationaux n’auraient pas été constantes, répétitives ou systématiques. Enfin, il aurait existé des insuffisances d’organisation dans la remise de travaux du plaignant.
130 Il convient de rappeler que les conditions de travail de tout APA sont encadrées par le chapitre 4 du titre VII du RAA. En vertu de l’article 131, paragraphe 2, du RAA, le membre du Parlement fixe la durée hebdomadaire du travail d’un APA, mais, en temps normal, celle-ci ne peut pas excéder 42 heures par semaine. Selon l’article 131, paragraphe 3, du RAA, l’APA ne peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel de travail.
131 Il s’ensuit que les arguments du requérant tirés de la nature de ses fonctions ou de celles des APA ne peuvent pas, en dehors des cas d’urgence ou d’un surcroît exceptionnel de travail, justifier une disponibilité constante de ses APA.
132 Par ailleurs, le requérant ne soulève que cinq événements internationaux, survenus entre le 23 mai 2021 et le 3 avril 2022, nécessitant des contributions immédiates de la part du plaignant. Cependant, il ne conteste pas les preuves écrites présentées devant le comité et la conclusion de la présidente du Parlement, selon lesquelles, pendant cette période, il avait adressé des questions au plaignant et à l’ensemble de ses APA pendant plus de la moitié des week-ends et pendant 10 jours sur les 30 de la période de congé annuel du plaignant. Il ne conteste pas non plus les constatations du comité selon lesquelles il sollicitait régulièrement le plaignant en dehors des jours de travail afin qu’il réponde à des questions qui lui étaient posées sur Instagram, qu’il vide sa boîte de courriel, qu’il réponde aux demandes d’entretien, qu’il alimente son compte Twitter et lui fournisse des photos de sa présentation lors d’une conférence. Son argument selon lequel ses demandes correspondant à des tâches à effectuer en dehors des heures de travail n’auraient pas été constantes, répétitives ou systématiques doit, dès lors, être rejeté.
133 S’agissant des prétendues insuffisances d’organisation dans la remise de travaux du plaignant, il convient d’observer que de tels éléments, pouvant éventuellement justifier des mesures disciplinaires ou un licenciement pour un motif pris de la rupture du lien de confiance, ne sont nullement de nature à autoriser un membre d’une institution de l’Union à avoir une conduite abusive, répétitive et intentionnelle à l’égard d’un fonctionnaire ou d’un agent de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 87). En effet, même à supposer que le plaignant n’ait pas fourni des prestations professionnelles satisfaisantes pour le requérant, il n’en demeurait pas moins que le plaignant était en droit de disposer de conditions de travail respectant sa santé et sa dignité.
134 Quant au fait que le plaignant aurait lui-même contacté le requérant en dehors de ses heures de travail ou qu’il n’aurait pas refusé les missions qui lui étaient confiées, ceux-ci sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, compte tenu du fait, d’une part, que la prise de contact du 6 janvier 2022, soit un jour férié, est un fait isolé et, d’autre part, que l’absence de refus ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, être vue comme une renonciation par le plaignant aux droits qui lui sont reconnus par le RAA.
135 Pour ces raisons, le premier grief doit être rejeté.
b) Sur le deuxième grief, lié aux commentaires menaçants
136 S’agissant des commentaires menaçants formulés par le requérant, ce dernier estime que ces commentaires étaient adressés à toute l’équipe et visaient à souligner la réalisation incorrecte d’un travail ou la nécessité d’une amélioration.
137 Le dimanche 23 mai 2021 à 18 h 17, le requérant s’est exprimé ainsi dans un message WhatsApp audio à son équipe : « Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons tout simplement pas continuer comme ça ».
138 À partir de 18 h 26 le même jour, il a envoyé les messages suivants : « Mais c’est moi qui l’ai remarqué, pas celui qui a cette responsabilité », « Il ne s’agit pas de supprimer des choses, il s’agit de ne pas passer pour des idiots », « Et il est déjà 18 h 30 et je n’ai toujours pas de tweet » ainsi que « Merci beaucoup !!! Quelle honte ! ».
139 Il ressort des messages que le requérant a reproché au plaignant de ne pas avoir réagi assez rapidement aux événements et que les échanges sur le contenu des tweets à mettre en ligne ont continué jusqu’à minuit.
140 Les messages du jour suivant, qui était un jour férié, contiennent les commentaires suivants du requérant : « Ce bureau est un véritable désastre », « Vous avez réussi à devenir pour la Communication et pour notre organisation interne ce que je n’ai jamais voulu qu’ils pensent de mon équipe » ainsi que « Mais comment est-il possible que je doive me battre avec quelqu’un de la délégation à cause de votre incompétence ? ».
141 Le message du 20 août 2021, qui a été envoyé à toute l’équipe, a été formulé ainsi :
« Il est pour moi totalement inacceptable de recevoir mes notes vingt minutes avant un entretien. Cela ne fonctionne tout simplement pas et je vais devoir prendre des décisions importantes. Je vais donc vous convoquer pour une réunion au début de la semaine du 30. Je vous en confirmerai la date et l’heure. Je suis désolé de devoir agir de cette manière, mais je suis immensément déçu par cette équipe. »
142 Le 6 janvier 2022, pendant un jour férié, le requérant a envoyé un message disant ce qui suit :
« Si nous ne sommes pas capables de savoir quels sont les sujets brûlants dont il faut débattre ni quelles sont les opportunités politiques, les choses ne s’annoncent alors pas très bien pour nous. »
143 Contrairement à ce que prétend le requérant, les messages cités ci-dessus impliquaient qu’il y aurait des conséquences négatives, et notamment des rétorsions ou des mesures ayant des conséquences sur l’emploi du plaignant.
144 Certes, la critique d’un supérieur hiérarchique sur l’accomplissement d’un travail ou d’une tâche par un subordonné n’est pas, en soi, un comportement inapproprié, car, si tel devait être le cas, la gestion d’un service en serait rendue pratiquement impossible. De même, des observations négatives adressées à un agent ne portent pas nécessairement atteinte à sa personnalité, à sa dignité ou à son intégrité, lorsqu’elles sont formulées en des termes mesurés et ne reposent pas sur des accusations abusives et dénuées de tout lien avec des faits objectifs (arrêt du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F‑12/13, EU:F:2014:214, point 87). Toutefois, il relève des messages envoyés par le requérant que leur tonalité dépasse les limites d’une simple critique et, ainsi, revêt un caractère disproportionné compte tenu de la prétendue erreur commise. En effet, dans le contexte d’une disponibilité permanente exigée par le requérant des membres de son équipe, il convient de constater leur caractère abusif, indépendamment du fait que ces menaces étaient adressées à l’ensemble de son équipe. Le fait que ces menaces auraient été proférées en raison d’une situation de stress est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, le plaignant étant en droit de disposer de conditions de travail respectant sa santé et sa dignité (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, points 86 à 88). Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément afin de démontrer que les menaces auraient pu prétendument être proférées accidentellement. Partant, il n’y a pas d’erreur dans l’appréciation de la présidente du Parlement selon laquelle lesdits messages ont revêtu un caractère menaçant.
145 Pour les raisons susmentionnées, le deuxième grief doit être rejeté.
c) Sur le troisième grief, lié aux commentaires insultants , blessants ou dévalorisants
146 Le requérant fait valoir que ses déclarations des 23 et 24 mai 2021, du 15 août 2021, du 6 janvier 2022 et du 4 avril 2022 n’avaient pas pour but de dénigrer, mais de corriger des erreurs. En ce qui concerne ses déclarations du 24 mai 2021, il fait valoir qu’elles étaient adressées à sa cheffe de bureau et non au plaignant.
147 Il convient de remarquer, à titre liminaire, que le requérant ne conteste pas l’appréciation, faite par le comité, de ses déclarations du 5 août 2021, 10 janvier 2022 et du 11 février 2022, qui ont également été considérées comme étant blessantes ou insultantes par le comité.
148 En ce qui concerne les échanges du 24 mai 2021, qui était un jour férié, le requérant y a tenu responsables ses trois APA pour le retard d’un communiqué de presse, en leur adressant à 15 h 18 la phrase suivante : « Vous êtes tous les trois responsables pour ceci ! ». Ainsi, contrairement à ce que prétend le requérant, l’expression de sa déception n’a pas seulement été adressée à la cheffe du bureau.
149 Concernant cet échange, cité au point 140 ci-dessus, il convient également de remarquer que les trois APA se sont investis dans la rédaction de tweets sur le compte du requérant concernant le détournement d’un avion en Biélorussie dès 7 h 45 du matin, à la demande du requérant. Les APA venaient d’envoyer un communiqué de presse peu avant 14 h 00 lorsque le requérant a vu une nouvelle sur Twitter en lien avec le détournement d’un avion en Biélorussie sur laquelle il voulait émettre un second communiqué et il a blâmé ses APA de ne pas avoir réagi plus tôt.
150 En ce qui concerne les messages envoyés le dimanche 15 août 2021, alors que le plaignant allait être en congé la semaine suivante, le requérant s’est exprimé de la manière suivante : « Avez-vous pensé à obtenir un entretien sur le conflit international de référence ? », « Êtes-vous conscients que depuis le début du conflit, aucun d’entre vous ne m’a même informé qu’il avait eu lieu ? », « Nous sommes arrivés avec plus de trois jours de retard » et « Nous sommes supposés être une équipe de référence en matière d’affaires étrangères ». Le requérant fait valoir qu’il s’agit d’un rappel des objectifs professionnels de l’équipe.
151 En ce qui concerne les messages du 6 janvier 2022, envoyés pendant le congé annuel du plaignant, le requérant a répondu au plaignant que la proposition de tweet du plaignant n’intéressait personne. Selon le requérant, ce commentaire faisait partie d’un dialogue visant à déterminer quel sujet parmi ceux cités présentait le plus d’intérêt.
152 Quant au message du requérant du 4 avril 2022, à 12 h 37 (« C’est pourquoi il est nécessaire de disposer de conseillers pour aider à voir ce qu’une personne seule ne peut voir ou pour l’aider lorsqu’elle n’a pas le temps de se consacrer à un sujet précis »), le requérant a reproché au plaignant de n’avoir pas été à la hauteur de son rôle de conseiller quand il ne lui avait pas rappelé la date des élections en Hongrie et qu’il n’avait pas préparé une vidéo sur le sujet. La remarque peut être considérée comme blessante au regard du fait que le requérant avait déjà admis que deux ou trois tweets seraient suffisants sur ce sujet, qu’il avait donné son accord pour une vidéo sur les élections françaises et qu’il ressort de la réponse du plaignant que le requérant avait été absent pendant deux semaines et que ses APA avaient travaillé douze jours d’affilée pendant ce temps, de sorte qu’il leur aurait été impossible d’enregistrer une autre vidéo sur les élections en Hongrie.
153 Il ressort de l’ensemble des communications du requérant qu’il exigeait que ses APA assurent un suivi continu de la presse internationale et lui proposent instantanément des messages qu’il aurait pu mettre en ligne. Il ne ressort pas du dossier qu’il y aurait eu un mode de travail opérationnel qui aurait permis un suivi continu en dehors des heures de travail habituelles des APA. Partant, et comme le fait valoir le Parlement, le prétendu retard ou dysfonctionnement de l’équipe ne semble pas avoir résulté du non-respect de règles de travail existantes au sein du cabinet, mais plutôt du manque de disponibilité des APA en dehors des heures de travail.
154 À la lumière de la jurisprudence citée au point 144 ci-dessus, il convient de considérer que, compte tenu des efforts faits par le plaignant tels qu’ils ressortent des points ci-dessus, des demandes répétitives et de l’absence d’établissement d’un mode de travail qui aurait permis le suivi continu des événements internationaux exigé par le requérant en dehors des jours de travail, il n’y a pas d’erreur dans l’appréciation de la présidente du Parlement selon laquelle les reproches exprimés par le requérant dans ces messages ont eu un caractère blessant ou insultant à l’égard du plaignant. La circonstance que ces messages auraient eu pour contexte des événements de première importance ne saurait tempérer le caractère abusif de ceux-ci.
155 Pour ces raisons, le troisième grief doit être rejeté.
d) Sur le quatrième grief, lié à la réalisation de tâches domestiques
156 Concernant les tâches domestiques, le requérant aurait demandé quelques rares fois la collaboration de son équipe pour résoudre certains problèmes inattendus de type personnel.
157 En effet, à l’exception de la réception d’un paquet le 16 juin 2021, le requérant ne remet pas en cause la réalité de ses demandes d’exécution de tâches domestiques. Il les justifie cependant par leur nature exceptionnelle.
158 Il ressort de l’analyse des faits au point 5.2.5 du rapport du comité qu’il ne s’agissait pas de rares occasions. En effet, le comité a pu établir l’existence d’au moins neuf tâches domestiques exécutées par le plaignant sur une période de six mois. Si le requérant soutient que trois des situations identifiées étaient justifiées par des circonstances exceptionnelles, au regard du nombre de tâches domestiques exécutées par le plaignant durant une période de six mois, il ne saurait soutenir qu’elles étaient exceptionnelles.
159 S’agissant de la circonstance avancée par le requérant selon laquelle ses demandes étaient adressées à l’ensemble de son équipe, ainsi que cela a déjà été rappelé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Quant à l’existence d’une prétendue relation amicale entre le requérant et son équipe, laquelle se serait portée volontaire pour l’exécution de tâches domestiques, cette allégation est contredite pas les éléments du dossier, qui témoignent d’un contexte tendu et contraignant.
160 Partant, il n’y a pas d’erreur dans l’appréciation de la présidente du Parlement selon laquelle les tâches domestiques allaient au-delà des responsabilités du plaignant et étaient sans rapport avec le travail du requérant en tant que membre du Parlement.
161 En ce qui concerne le message du 16 juin 2021, le requérant a demandé au plaignant de se rendre chez lui pour récupérer un colis. La présidente du Parlement n’a pas considéré cet incident comme un exemple d’exécution, par le plaignant, d’une tâche domestique, car cette tâche a été exécutée par une autre personne que le plaignant. Partant, l’argumentation à cet égard doit être écartée comme inopérante.
162 Il résulte de tout ce qui précède que le quatrième grief doit être rejeté.
e) Sur le cinquième grief, lié aux instruction s contradictoire s données
163 S’agissant des instructions contradictoires données le 23 mai 2021, le requérant fait valoir que le comité ne précise pas en quoi consiste la contradiction reprochée. En tout état de cause, il s’agirait d’une situation ponctuelle.
164 Il ressort du point 5.2.6 du rapport du comité que la contradiction se trouve dans le fait que le requérant a admis que la question du détournement d’un vol en Biélorussie relevait de la compétence d’un autre membre du Parlement, mais, trois heures plus tard, a exprimé sa déception quant aux réactions tardives du plaignant sur ce sujet. Ainsi, le comité a précisé en quoi consistaient les instructions contradictoires qui sont reprochées au requérant. En outre, ce faisant, le requérant a bien, contrairement à ce qu’il soutient, donné au plaignant des instructions contradictoires. La circonstance qu’une telle situation aurait été propre à l’environnement professionnel dans lequel elle s’est déroulée ne peut remettre en cause ce constat.
165 En ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle il s’agissait d’une situation ponctuelle, il convient de rappeler que, lorsque le harcèlement moral correspond à un processus continu dans le temps, il peut, par définition, être le résultat d’un ensemble de comportements différents, qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement constitutifs en soi d’un harcèlement moral, mais qui, appréciés globalement et de manière contextuelle, y compris en raison de leur accumulation dans le temps, pourraient être considérés en tant que tel. C’est pourquoi, lorsqu'est examinée la question de savoir si des comportements invoqués par une partie requérante sont constitutifs d’un harcèlement moral, il convient d’examiner ces faits tant isolément que conjointement en tant qu’éléments d’un environnement global de travail créé par les comportements d’un membre du personnel à l’égard d’un autre membre de ce personnel (arrêt du 30 janvier 2020, PV/Commission, T‑786/16 et T‑224/18, non publié, EU:T:2020:17, points 156 et 157).
166 Partant, la présidente du Parlement a pu à juste titre prendre en compte les instructions contradictoires formulées par le requérant comme un comportement isolé à prendre en compte dans l’appréciation globale de l’accusation de harcèlement.
167 Pour ces raisons, le cinquième grief et, partant, la première branche du quatrième moyen dans son ensemble doivent être rejetés.
2. Sur la seconde branche du quatrième moyen, liée à la qualification des faits
168 Le requérant fait valoir que les faits ne peuvent pas relever de la notion de « harcèlement moral » et que le caractère intentionnel n’est pas établi. Il ne faudrait pas confondre l’état de fatigue ou d’épuisement psychologique causé par le stress professionnel, propre au poste occupé par le plaignant, avec le harcèlement moral, caractérisé par un comportement intentionnel et répété, qui n’aurait pas eu lieu en l’espèce.
169 En l’espèce, le comportement objectivement abusif du requérant a discrédité le plaignant et a dégradé ses conditions de travail, ainsi qu’il a été établi dans le cadre de la première branche de ce moyen. En effet, les preuves écrites montrent que le requérant a exercé une pression psychologique sur le plaignant de manière continue dans le temps. Quand bien même le requérant n’aurait pas été conscient d’exercer une telle pression, il convient de relever que les agissements qui ont conduit à celle-ci ont été commis volontairement, conformément à ce que requiert la jurisprudence citée au point 125 ci-dessus. En outre, même en tenant compte de la nature des fonctions exercées par le requérant et le plaignant, une telle situation doit être qualifiée de harcèlement moral. Enfin, à supposer que le plaignant, de par son attitude, ait contribué à cette situation, cette circonstance ne saurait empêcher le constat d’une situation de harcèlement moral.
170 Partant, conformément à la jurisprudence citée aux points 125 et 126 ci-dessus, la présidente du Parlement a pu à juste titre conclure à un harcèlement moral au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, sans qu’il ait fallu démontrer que le requérant aurait entendu, par ses agissements, discréditer le plaignant ou dégrader délibérément ses conditions de travail.
171 Partant, la seconde branche du quatrième moyen et le quatrième moyen dans son ensemble doivent être rejetés.
F. Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de confidentialité en raison de fuites concernant l’enquête du comité
172 Le requérant soutient que la fuite d’informations concernant l’existence de l’affaire et de la plainte a violé la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel. À cet égard, le comité n’aurait pas appliqué les mesures appropriées afin d’assurer la confidentialité des données personnelles du requérant.
173 Le Parlement conteste cette argumentation.
174 Le requérant ne fournit pas d’éléments permettant d’établir le prétendu non-respect de la confidentialité des données à caractère personnel de la part du Parlement. En tout état de cause, il n’explique pas comment la prétendue violation de confidentialité serait susceptible d’avoir une influence sur la légalité des décisions attaquées et sur la solution du litige. Dès lors, ce moyen revêt un caractère inopérant.
175 Partant, le cinquième moyen doit être rejeté ainsi que le recours dans son intégralité.
IV. Sur les dépens
176 Aux termes de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance.
177 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime que le laps de temps excessif qui s’est écoulé entre la transmission du rapport du comité et l’adoption des décisions attaquées justifie que le Parlement soit condamné à supporter, outre ses propres dépens, la moitié de ceux exposés par le requérant. Le requérant supportera, quant à lui, la moitié de ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Le Parlement européen supportera ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par DI.
3) DI supportera la moitié de ses propres dépens.
da Silva Passos
Reine
Pynnä
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 novembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
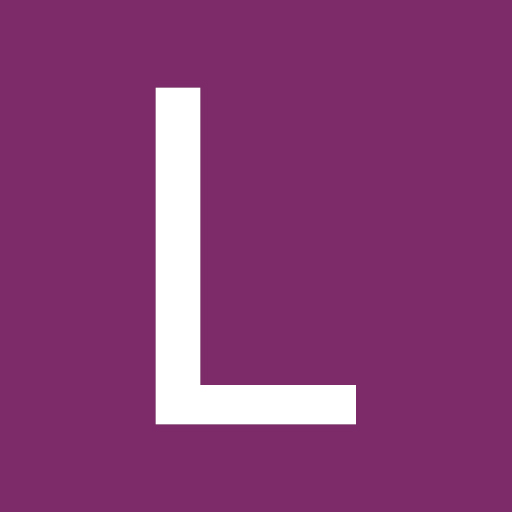
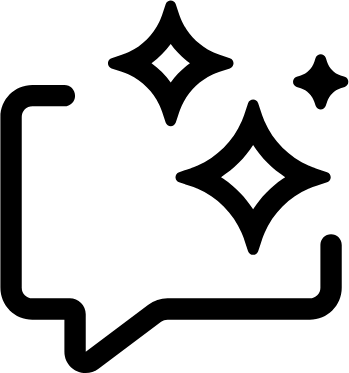 LEXI - AI Legal Assistant
LEXI - AI Legal Assistant