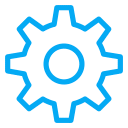Arrêt Du Tribunal (Neuvième Chambre élargie) Du 29 Octobre 2025 (Extraits).
ClientEarth et Collectif Nourrir contre Commission européenne.
• 62023TJ0399_EXT • ECLI:EU:T:2025:1002
- Inbound citations: 0
- •
- Cited paragraphs: 0
- •
- Outbound citations: 124
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre élargie)
29 octobre 2025 ( *1 )
« Agriculture – Plan stratégique relevant de la PAC – Règlement (UE) 2021/2115 – Règles régissant l’aide aux plans stratégiques établis par les États membres dans le cadre de la PAC – Approbation de la Commission – Rejet de la demande de réexamen interne – Article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1367/2006 – Article 13 du règlement 2021/2115 – Erreur de droit – Erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire T‑399/23,
ClientEarth, établie à Ixelles (Belgique),
Collectif Nourrir, établie à Montreuil (France),
représentées par M es C. Baldon et N. Braoudakis, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par M me A.-C. Becker, MM. G. Gattinara, F. Le Bot et M me C. Perrin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
République française, représentée par M. B. Fodda, M me B. Travard, M. M. de Lisi, M mes P. Chansou et F. du Couëdic, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre élargie),
composé, lors des délibérations, de MM. L. Truchot, président, H. Kanninen, M. Sampol Pucurull (rapporteur), M me T. Perišin et M. R. Meyer, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 13 décembre 2024,
rend le présent
Arrêt ( 1 )
1
Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, ClientEarth et Collectif Nourrir, demandent l’annulation de la décision de la Commission européenne du 5 mai 2023 (ci-après la « décision attaquée ») rejetant leur demande de réexamen interne de la décision d’exécution C(2022) 6012 final de la Commission, du 31 août 2022, portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d’un soutien de l’Union financé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural (ci-après la « décision d’approbation »).
I. Antécédents du litige
2
Les requérantes sont, d’une part, ClientEarth, une association à but non lucratif de droit belge œuvrant pour la promotion de la protection de l’environnement et, d’autre part, Collectif Nourrir, une association à but non lucratif de droit français ayant pour objet la protection de l’environnement, la mise en relation d’associations et d’organisations environnementales ainsi que la promotion de politiques agricoles écologiques.
3
Le 22 décembre 2021, la République française, au titre de l’article 118, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil, du 2 décembre 2021, établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n o 1305/2013 et (UE) n o 1307/2013 ( JO 2021, L 435, p. 1 ), a présenté à la Commission une proposition de plan stratégique relevant de la politique agricole commune (PAC) (ci-après le « PSPAC ») pour la période 2023-2027.
4
Le 31 mars 2022, conformément à l’article 118, paragraphe 2, du règlement 2021/2115, la Commission, après avoir évalué la proposition de PSPAC élaborée par la République française (ci-après le « PSPAC français »), a formulé des observations et demandé des informations supplémentaires.
5
Le 22 avril 2022, la République française a adressé un courrier à la Commission formulant ses remarques sur les observations présentées dans le courrier du 31 mars 2022 mentionné au point 4 ci-dessus.
6
Le 4 août 2022, la République française a communiqué à la Commission des informations pour donner suite à ses observations et a présenté une version révisée de sa proposition de PSPAC.
7
Le 31 août 2022, la Commission a adopté la décision d’approbation au titre de l’article 118, paragraphe 4, du règlement 2021/2115.
8
Par courrier du 3 novembre 2022, les requérantes ont demandé à la Commission d’effectuer un réexamen interne de la décision d’approbation (ci-après la « demande de réexamen interne »), en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de l’Union européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ( JO 2006, L 264, p. 13 , ci-après le « règlement Aarhus »), tel que modifié par le règlement (UE) 2021/1767 du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2021 ( JO 2021, L 356, p. 1 ). Elles estimaient que la Commission avait excédé sa compétence en approuvant le PSPAC français alors qu’il était incompatible avec les exigences essentielles du règlement 2021/2115. À titre subsidiaire, les requérantes soutenaient que la Commission avait commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation, notamment en raison de l’incapacité du PSPAC français à contribuer efficacement à la réalisation des objectifs spécifiques figurant à l’article 6, paragraphe 1, sous d) à f), du règlement 2021/2115 tendant à l’atténuation du changement climatique, à la protection des ressources naturelles par la réduction de la dépendance chimique ainsi qu’à l’arrêt et à l’inversion de la perte de biodiversité (ci-après les « objectifs spécifiques environnementaux et climatiques »).
9
Par la décision attaquée, le membre de la Commission chargé de l’agriculture a informé les requérantes qu’il n’admettait aucune des allégations juridiques et scientifiques invoquées pour étayer leur demande de réexamen interne. La Commission a considéré, par conséquent, que cette demande n’était pas fondée et l’a rejetée.
II. Conclusions des parties
10
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
–
annuler la décision attaquée ;
–
condamner la Commission aux dépens.
11
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–
rejeter le recours comme non fondé ;
–
condamner les requérantes aux dépens.
12
Dans son mémoire en intervention au soutien des conclusions de la Commission, la République française conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
III. En droit
13
Au soutien de leur recours, les requérantes invoquent quatre moyens, tirés :
–
le premier, d’erreurs relatives à la compétence de la Commission pour adopter la décision d’approbation ;
–
le deuxième, d’erreurs manifestes d’appréciation relatives à la contribution du PSPAC français à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, sous d), du règlement 2021/2115 (ci-après l’« objectif spécifique D ») en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (ci-après les « émissions de GES ») et aux valeurs cibles nationales à long terme mentionnées à l’article 109, paragraphe 2, de ce règlement (ci-après les « valeurs cibles nationales à long terme ») relatives à cet objectif ;
–
le troisième, d’erreurs manifestes d’appréciation relatives à la contribution du PSPAC français à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, sous e), du règlement 2021/2115, notamment la protection des ressources en eau (ci-après l’« objectif spécifique E »), et aux valeurs cibles nationales à long terme relatives à cet objectif ;
–
le quatrième, d’erreurs manifestes d’appréciation quant à la contribution du PSPAC français à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, sous f), du règlement 2021/2115 relatif à la préservation et à la restauration de la biodiversité (ci-après l’« objectif spécifique F »).
14
À cet égard, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, le Tribunal doit interpréter les moyens d’une partie requérante par leur substance plutôt que par leur qualification et procéder, par conséquent, à la qualification des moyens et des arguments de la requête (voir arrêt du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11 , EU:T:2014:739 , point 51 et jurisprudence citée).
15
Or, il ressort de l’examen de la substance des écritures des requérantes que le premier moyen présenté dans la requête ne porte pas sur l’éventuelle incompétence de la Commission pour approuver le PSPAC français. En effet, par leur premier moyen, les requérantes contestent la manière dont la Commission a exercé cette compétence en ce qu’elle n’aurait pas respecté les limites du mandat confié par l’article 118, paragraphes 4 et 6, du règlement 2021/2115 lors de l’adoption de la décision d’approbation. Interrogées à l’audience sur la portée de ce moyen, les requérantes ont confirmé cette interprétation.
16
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le premier moyen se compose, en réalité, de trois branches, tirées, la première, d’erreurs de droit relatives à la nature et à l’étendue du contrôle de la Commission au titre de l’article 118, paragraphes 3 et 4, du règlement 2021/2115, la deuxième, d’erreurs de droit quant à l’interprétation des limites des compétences d’exécution de la Commission conférées par l’article 118, paragraphes 4 et 6, de ce règlement et, la troisième, d’une erreur manifeste d’appréciation relative à la satisfaction par le PSPAC français des éléments essentiels dudit règlement.
A. Observations générales
17
L’étendue du contrôle juridictionnel effectué par le juge de l’Union européenne lors de son examen d’un recours en annulation introduit en vertu de l’article 12 du règlement Aarhus contre une décision sur une demande de réexamen interne en vertu de l’article 10 du même règlement ne diffère pas de l’étendue du contrôle juridictionnel que le Tribunal exerce sur le bien‑fondé des motifs des décisions attaquées directement sur le fondement de l’article 263, paragraphes 2 et 4, TFUE, lorsqu’une telle décision repose sur des évaluations de nature technique et scientifique complexes (voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 2016, TestBioTech e.a./Commission, T‑177/13 , non publié, EU:T:2016:736 , point 81 , du 18 octobre 2023, TestBioTech/Commission, T‑605/21 , non publié, EU:T:2023:648 , point 18 et du arrêt du 25 juin 2025, ClientEarth/Conseil, T‑648/22 , non publié, EU:T:2025:631 , point 105 ).
18
À ce titre, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’une institution de l’Union est appelée à effectuer des évaluations complexes, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice est soumis à un contrôle juridictionnel se limitant à vérifier si la mesure en cause n’est pas entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir, ou si l’autorité compétente n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation (voir arrêt du 15 décembre 2016, TestBioTech e.a./Commission, T‑177/13 , non publié, EU:T:2016:736 , point 77 et jurisprudence citée).
19
Afin d’établir qu’une institution a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de faits complexes de nature à justifier l’annulation d’un acte, les éléments de preuve apportés par la partie requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans cet acte. Sous réserve de cet examen de plausibilité, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation de faits complexes à celle de l’auteur de cette décision. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste doit, dès lors, être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant toujours vraie ou valable. Il en est particulièrement ainsi lorsque la décision en cause est entachée d’erreurs qui, fussent-elles prises dans leur ensemble, ne présentent qu’un caractère mineur insusceptible d’avoir déterminé l’administration (voir arrêt du 4 avril 2019, ClientEarth/Commission, T‑108/17 , EU:T:2019:215 , point 246 et jurisprudence citée).
20
En outre, la limitation du contrôle du juge de l’Union n’affecte pas le devoir de celui-ci de vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence ainsi que de contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (voir arrêt du 15 décembre 2016, TestBioTech e.a./Commission, T‑177/13 , non publié, EU:T:2016:736 , point 79 et jurisprudence citée).
[ omissis ]
C. Sur le premier moyen, tiré d’erreurs de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 118, paragraphes 3, 4 et 6, du règlement 2021/2115 et d’une erreur manifeste d’appréciation quant au respect des éléments essentiels dudit règlement par le PSPAC français
45
Ainsi qu’il ressort du point 16 ci-dessus, le premier moyen se divise, en substance, en trois branches.
46
Le Tribunal estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord la deuxième branche du premier moyen visant à contester les limites des compétences d’exécution de la Commission conférées par l’article 118, paragraphes 4 et 6, du règlement 2021/2115 pour adopter la décision d’approbation, puis la première branche portant sur la nature et l’étendue du contrôle de la Commission au titre de l’article 118, paragraphes 3 et 4, du règlement 2021/2115 et, enfin, la troisième branche tirée d’une erreur manifeste d’appréciation.
1. Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée d’erreurs de droit quant à l’interprétation des limites des compétences d’exécution de la Commission conférées par l’article 118, paragraphes 4 et 6, du règlement 2021/2115
47
La seconde branche du premier moyen se subdivise, en substance, en deux griefs tirés, le premier, du refus de la Commission d’admettre l’obligation pour un acte d’exécution, tel que la décision d’approbation, de respecter les éléments essentiels de l’acte de base et, le second, du refus de la Commission de considérer les objectifs spécifiques environnementaux et climatiques comme des éléments essentiels du règlement 2021/2115.
a) Sur le premier grief, tiré du refus de la Commission d’admettre l’obligation pour un acte d’exécution, tel que la décision d’approbation, de respecter les éléments essentiels de l’acte de base
48
Les requérantes font valoir que les considérations formulées dans la sous-section 4.1 de l’annexe de la décision attaquée sont entachées d’une erreur de droit relative au refus de la Commission d’admettre l’obligation pour un acte d’exécution, tel que la décision d’approbation, de respecter les éléments essentiels de l’acte de base. Selon elles, la compétence d’exécution de la Commission au titre de l’article 118, paragraphes 4 et 6, du règlement 2021/2115 ne dépend pas uniquement de l’existence d’une délégation de pouvoir l’autorisant à adopter une telle décision d’approbation, mais également du respect par l’acte d’exécution des éléments essentiels de l’acte de base, conformément à l’article 291 TFUE.
49
La Commission, soutenue par la République française, conteste les arguments des requérantes.
50
Aux termes de l’article 291, paragraphe 1, TFUE, les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union. Cependant, comme le prévoit son paragraphe 2, lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d’exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés ainsi que dans le cadre de la politique extérieure et de sécurité commune, au Conseil de l’Union européenne. Selon l’article 291, paragraphe 4, TFUE, le mot « d’exécution » est inséré dans l’intitulé des actes d’exécution.
51
Il ressort de la décision d’approbation que celle-ci est fondée sur l’article 118, paragraphe 6, du règlement 2021/2115 selon lequel la Commission approuve chaque PSPAC au moyen d’une décision d’exécution sous réserve du respect des exigences mentionnées au paragraphe 4 de cet article.
52
Dans ces conditions, la compétence d’exécution conférée à la Commission est délimitée à la fois par l’article 291, paragraphe 2, TFUE et par l’article 118 du règlement 2021/2115.
53
Selon la jurisprudence de la Cour, la notion d’« exécution » comprend à la fois l’élaboration de règles d’application et l’application de règles à des cas particuliers par le moyen d’actes de portée individuelle (voir arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P , EU:C:2016:128 , point 36 et jurisprudence citée).
54
En l’espèce, la décision d’approbation a pour objet l’approbation de la proposition de PSPAC français afin que celui-ci puisse produire ses effets juridiques conformément à l’article 118, paragraphes 4 et 7, du règlement 2021/2115.
55
Ainsi, la décision d’approbation vient attester de la conformité d’un acte national, à savoir le PSPAC français, à une série de conditions énoncées dans le règlement 2021/2115. Celle-ci s’adresse à la République française et constitue une étape préalable à la mise en œuvre du cadre juridique national régissant l’octroi des aides de l’Union aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires sur le fondement du PSPAC français tel qu’approuvé.
56
À cet égard, selon l’article 118, paragraphe 4, du règlement 2021/2115, la Commission approuve le PSPAC proposé à condition que les informations nécessaires aient été communiquées et qu’il soit compatible avec l’article 9 et les autres exigences énoncées dans ce règlement et dans le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil, du 2 décembre 2021, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n o 1306/2013 ( JO 2021, L 435, p. 187 ), ainsi qu’avec les actes délégués et d’exécution adoptés en application de ces actes.
57
Dans ce cadre, il ressort d’une lecture combinée des considérants 27, 97 et 110 ainsi que des articles 9 et 118 du règlement 2021/2115 que la procédure d’approbation a pour but d’assurer la conformité des PSPAC, adoptés par les États membres afin de mettre en œuvre la PAC au niveau national, avec les règles de l’Union, notamment avec les objectifs de la PAC tels qu’ils sont fixés par l’article 39 TFUE et précisés par ce règlement.
58
Il résulte des dispositions qui précèdent que la Commission s’est vu conférer une compétence d’exécution afin de contrôler la conformité de chaque proposition de PSPAC avec les exigences énoncées dans le règlement 2021/2115.
59
Ainsi, la compétence d’exécution conférée à la Commission par l’article 291 TFUE et l’article 118 du règlement 2021/2115 pour adopter une décision d’approbation est limitée au contrôle de la conformité d’un type d’acte particulier, à savoir les propositions de PSPAC. De ce fait, le respect des limites de cette compétence doit être examiné non seulement en fonction des objectifs généraux essentiels dudit règlement, mais aussi de l’ensemble des exigences mentionnées par l’article 118, paragraphe 4, du règlement 2021/2115.
60
En l’espèce, dans la sous-section 4.1 de l’annexe de la décision attaquée, en réponse au motif de réexamen tiré du défaut de compétence pour adopter la décision d’approbation, la Commission rappelle que, conformément à l’article 13, paragraphe 2, TUE, chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités. Selon elle, la question de savoir si un acte a été adopté sans habilitation s’apprécie en fonction de la base juridique qui permet à cette institution d’agir, qu’elle soit implicite ou expresse. À supposer que la Commission dépasse les limites des pouvoirs qui lui sont conférés pour adopter un acte juridique donné, elle demeurerait compétente pour l’adopter malgré l’illégalité commise dans l’exercice de cette compétence. De ce fait, elle estime que les arguments avancés au soutien de ce motif sont dépourvus de fondement dans le cadre d’une contestation fondée sur le non-respect du principe d’attribution des compétences.
61
En effet, la Commission relève, dans la décision attaquée, que l’article 118, paragraphes 4 et 6, du règlement 2021/2115 lui confère explicitement la compétence pour approuver les propositions de PSPAC des États membres. Elle précise que les décisions d’approbation adoptées sur ce fondement n’ont pas pour objectif de modifier ou de compléter l’acte de base, à savoir ledit règlement, ou d’élaborer des règles d’application. Dans ce cadre, elle rappelle que les PSPAC sont élaborés par les États membres, conformément à l’article 104 dudit règlement, afin de mettre en œuvre le soutien de l’Union pour la réalisation des objectifs spécifiques figurant à son article 6, paragraphes 1 et 2, et doivent satisfaire à l’ensemble des exigences énoncées dans ce règlement.
62
Ainsi, dans la décision attaquée, la Commission estime qu’elle doit vérifier si les arguments invoqués au soutien du motif tiré de son incompétence pour approuver le PSPAC français établissent l’existence de violations du règlement 2021/2115, des actes délégués ou des actes d’exécution adoptés en application de celui-ci dont les violations alléguées doivent être examinées en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement Aarhus étant donné qu’ils constituent le « droit de l’environnement » au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous f), du règlement Aarhus.
63
Toutefois, il convient de constater que le grief, invoqué de manière autonome par les requérantes, selon lequel la Commission a commis une erreur de droit en considérant qu’un acte d’exécution, tel que la décision d’approbation, n’avait pas à respecter les éléments essentiels de l’acte de base ne constitue pas une question relevant du droit de l’environnement au sens du règlement Aarhus. Dès lors, à le supposer fondé, ce grief ne conduirait pas à constater une violation du droit de l’environnement au sens du règlement Aarhus qui serait susceptible d’emporter l’annulation de la décision attaquée. En effet, ainsi que la Commission l’a relevé, dans le cadre d’un réexamen interne, elle n’est tenue d’examiner la demande que dans la mesure où l’auteur de cette demande fait valoir que l’acte administratif visé va à l’encontre du droit de l’environnement (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2018, TestBioTech/Commission, T‑33/16 , EU:T:2018:135 , points 48 , 68 et 78 ).
64
À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’aucune disposition des traités n’impose au juge de l’Union d’examiner, en tout état de cause, le bien-fondé des moyens ou des arguments soulevés à l’appui des demandes dont il est saisi. Au contraire, le juge de l’Union peut, notamment, pour des raisons tenant à une administration efficace de la justice, s’abstenir d’examiner le bien-fondé des moyens qui doivent être écartés comme étant irrecevables ou inopérants (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2022, HIM/Commission, C‑500/21 P , non publié, EU:C:2022:741 , points 72 et 73 ).
65
Le présent grief invoqué par les requérantes étant inopérant, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de celui-ci.
66
Partant, il y a lieu de rejeter le premier grief de la deuxième branche comme inopérant.
b) Sur le second grief, tiré du refus de la Commission de considérer les objectifs spécifiques environnementaux et climatiques du règlement 2021/2115 comme des éléments essentiels
67
Les requérantes font grief à la Commission d’avoir refusé dans la décision attaquée de considérer les objectifs spécifiques environnementaux et climatiques comme des éléments essentiels du règlement 2021/2115 au sens de la jurisprudence relative à l’article 291 TFUE.
68
La Commission, soutenue par la République française, conteste les arguments des requérantes.
69
En l’espèce, dans la sous-section 3.2 de l’annexe de la décision attaquée, la Commission estime que les objectifs spécifiques environnementaux et climatiques ne constituent pas des éléments centraux de la PAC. Selon elle, il n’existe pas de hiérarchie entre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6 du règlement 2021/2115 qui découlent de l’article 105 de ce règlement.
70
Par ailleurs, selon la sous-section 3.3 de l’annexe de la décision attaquée, l’approbation d’un PSPAC doit intervenir dès que la stratégie d’intervention qu’il contient et ses éléments sont adéquats pour atteindre les objectifs fixés dans le règlement 2021/2115 et qu’il est compatible avec ce même règlement et le règlement 2021/2116.
71
Ainsi, la Commission n’ayant pas commis d’erreur de droit en considérant, dans la décision attaquée, que la décision d’approbation devait respecter l’ensemble des exigences énoncées par le règlement 2021/2115, y compris son article 118, paragraphe 4, et celles auxquelles cet article renvoie, notamment le respect des objectifs spécifiques environnementaux et climatiques, son refus de qualifier lesdits objectifs généraux d’essentiels est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
72
Partant, il y a lieu de rejeter le second grief comme inopérant et, par voie de conséquence, la deuxième branche du premier moyen dans son ensemble.
2. Sur la première branche du premier moyen, tirée d’erreurs de droit relatives à la nature et à l’étendue du contrôle de la Commission au titre de l’article 118, paragraphes 3 et 4, du règlement 2021/2115
73
La première branche du premier moyen se subdivise en deux griefs, tirés, d’une part, d’une erreur de droit en ce qui concerne la nature du contrôle exercé par la Commission sur les propositions de PSPAC au titre de l’article 118, paragraphes 3 et 4, du règlement 2021/2115 et, d’autre part, d’une erreur de droit relative à la méconnaissance par la Commission de l’étendue de son contrôle sur les propositions de PSPAC.
a) Sur le premier grief, tiré de l’erreur de droit en ce qui concerne la nature du contrôle exercé par la Commission sur les propositions de PSPAC au titre de l’article 118, paragraphes 3 et 4, du règlement 2021/2115
74
Les requérantes font valoir, en substance, que les considérations formulées dans la section 3 de l’annexe de la décision attaquée sont entachées d’une erreur de droit en ce qui concerne la nature du contrôle exercé par la Commission sur les propositions de PSPAC au titre de l’article 118, paragraphes 3 et 4, du règlement 2021/2115. Selon elles, la Commission retient une interprétation excessivement restrictive qui se limite à la vérification du respect de la condition de forme portant sur la communication de toutes les informations nécessaires relatives à la proposition de PSPAC. L’autonomie des États membres dans la conception de la stratégie d’intervention de leurs PSPAC resterait soumise au respect du cadre et des objectifs posés par ledit règlement.
75
D’une part, les requérantes reprochent à la Commission, dans la sous-section 3.3 de l’annexe de la décision attaquée, d’avoir commis une erreur de droit quant à la nature des observations adressées à la République française au titre de l’article 118, paragraphe 3, du règlement 2021/2115. Elle aurait dénaturé la portée de ces observations en minimisant les points de non-conformité avec ledit règlement.
76
D’autre part, les requérantes considèrent que le rôle central de la Commission dans la phase d’approbation des propositions de PSPAC découle tant de l’article 118, paragraphe 4, du règlement 2021/2115 que de l’économie générale dudit règlement. Selon elles, cet article, lu conjointement avec l’article 109, paragraphe 2, et l’article 111, premier alinéa, sous c), du même règlement exige la satisfaction de conditions de fond par chaque proposition de PSPAC, notamment son article 9, et d’autres exigences que ce règlement énonce. À cet égard, seul un contrôle de la satisfaction des conditions de forme et de fond permettrait, d’une part, d’évaluer concrètement l’impact de la proposition de PSPAC, de questionner les explications et les choix de l’État membre et de signaler les éventuelles incompatibilités et les insuffisances persistantes et, d’autre part, de garantir le caractère commun de la PAC en évitant tout risque de renationalisation.
77
Ainsi, les requérantes estiment que le contrôle des conditions de fond à la charge de la Commission doit non seulement reposer sur les analyses attendues des États membres au titre du règlement 2021/2115, mais aussi sur ses propres connaissances et, le cas échéant, sur les rapports d’analyse disponibles sur le sujet. Ainsi, ni la complexité du sujet ni le délai pour approuver chaque proposition ne seraient de nature à justifier un allègement du degré de contrôle exercé sur les propositions de PSPAC.
78
Dans le cadre de ce grief, les requérantes contestent l’interprétation faite par la Commission, dans la décision attaquée, de l’article 118, paragraphes 3 et 4, du règlement 2021/2115.
79
Il convient d’examiner le cadre juridique qui confère à la Commission un tel pouvoir d’approbation des propositions de PSPAC avant de vérifier l’existence d’une prétendue erreur de droit dans la réponse apportée à la demande de réexamen interne des requérantes dans la décision attaquée.
1) Sur la nature du contrôle exercé au titre de l’article 118, paragraphes 3 et 4, du règlement 2021/2115
80
Il y a lieu de rappeler que l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union requiert de tenir compte non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit ainsi que des objectifs et de la finalité que poursuit l’acte dont elle fait partie, voire de sa genèse [voir, en ce sens, arrêts du 25 juin 2020, A e.a. (Éoliennes à Aalter et à Nevele), C‑24/19 , EU:C:2020:503 , point 37 , et du 3 septembre 2024, Illumina et Grail/Commission, C‑611/22 P et C‑625/22 P , EU:C:2024:677 , points 126 et 127 et jurisprudence citée].
81
L’article 118 du règlement 2021/2115 organise la procédure d’évaluation et d’approbation de chaque proposition de PSPAC. Son paragraphe 1 prévoit que chaque État membre soumet à la Commission une proposition de PSPAC.
82
L’article 118, paragraphe 2, du règlement 2021/2115 dispose que la Commission se livre à une évaluation du PSPAC qui lui est soumis au regard de son exhaustivité, de sa cohérence, de sa compatibilité avec les principes généraux du droit de l’Union, avec ledit règlement et les actes délégués et d’exécution adoptés en application de celui-ci et avec le règlement 2021/2116, de sa contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement 2021/2115, et de ses incidences sur le bon fonctionnement du marché intérieur et les distorsions de concurrence et sur le niveau de charge administrative pesant sur les bénéficiaires et l’administration.
83
Selon l’article 118, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement 2021/2115, la Commission peut adresser des observations à l’État membre dans un délai de trois mois à compter de la date de soumission de la proposition de PSPAC. Son second alinéa prévoit que l’État membre est tenu de lui communiquer toutes les informations supplémentaires nécessaires et, s’il y a lieu, de revoir la proposition de PSPAC.
84
L’article 118, paragraphe 4, du règlement 2021/2115 fixe les critères d’approbation des propositions de PSPAC. Premièrement, les informations nécessaires visées à l’article 118, paragraphe 3, du même règlement doivent avoir été communiquées à la Commission et, deuxièmement, la proposition de PSPAC doit être compatible avec l’article 9 et les autres exigences énoncées dans ledit règlement et dans le règlement 2021/2116 ainsi qu’avec les actes délégués et d’exécution adoptés en application de ces actes. L’approbation se fonde exclusivement sur des actes qui sont juridiquement contraignants pour les États membres.
85
En premier lieu, d’une part, il résulte du libellé de l’article 118 du règlement 2021/2115 que, selon son paragraphe 3, les observations de la Commission peuvent porter non seulement sur la production d’informations complémentaires, mais aussi conduire à une révision de la proposition de PSPAC. L’emploi de l’expression « s’il y a lieu » implique que la nécessité de procéder à des modifications dépend de la nature de ces observations. Ainsi, les observations de la Commission peuvent identifier la présence d’incompatibilités entre la proposition de PSPAC et les exigences énoncées à l’article 118, paragraphe 4, du règlement 2021/2115. Dès lors, l’État membre sera dans l’obligation de la modifier en vue d’obtenir l’approbation de la Commission. Cependant, ces observations peuvent également contenir des suggestions sur la manière dont l’État membre pourrait améliorer sa proposition de PSPAC, voire des interrogations sur certains aspects de celui-ci, sans pour autant en requérir une quelconque révision.
86
De plus, il convient de rappeler que les observations adressées par la Commission sur chaque proposition de PSPAC ne constituent qu’une mesure intermédiaire dans le cadre du processus d’élaboration du PSPAC. En effet, l’article 118, paragraphe 4, du règlement 2021/2115 prévoit que l’approbation résulte de l’examen de la proposition révisée de PSPAC.
87
D’autre part, selon l’article 118, paragraphe 4, du règlement 2021/2115, la Commission exerce un double contrôle sur la proposition de PSPAC, à savoir, d’une part, sa complétude au regard de l’ensemble des informations nécessaires et, d’autre part, sa compatibilité par rapport à des exigences limitativement énumérées tirées du droit de l’Union.
88
En deuxième lieu, l’interprétation contextuelle corrobore l’interprétation littérale mentionnée aux points 83 à 87 ci-dessus.
89
Selon l’article 118 du règlement 2021/2115, d’abord, la Commission procède à une évaluation de chaque proposition de PSPAC par rapport à une liste limitative de critères énoncés par son paragraphe 2. La Commission vérifie son exhaustivité, sa cohérence, sa compatibilité avec les principes généraux du droit de l’Union, avec ledit règlement, avec les actes délégués et d’exécution adoptés en application de celui-ci et avec le règlement 2021/2116, sa contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement 2021/2115, et ses incidences sur le bon fonctionnement du marché intérieur et les distorsions de concurrence et sur le niveau de charge administrative pesant sur les bénéficiaires et l’administration. La seconde phrase de cet article précise que l’évaluation porte « en particulier » sur l’adéquation d’une série d’éléments qui composent ces propositions. L’usage d’une telle expression indique qu’il ne s’agit pas d’une évaluation supplémentaire, mais bien d’une des composantes de cette phase.
90
Ensuite, la Commission entame une procédure avec l’État membre au cours de laquelle elle va pouvoir formuler des observations conformément à l’article 118, paragraphe 3, du règlement 2021/2115. Comme cela est rappelé aux points 83 et 85 ci-dessus, ledit article précise que le contenu de ces observations dépend des résultats de l’évaluation de chaque proposition de PSPAC à laquelle la Commission a dû se livrer préalablement. Il n’est pas prévu qu’elles se limitent aux seuls problèmes de compatibilité avec ledit règlement. Cet article fixe également les conséquences potentielles à tirer desdites observations.
91
Enfin, à l’issue d’un dialogue avec l’État membre, la Commission adopte une décision d’exécution sur l’approbation de la proposition de PSPAC, éventuellement modifiée à la suite de ses observations, à condition que cette dernière soit compatible avec les exigences énoncées dans la réglementation de l’Union mentionnées à l’article 118, paragraphe 4, du règlement 2021/2115. Dans ce cadre, il convient de relever que l’article 118, paragraphe 5, dudit règlement précise que l’approbation doit intervenir au plus tard six mois après la soumission de la proposition de PSPAC par l’État membre concerné et que celle-ci ne porte ni sur les informations figurant à son article 113, sous c), ni sur celles figurant aux annexes I à IV de la proposition de PSPAC visées à son article 107, paragraphe 2, sous a) à d), et qui contiennent respectivement l’évaluation ex ante, y compris l’évaluation environnementale stratégique, l’analyse de la situation sous l’angle des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces (ci-après l’« analyse SWOT »), la consultation des partenaires et l’aide spécifique au coton conformément à l’article 115, paragraphes 1 à 4, du même règlement.
92
Par ailleurs, l’article 1 er , paragraphe 2, du règlement 2021/2115 rappelle que la Commission approuve les PSPAC et que les États membres les élaborent.
93
S’agissant du rôle des États membres, selon l’article 104, paragraphe 1, du règlement 2021/2115, ils établissent des PSPAC afin de mettre en œuvre les aides de l’Union financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).
94
À cet égard, selon l’article 8 du règlement 2021/2115, les États membres s’efforcent d’atteindre les objectifs énoncés aux articles 5 et 6 dudit règlement en précisant les interventions fondées sur les types d’interventions prévues par ledit règlement conformément à l’évaluation de leurs besoins et aux exigences communes prévues par le même règlement.
95
Dans ce cadre, les articles 9 à 84 du règlement 2021/2115 déterminent les types d’interventions ainsi que les exigences communes à appliquer par les États membres afin de garantir le caractère commun de la PAC. Les articles 107 à 115 dudit règlement fixent des exigences en matière de contenu des PSPAC. Ceux-ci constituent des documents d’orientation sur la stratégie adoptée par chaque État membre afin de mettre en œuvre la PAC.
96
S’agissant de la Commission, premièrement, ainsi qu’il ressort notamment de l’article 152 du règlement 2021/2115, elle adopte les différents actes délégués nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement. Deuxièmement, elle est chargée d’adopter des actes d’exécution ainsi que cela ressort de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 37, paragraphe 6, de l’article 38, paragraphe 6, de l’article 59, paragraphe 8, de l’article 117, de l’article 123, paragraphe 5, de l’article 126, paragraphe 5, de l’article 133, de l’article 134, paragraphe 14, de l’article 143, paragraphe 4, de l’article 148 et de l’article 150, paragraphe 3, dudit règlement. Troisièmement, selon les articles 120 à 143 du même règlement, la Commission assure le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des PSPAC tels qu’approuvés par les États membres.
97
Ainsi, il découle du règlement 2021/2115 une répartition des tâches entre les États membres et la Commission favorisant une plus grande subsidiarité au sein d’un cadre commun qui doit assurer l’alignement des choix effectués au niveau national avec les priorités et les objectifs de l’Union.
98
En troisième lieu, l’interprétation téléologique corrobore l’interprétation littérale et contextuelle mentionnée aux points 83 à 97 ci-dessus.
99
Dans ce cadre, il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, TFUE, les compétences partagées entre l’Union et les États membres s’appliquent, notamment, au domaine de l’agriculture.
100
De plus, l’article 5 du règlement 2021/2115 rappelle que les objectifs de la PAC doivent être poursuivis dans le respect du principe de subsidiarité.
101
Dans ce contexte, selon le considérant 3 du règlement 2021/2115, le mode de gestion de la PAC suit désormais une nouvelle approche qui repose sur l’idée que l’Union fixe les paramètres essentiels de la politique, tandis que les États membres assument une plus grande part de responsabilité dans la manière dont ils réalisent ces objectifs et atteignent les valeurs cibles. De ce fait, une plus grande subsidiarité permet de mieux tenir compte des conditions et des besoins locaux ainsi que de la nature particulière de l’activité agricole. À cet égard, il ressort des considérants 27, 96 et 97 dudit règlement qu’il organise un transfert de responsabilité vers les États membres.
102
Ainsi, le nouveau mode de gestion de la PAC mis en place par le législateur de l’Union repose sur un système de collaboration qui laisse aux États membres une marge de manœuvre afin d’adapter les interventions aux nécessités et aux besoins spécifiques de leur agriculture nationale tout en prévoyant un contrôle de l’Union pour en assurer la compatibilité avec la PAC (ordonnance du 17 octobre 2024, Complejo Agrícola Las Lomas/Commission, T‑729/22 , EU:T:2024:711 , point 70 ).
103
Il découle de l’ensemble des éléments rappelés précédemment que, d’une part, les observations formulées par la Commission au titre de l’article 118, paragraphe 3, du règlement 2021/2115 ne présentent pas un caractère contraignant par elles-mêmes, mais que leur contenu doit conduire l’État membre auteur de la proposition de PSPAC à y apporter des modifications si elles révèlent la présence d’incompatibilités avec les exigences énoncées à l’article 118, paragraphe 4, dudit règlement constituant des obstacles à l’approbation dudit plan et, d’autre part, au titre de cette même disposition, la Commission doit assurer un contrôle de compatibilité des propositions de PSPAC avec les exigences énoncées dans la réglementation de l’Union mentionnées audit paragraphe.
2) Sur l’interprétation de la Commission dans la décision attaquée
104
Dans la sous-section 3.3 de l’annexe de la décision attaquée, la Commission rappelle, d’abord, que l’approbation de chaque proposition de PSPAC comprend trois étapes, à savoir l’évaluation, puis la formulation d’observations et, enfin, l’approbation. Selon elle, l’article 118, paragraphes 2 et 4, du règlement 2021/2115 l’oblige à approuver une proposition de PSPAC dès lors qu’il est établi que sa stratégie d’intervention et ses éléments sont adéquats pour atteindre les objectifs fixés dans cette proposition et qu’elle est compatible avec ce même règlement et le règlement 2021/2116. Elle précise que l’approbation s’appuie uniquement sur des éléments juridiquement contraignants pour les États membres.
105
De plus, la Commission rappelle que, en ce qui concerne les observations adressées aux États membres au titre de l’article 118, paragraphe 3, du règlement 2021/2115, elles constituent une étape intermédiaire dans le processus d’approbation du PSPAC, qui peut être suivie d’autres échanges avec les États membres sur des aspects spécifiques de leurs propositions de PSPAC. Selon elle, en fonction des difficultés identifiées au cours de l’évaluation, premièrement, ses observations peuvent inviter ou demander à l’État membre de rectifier certains éléments de la proposition de PSPAC, susceptibles de ne pas être compatibles avec l’article 9 dudit règlement, avec d’autres de ses exigences ou avec le règlement 2021/2116. Deuxièmement, ces observations peuvent contenir des invitations ou des suggestions sur la manière d’améliorer la cohérence des interventions, le niveau d’ambition du PSPAC dans son ensemble, en ce qui concerne les objectifs spécifiques environnementaux et climatiques, ou l’ambition des objectifs spécifiques, la conception des interventions, leur cohérence, ainsi que des suggestions sur la manière de réduire la charge administrative lors de la mise en œuvre dudit plan. Troisièmement, ces observations peuvent porter sur des éléments de la proposition de PSPAC qui ne sont pas clairs, qui sont incomplets, qui manquent de détails, qui suscitent des doutes ou qui pourraient bénéficier d’une explication supplémentaire ou d’une amélioration, même s’il s’agit d’éléments que les États membres sont libres de choisir ou de concevoir eux-mêmes.
106
De ce fait, la Commission considère que la réponse d’un État membre à ses observations peut varier selon leur contenu et qu’elle n’aboutit pas systématiquement à une modification de la proposition de PSPAC, une clarification ou une explication supplémentaire pouvant être suffisante.
107
En ce qui concerne plus spécifiquement l’exigence d’adéquation, la Commission précise que celle-ci est remplie lorsque la stratégie d’intervention proposée est alignée sur l’analyse SWOT et la définition des besoins, lorsque son architecture environnementale et climatique est cohérente avec les objectifs nationaux fondés sur la législation de l’Union énumérés à l’annexe XIII du règlement 2021/2115 et susceptible d’y contribuer et lorsque que la stratégie d’intervention, dans son ensemble, est destinée à contribuer effectivement aux objectifs spécifiques définis dans ledit règlement et susceptible d’y contribuer.
108
Ensuite, la Commission insiste sur le fait que, d’une part, le règlement 2021/2115 confie certaines tâches et décisions exclusivement ou principalement aux États membres, notamment son article 115, paragraphe 2, et son article 103, ou exclut des éléments de la procédure d’approbation, tels que son article 113, sous c), et son article 118, paragraphe 5. D’autre part, selon la Commission, ce règlement limite la portée de son examen en ce qui concerne certains éléments des propositions de PSPAC, notamment lorsque certaines procédures prescrites sont suivies ou lorsque l’élément considéré a été conçu ou calculé à l’aide des méthodes prescrites par celui-ci.
109
Enfin, la Commission considère que le règlement 2021/2115 ne l’habilite ni à prescrire aux États membres comment certaines interventions ou éléments dudit règlement doivent être mis en œuvre en détail, ni un niveau d’ambition minimal en ce qui concerne les objectifs poursuivis ou les indicateurs d’impact, ni à fixer les modalités détaillées de la mise en œuvre des exigences en matière de conditionnalité. Selon elle, conformément au nouveau cadre réglementaire qui offre une plus grande souplesse aux États membres, un tel standard de contrôle découle des limites que ce règlement lui impose dans le processus d’approbation des propositions de PSPAC et de répartition des tâches entre elle et les États membres dans la préparation, l’évaluation et l’approbation de ces propositions.
110
Partant, la Commission n’a commis aucune erreur de droit quant à l’interprétation de l’article 118, paragraphe 4, du règlement 2021/2115 en constatant que son rôle dans le cadre de l’évaluation et de l’approbation de chaque proposition de PSPAC se limitait à s’assurer de leur compatibilité avec une liste d’exigences tirées du droit de l’Union, notamment en appréciant la contribution de ladite proposition aux objectifs de cette réglementation.
111
Les arguments avancés par les requérantes ne sont pas de nature à remettre en cause un tel constat.
112
Premièrement, il ne ressort pas de la décision attaquée que la Commission considère que son contrôle se limite à la satisfaction d’une condition formelle, mais bien d’un ensemble d’exigences spécifiques, ainsi que cela ressort des éléments rappelés aux points 104 et 107 ci-dessus.
113
Deuxièmement, s’agissant de l’argument tiré de l’obligation pour la Commission de s’appuyer, lors de l’examen des propositions de PSPAC, non seulement sur les analyses attendues des États membres au titre du règlement 2021/2115, mais aussi sur ses propres connaissances et, le cas échéant, sur des rapports externes, il convient de rappeler que ledit règlement organise une répartition spécifique des rôles entre la Commission et les États membres en matière d’analyses factuelles.
114
À cet égard, le nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC, tel qu’il résulte du règlement 2021/2115, notamment de ses considérants 99 et 100, met l’accent sur l’importance de l’analyse préalable de la situation nationale et l’identification des besoins nationaux spécifiques afin de concevoir les PSPAC. Selon ce règlement, un tel processus devrait favoriser une plus grande subsidiarité au sein d’un cadre commun de l’Union.
115
À cette fin, le règlement 2021/2115 confie aux États membres la réalisation des analyses du contexte agricole, tant au niveau national que régional. La première de ces analyses, prévue par l’article 108 dudit règlement, porte sur l’évaluation des besoins, la deuxième, au titre de l’article 115, paragraphe 2, du même règlement, est l’analyse SWOT et, la troisième, énoncée à l’article 139 de ce règlement, appelée analyse ex ante, vise à apprécier l’impact de la proposition de PSPAC selon plusieurs critères, dont sa contribution à la réalisation des objectifs spécifiques.
116
De plus, l’article 118, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement 2021/2115 prévoit notamment que l’approbation ne porte pas sur les informations rappelées au point 115 ci-dessus.
117
Ainsi, la procédure d’approbation n’oblige pas la Commission à faire siennes les analyses réalisées par les États membres et rappelées au point 115 ci-dessus ni à les compléter par d’autres analyses.
118
En l’espèce, la Commission n’a pas commis d’erreur de droit dans la décision attaquée, notamment dans la sous-section 3.3 de son annexe, lorsqu’elle a rappelé que le règlement 2021/2115 ne lui conférait pas, aux fins de l’évaluation des propositions de PSPAC, des pouvoirs d’investigation qui lui permettaient de procéder à ses propres enquêtes ou même à des vérifications et des contrôles des informations sur lesquelles ces propositions étaient fondées. De même, le simple constat fait par la Commission, dans la même sous-section de l’annexe de la décision attaquée, selon lequel outre ces informations, elle peut utiliser, pour l’évaluation des propositions de PSPAC, d’autres informations dont elle dispose déjà ne constitue pas une erreur de droit quant à la nature du contrôle prévu par l’article 118, paragraphe 4, dudit règlement.
119
Troisièmement, il ne ressort pas de la réponse de la Commission dans la sous-section 3.3 de l’annexe de la décision attaquée qu’elle ait considéré que l’intensité de son contrôle sur les propositions de PSPAC dans le cadre de la procédure d’approbation se trouvait réduite en raison de la complexité du sujet et du délai de six mois dans lequel elle devait les approuver après leur soumission, conformément à l’article 118, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement 2021/2115.
120
En effet, dans la décision attaquée, la Commission ne fait que rappeler les limites de son contrôle, tel qu’il ressort de l’article 118, paragraphes 2 et 4, du règlement 2021/2115, en soulignant que l’élaboration des PSPAC repose sur une analyse prospective sur une période d’au moins cinq ans, impliquant un niveau considérable d’incertitude sur les évolutions futures affectant le domaine agricole.
121
Par conséquent, il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la Commission n’a commis aucune erreur de droit dans la décision attaquée en rappelant les spécificités de la procédure d’approbation des propositions de PSPAC au titre de l’article 118, paragraphes 3 et 4, du règlement 2021/2115.
122
Partant, il y a lieu de rejeter le premier grief de la première branche comme non fondé.
b) Sur le second grief, tiré de l’erreur de droit relative à l’étendue du contrôle exercé sur la stratégie d’intervention par la Commission au titre de l’article 118, paragraphe 4, du règlement 2021/2115
123
Les requérantes font valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit quant à l’étendue du contrôle que la Commission doit exercer au titre de l’article 118, paragraphes 2 et 4, du règlement 2021/2115. Selon elles, la Commission ne doit pas se limiter à un contrôle global de la stratégie d’intervention et de la contribution globale de la proposition de PSPAC français en lien avec les objectifs spécifiques, mais doit analyser l’efficacité des mesures incluses dans ledit PSPAC pour contribuer à leur réalisation.
124
Les requérantes considèrent que la Commission doit apprécier, d’une part, la contribution effective de la stratégie d’intervention, c’est-à-dire sa capacité à produire les résultats désirés ou revendiqués, et, d’autre part, la contribution cohérente de l’architecture environnementale aux valeurs cibles nationales à long terme relatives aux objectifs environnementaux et climatiques, à savoir l’apport de cette architecture à la réalisation de ces valeurs à la mesure de l’importance du PSPAC pour les atteindre dans le secteur agricole. À cette fin, il serait nécessaire d’examiner les mesures essentielles prévues dans le PSPAC français pour répondre aux besoins prioritaires et atteindre les objectifs spécifiques environnementaux et climatiques ou lesdites valeurs cibles nationales à long terme.
125
La Commission, soutenue par la République française, conteste les arguments des requérantes.
126
Selon l’article 118, paragraphe 2, du règlement 2021/2115, rappelé au point 89 ci-dessus, la Commission doit évaluer, notamment, la contribution effective de la proposition de PSPAC à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. Cette évaluation porte « en particulier » sur l’adéquation d’une série d’éléments qui composent la proposition de PSPAC.
127
La procédure d’approbation prévoit que la Commission s’assure de la capacité de la stratégie d’intervention contenue dans la proposition de PSPAC à produire des effets concrets et coordonnés dans le but d’atteindre les objectifs spécifiques fixés par l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement 2021/2115.
128
À cet égard, l’article 109 du règlement 2021/2115 relatif à la stratégie d’intervention précise qu’elle doit décrire, notamment, comment les interventions permettent d’atteindre les valeurs cibles, y compris celles fixées pour les objectifs spécifiques environnementaux et climatiques, et de quelle manière elles sont cohérentes et compatibles entre elles. Il en va de même pour l’affectation des ressources financières qui doit être justifiée et appropriée pour atteindre lesdites valeurs cibles. De plus, l’article 109, paragraphe 2, sous a), du même règlement ajoute que cette stratégie d’intervention doit démontrer sa cohérence et la complémentarité des interventions liées aux objectifs spécifiques en fournissant, notamment, une vue d’ensemble de l’architecture environnementale et climatique décrivant la manière dont chaque norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (ci-après les « BCAE ») est mise en œuvre, la contribution globale de la conditionnalité pour atteindre les objectifs spécifiques environnementaux et climatiques, la complémentarité entre plusieurs formes d’aides tendant aux mêmes objectifs spécifiques, la manière d’atteindre la contribution globale supérieure mentionnée à l’article 105 dudit règlement et la manière dont cette architecture environnementale et climatique est censée contribuer de façon cohérente à la réalisation des valeurs cibles nationales à long terme.
129
S’agissant des ambitions accrues concernant les objectifs spécifiques environnementaux et climatiques, l’article 105 du règlement 2021/2115 prévoit que les États membres s’efforcent d’apporter une contribution globale à leur réalisation qui est supérieure à celle apportée à la réalisation de l’objectif fixé par la réglementation antérieure au cours de la période 2014-2020. Il ajoute que les PSPAC expliquent comment ils entendent apporter une telle contribution globale supérieure.
130
De plus, il convient de rappeler que le nouveau modèle de mise en œuvre sur lequel repose le règlement 2021/2115 entend favoriser une plus grande subsidiarité en conférant aux États membres une marge d’appréciation supplémentaire dans l’arrangement particulier des interventions contenues dans chaque PSPAC.
131
À cette fin, le règlement 2021/2115 fixe les paramètres essentiels afin de mettre en œuvre la PAC, à savoir les objectifs de l’Union, les types d’interventions et les exigences communes dont le respect est assuré par la Commission dans le cadre de la procédure d’approbation prévue par l’article 118 dudit règlement.
132
Dans ce cadre, le règlement 2021/2115 ne comprend de mécanisme d’ajustement ni des interventions au sein de la stratégie d’intervention en ce qui concerne leur contribution pour atteindre les objectifs spécifiques environnementaux et climatiques, ni de la participation du PSPAC dans la réalisation des valeurs cibles nationales à long terme relatives aux objectifs environnementaux et climatiques.
133
Ainsi, le règlement 2021/2115 exige de chaque État membre qu’il élabore un PSPAC apportant une contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, dudit règlement dont la réalisation est mesurée grâce à des indicateurs et à des valeurs-cibles.
134
Néanmoins, le règlement 2021/2115 ne met pas à la charge des États membres une obligation de résultat à l’occasion de la mise en œuvre de la PAC, mais bien une obligation de moyens. En effet, la formulation des objectifs généraux et spécifiques confirme que les États membres ne sont pas tenus d’atteindre un résultat déterminé et précisément quantifié. À cet égard, l’article 5, sous b), dudit règlement prévoit que l’aide du FEAGA et du Feader contribue à la réalisation de divers objectifs généraux, notamment celui de « soutenir et renforcer la protection de l’environnement ». Ainsi, s’agissant des objectifs spécifiques environnementaux et climatiques, l’article 6, paragraphe 2, sous d) à f), du même règlement précise que les aides visent à « contribuer à l’atténuation du changement climatique et [à] promouvoir les énergies renouvelables », à « favoriser le développement durable et la gestion efficiente des ressources naturelles » et à « contribuer à mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité […], [à] améliorer les services écosystémiques et [à] préserver les habitats et les paysages ».
135
Partant, la Commission doit apprécier, selon une approche globale, dans le cadre de son contrôle de compatibilité, la contribution effective de la proposition de PSPAC à la réalisation des objectifs généraux et spécifiques en examinant la stratégie d’intervention à l’égard à la fois de son niveau d’ambition et de sa capacité à produire les effets attendus pour satisfaire à l’obligation de moyens à la charge des États membres, y compris les objectifs spécifiques environnementaux et climatiques.
136
En l’espèce, dans la sous-section 3.2 de l’annexe de la décision attaquée, la Commission explique que son rôle consiste, au titre de l’évaluation prévue à l’article 118, paragraphe 2, du règlement 2021/2115, à vérifier si les informations et les justifications fournies par l’État membre sont complètes, si elles expliquent de manière claire, cohérente, logique, concise et crédible le fonctionnement de la stratégie d’intervention et des interventions, leur contribution effective aux objectifs spécifiques environnementaux et climatiques, leur cohérence avec d’autres interventions contribuant aux objectifs spécifiques et la conformité de chaque intervention avec les exigences générales et spécifiques dudit règlement qui lui sont applicables. La Commission précise, en ce qui concerne l’architecture environnementale et climatique, qu’elle vérifie sa conformité avec les exigences de l’article 109, paragraphe 2, sous a), dudit règlement, y compris sa contribution et sa cohérence avec les valeurs cibles nationales à long terme.
137
De plus, la Commission, dans la sous-section 3.3 de l’annexe de la décision attaquée, rappelée aux points 104 et 107 ci-dessus, confirme qu’elle doit vérifier dans le cadre de la procédure d’approbation tant la contribution effective de la stratégie d’intervention du PSPAC et des éléments qui le composent aux objectifs généraux et spécifiques que la compatibilité dudit plan avec les exigences de droit de l’Union limitativement énumérées à l’article 118, paragraphe 4, du règlement 2021/2115. Elle prend soin de préciser qu’il s’agit bien de s’assurer de la satisfaction par les États membres des obligations de moyen mis à leur charge par ce règlement.
138
Il ne ressort pas de la décision attaquée que la Commission a considéré que, dans le cadre de la procédure d’approbation du PSPAC français, elle devait se limiter à une appréciation globale dudit plan sans vérifier les mesures qu’il contenait. Au contraire, il ressort de la décision attaquée que la Commission estime que son contrôle doit porter sur l’ensemble des éléments qui composent la proposition de PSPAC dès lors qu’elle est tenue d’apprécier non seulement les effets individuels des mesures, mais également leurs effets coordonnés.
139
Il s’ensuit que le second grief de la première branche doit être rejeté comme non fondé et, par voie de conséquence, la première branche du premier moyen.
3. Sur la troisième branche du premier moyen, tirée du fait que la Commission a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en concluant que le PSPAC français satisfaisait aux éléments essentiels du règlement 2021/2115
140
Les requérantes considèrent que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la sous-section 4.1 de l’annexe de la décision attaquée en considérant que le PSPAC français satisfaisait aux éléments essentiels du règlement 2021/2115 en matière environnementale et climatique. Elles soutiennent que des points de non-conformité avec des éléments essentiels dudit règlement n’ont pas été corrigés dans la version révisée de la proposition de PSPAC français, notamment en ce qui concerne les objectifs spécifiques environnementaux et climatiques de réduction des émissions de GES, de protection des ressources en eau ainsi que de préservation et de restauration de la biodiversité.
[ omissis ]
143
Il convient de relever que, par la troisième branche du premier moyen, les requérantes reprochent, en substance, à la Commission d’avoir entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en concluant à la compatibilité du PSPAC français avec les objectifs spécifiques environnementaux et climatiques.
144
Par ailleurs, les requérantes reprochent également à la Commission, dans leurs deuxième, troisième et quatrième moyens, d’avoir commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation en considérant que la décision d’approbation était compatible avec les objectifs spécifiques environnementaux et climatiques.
145
Partant, il y a lieu de joindre l’examen de la troisième branche du premier moyen, portant sur le respect des objectifs spécifiques environnementaux et climatiques, à l’examen des deuxième, troisième et quatrième moyens.
146
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme partiellement inopérant et partiellement non fondé et de renvoyer à l’examen des deuxième, troisième et quatrième moyens pour le surplus.
[ omissis ]
E. Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation quant à la contribution du PSPAC français à la réalisation de l’objectif spécifique E et aux valeurs cibles nationales à long terme relatives à cet objectif
223
Le troisième moyen se subdivise en deux branches, tirées, la première, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la contribution effective de la stratégie d’intervention du PSPAC français à l’objectif spécifique E, notamment la protection des ressources en eau, et, la seconde, d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la contribution effective du PSPAC français à la réalisation des valeurs cibles nationales à long terme en matière de protection des ressources en eau découlant de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ( JO 2000, L 327, p. 1 ) et de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ( JO 1991, L 375, p. 1 ).
1. Sur la première branche du troisième moyen, tirée de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la contribution effective de la stratégie d’intervention du PSPAC français à l’objectif spécifique E, en particulier à la protection des ressources en eau
224
Les requérantes font valoir que la Commission a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en concluant que la stratégie d’intervention du PSPAC français contribuait de manière effective à la protection des ressources en eau, énoncée dans le cadre de l’objectif spécifique E, alors qu’elle ne permet pas une réduction de l’utilisation des pesticides en raison du non-respect de la norme BCAE 7 et de l’éco-régime tels qu’ils sont définis par le règlement 2021/2115.
225
La première branche du troisième moyen se subdivise en cinq griefs, tirés, premièrement, du caractère prioritaire de la réduction de l’utilisation des pesticides dans le cadre de la réalisation de l’objectif spécifique E, deuxièmement, de l’inadéquation de la logique d’examen retenue par la Commission pour apprécier la contribution de la stratégie d’intervention à l’objectif spécifique E, troisièmement, du non-respect par le PSPAC français de la norme BCAE 7 prévue à l’article 13 du règlement 2021/2115, quatrièmement, du non-respect par le PSPAC français de l’éco-régime prévu à l’article 31 dudit règlement et, cinquièmement, de l’incapacité de la stratégie d’intervention à atteindre l’objectif spécifique E en raison des limites associées aux conditions de mise en œuvre de la norme BCAE 7 et de l’éco-régime par les autorités françaises.
[ omissis ]
c) Sur le troisième grief, tiré du non-respect par la norme BCAE 7 mise en œuvre par le PSPAC français de l’article 13 du règlement 2021/2115 ainsi que des exigences minimales fixées par ce règlement
246
Ainsi que cela est rappelé aux points 103 et 135 ci-dessus, au titre de l’article 118, paragraphe 4, du règlement 2021/2115, la Commission doit s’assurer de la compatibilité de chaque proposition de PSPAC avec certaines exigences du droit de l’Union, en particulier les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les dispositions du règlement 2021/2115 et du règlement 2021/2116, ainsi que les dispositions des actes délégués et d’exécution adoptés en application de ces règlements. Ce contrôle de compatibilité requiert une appréciation non seulement de la contribution effective de la stratégie d’intervention de chaque plan à la réalisation des objectifs spécifiques selon une approche globale, mais aussi de l’absence de contrariété des mesures qu’ils contiennent avec les exigences minimales de droit de l’Union énoncées par cet article.
247
Dans le cadre du troisième grief de la première branche du troisième moyen, les requérantes font valoir que la norme BCAE 7, telle que mise en œuvre par le PSPAC français, n’est conforme ni à l’article 13, paragraphe 1, du règlement 2021/2115 ni aux exigences minimales de l’annexe III dudit règlement, ce qui constitue une violation de l’article 118, paragraphe 4, dudit règlement. De plus, les dérogations à la règle générale de rotation annuelle des cultures ne seraient permises qu’au niveau des régions ou des exploitations présentant certaines caractéristiques. En outre, l’évaluation de la contribution globale de la conditionnalité aux objectifs spécifiques ne s’opposerait pas à une évaluation concrète des normes BCAE telles que mises en œuvre par le PSPAC, ainsi que cela ressortirait de l’article 109, paragraphe 2, sous a), ii), du même règlement.
248
La Commission, soutenue par la République française, conteste les arguments des requérantes. Selon elle, la mise en œuvre de la norme BCAE 7 par le PSPAC français répond aux exigences minimales fixées par l’article 13, paragraphe 1, du règlement 2021/2115 et précisées dans l’annexe III dudit règlement, qui permettent aux États membres de mettre en œuvre ladite norme avec une certaine flexibilité afin de tenir compte de la diversité des méthodes et des conditions agricoles dans les différentes régions du pays. De plus, des exceptions seraient possibles pour autant qu’elles garantissent la réalisation de l’objectif principal poursuivi par la norme BCAE 7, à savoir la préservation du potentiel des sols. Le PSPAC français garantirait pleinement cet objectif tout en mettant en œuvre une rotation à plus long terme, en prévoyant une certaine flexibilité en cas de conditions climatiques défavorables et en tenant compte des différences régionales. À cet égard, au niveau de la parcelle, conformément à l’article 13 du même règlement, l’obligation fixée par la norme BCAE 7 serait satisfaite soit par la modification de la culture principale tous les deux ans, soit par une culture secondaire cultivée chaque année.
249
En l’espèce, il ressort de la sous-section 4.3 de l’annexe de la décision attaquée que, en réponse à la demande de réexamen interne, la Commission a considéré que, d’une part, la norme BCAE 7 ne constituait pas une intervention au sens de l’article 111 du règlement 2021/2115 et ainsi ne faisait pas partie du cadre de performance prévu dans ledit règlement bien qu’elle soit essentielle en tant qu’exigence minimale et fondement de certaines interventions. D’autre part, la norme BCAE 7, en tant qu’exigence de conditionnalité qui doit être respectée par tous les agriculteurs, ne serait pas pertinente pour apprécier la contribution du PSPAC français à l’indicateur de résultat R.24.
250
À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre d’un réexamen interne au titre de l’article 10, paragraphe 1, du règlement Aarhus, le demandeur peut faire valoir que l’acte visé par la demande de réexamen est contraire au droit de l’environnement.
251
À cet égard, la norme BCAE 7, compte tenu de son objectif de préservation du potentiel des sols, grâce à la rotation des cultures principales ou secondaires sur les terres arables, contribue à la poursuite des objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, en particulier la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement et l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Ainsi, cette norme relève de la notion de « droit de l’environnement », au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous f), du règlement Aarhus (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2023, BEI et Commission/ClientEarth, C‑212/21 P et C‑223/21 P , EU:C:2023:546 , points 83 à 87 ).
252
Il convient de souligner qu’il ressort du libellé même de l’article 13, paragraphe 1, du règlement 2021/2115 que la tâche de veiller à ce que toutes les surfaces agricoles soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales incombe aux États membres. À cette fin, ils fixent, au niveau national ou régional, des normes minimales pour chaque norme relative aux BCAE figurant à l’annexe III dudit règlement, conformément au principal objectif de ces normes visé dans ladite annexe. De plus, lorsqu’ils fixent leurs normes minimales, les États membres tiennent compte, le cas échéant, des caractéristiques spécifiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d’exploitation existants, des pratiques agricoles, de la taille et de la structure des exploitations agricoles, de l’utilisation des terres et des spécificités des régions ultrapériphériques.
253
Il en résulte que les États membres ont l’obligation d’établir des normes minimales pour chaque norme relative aux BCAE figurant à l’annexe III du règlement 2021/2115. Une telle approche est confirmée par le considérant 43 dudit règlement. Toutefois, si les États membres sont donc tenus, lors de la définition de ces exigences, de respecter ladite annexe, celle-ci leur laisse tout de même, par l’emploi de notions et de termes généraux, une certaine marge d’appréciation quant à la détermination concrète desdites normes (voir, par analogie, arrêt du 7 août 2018, Argo Kalda Mardi talu, C‑435/17 , EU:C:2018:637 , point 36 et jurisprudence citée).
254
Ainsi, l’étendue de la marge d’appréciation reconnue aux États membres dans le cadre de la définition des normes BCAE dépend notamment de leur libellé ou de leur degré de précision en droit de l’Union, c’est-à-dire, en l’occurrence, du contenu de l’annexe III du règlement 2021/2115.
255
L’annexe III du règlement 2021/2115 dispose que le principal objectif de la norme BCAE 7 est la préservation du potentiel des sols. À cet égard, une note en bas de page apporte des précisions quant à la signification de la notion de « rotation ». Selon elle, cette dernière consiste en un changement de culture au moins une fois par an au niveau des parcelles agricoles, y compris les cultures secondaires gérées de manière appropriée, sauf dans le cas des cultures pluriannuelles, de l’herbe et des autres plantes fourragères herbacées et des terres mises en jachère.
256
Il y a lieu de constater que, si la norme BCAE 7 est libellée en des termes généraux, la formulation de la note en bas de page, à laquelle l’annexe III du règlement 2021/2115 renvoie, énonce de manière précise les exigences minimales en matière de rotation des cultures ainsi que ses éventuelles adaptations et exemptions.
257
Il s’ensuit que la marge d’appréciation des États membres quant à la détermination de la norme BCAE 7 ne peut porter atteinte aux exigences minimales de rotation des cultures rappelées au point 255 ci-dessus.
258
En l’espèce, la norme BCAE 7, telle que mise en œuvre par le PSPAC français, prévoit que son respect s’évalue selon deux critères cumulatifs, le premier à l’échelle de l’exploitation et le second au niveau de la parcelle, ainsi que cela a été confirmé par la République française lors de l’audience.
259
Au niveau de l’exploitation, le PSPAC français fixe un critère annuel de rotation des cultures, à savoir que, sur au moins 35 % de la surface en cultures d’une exploitation, la culture principale doit être différente de celle de l’année précédente ou être suivie d’une culture secondaire.
260
Au niveau de la parcelle, le PSPAC français exige l’implantation soit de deux cultures principales différentes sur une période de quatre ans, soit d’une culture secondaire tous les ans sur cette même période, excepté pour les surfaces en « maïs semences ». Il est également prévu une dérogation fondée sur la diversification des cultures spécifiques pour les exploitations situées dans la zone de la plaine du Rhin et plusieurs exemptions.
261
À cet égard, il y a lieu de relever que le premier critère, rappelé au point 259 ci-dessus, utilise une terminologie différente de celle de l’annexe III du règlement 2021/2115 sans justification particulière.
262
De plus, ce même critère introduit un paramètre complémentaire, non prévu par l’annexe III du règlement 2021/2115. Celui-ci limite à 35 % la part des terres arables concernées par l’obligation de rotation telle que définie par ladite annexe. Le PSPAC français n’apporte aucune explication sur l’inclusion de ce paramètre en deçà des exigences minimales au sein des critères de la norme BCAE 7. En effet, cette limitation restreint la portée de l’exigence de rotation et donc celle du principal objectif de ladite norme, visé dans la même annexe, à savoir la préservation du potentiel des sols.
263
Le second critère, rappelé au point 260 ci-dessus, instaure la possibilité de choisir entre une rotation pluriannuelle de la culture principale ou une rotation annuelle de la culture secondaire. En effet, ce critère requiert la présence soit de deux cultures principales sur une période de quatre ans soit d’une culture secondaire chaque année. Toutefois, une telle alternative n’apparaît pas conforme à l’annexe III du règlement 2021/2115 qui énonce que la rotation consiste en un changement de culture au moins une fois par an au niveau des parcelles, y compris des cultures secondaires gérées de manière appropriée.
264
Il en découle que la combinaison de ces deux critères cumulatifs conduit à une rotation moins fréquente des cultures sur une quantité moindre de terres cultivées au regard des exigences minimales fixées par le règlement 2021/2115.
265
Or, d’une part, il ressort de la décision attaquée que les deux motifs opposés par la Commission et rappelés au point 249 ci-dessus étaient insusceptibles de fonder légalement cette décision, en ce qu’ils ne permettent pas d’établir que les conditions de mise en œuvre de la norme BCAE 7 par les autorités françaises, telles qu’approuvées par la décision d’approbation, étaient conformes à la définition réglementaire de cette norme. D’autre part, la Commission s’est limitée à considérer que la norme BCAE 7 telle que mise en œuvre par le PSPAC français participait à la réduction de l’utilisation des pesticides en raison des effets de la pratique de rotation des cultures qu’elle prévoyait, sans tenir compte du fait que lesdites exigences minimales n’étaient pas respectées.
266
Partant, les requérantes ont démontré, à suffisance de droit, que la Commission a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant comme non fondé le motif de réexamen interne tiré de ce que les conditions de mise en œuvre de la norme BCAE 7 prévues par le PSPAC français et entérinées par la décision d’approbation méconnaissaient les exigences minimales de l’article 13, paragraphe 1, du règlement 2021/2115 ainsi que de son annexe III.
[ omissis ]
e) Sur le cinquième grief, tiré de l’absence de contribution effective de la stratégie d’intervention du PSPAC français à l’objectif spécifique E
302
Les requérantes font valoir que la stratégie d’intervention du PSPAC français, notamment en ce qu’elle précise les conditions de mise en œuvre de la norme BCAE 7 et de l’éco-régime, n’est pas en mesure de permettre d’atteindre l’objectif spécifique E et de répondre au besoin prioritaire de réduction des pesticides dans le secteur agricole français.
303
S’agissant de la norme BCAE 7, les requérantes estiment que, même si une telle norme n’est pas qualifiée d’intervention au sens de l’article 111 du règlement 2021/2115, elle constitue un levier invoqué par le PSPAC français afin de justifier son niveau d’ambition en matière de réduction de la dépendance aux pesticides.
304
En ce qui concerne l’éco-régime, d’une part, les requérantes soutiennent que la voie des pratiques de diversification des cultures n’est pas de nature à induire un effet cumulatif pour l’ensemble des exploitations agricoles, mais uniquement pour celles déjà diversifiées. La Commission aurait, dans ses observations, alerté la République française sur l’ambition insuffisante de cette voie. D’autre part, la voie de la certification serait incapable de répondre au besoin prioritaire de réduction de l’utilisation des pesticides et compromettrait également la réalisation des valeurs cibles à cet effet en détournant les agriculteurs de la voie des pratiques. Par ailleurs, les requérantes considèrent que les exploitations agricoles n’ont pas d’intérêt financier à respecter l’ensemble des engagements de plusieurs voies d’accès à l’éco-régime.
305
La Commission, soutenue par la République française, conteste les arguments des requérantes.
306
Ainsi que cela est rappelé au point 246 ci-dessus, dans le cadre de son contrôle de compatibilité, la Commission doit apprécier, selon une approche globale, la contribution effective de la stratégie d’intervention de chaque proposition de PSPAC à la réalisation de l’ensemble des objectifs spécifiques du règlement 2021/2115.
307
Premièrement, à la lumière des points 252 à 266 ci-dessus, il convient d’examiner les conséquences de l’existence de doutes plausibles quant au respect par la norme BCAE 7 mise en œuvre par le PSPAC français des exigences minimales du règlement 2021/2115 sur l’appréciation de la contribution effective de sa stratégie d’intervention à l’objectif spécifique E, dans le cadre du contrôle de compatibilité de la Commission, au titre de l’article 118, paragraphe 4, du règlement 2021/2115.
308
À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 12, paragraphe 1, du règlement 2021/2115, la norme BCAE 7 constitue une exigence de conditionnalité.
309
Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du règlement 2021/2115, la stratégie d’intervention de chaque PSPAC doit démontrer sa cohérence et la complémentarité des interventions liées aux différents objectifs spécifiques. Pour ce faire, chaque PSPAC doit présenter une vue d’ensemble de son architecture environnementale et climatique décrivant notamment, premièrement, pour chaque norme BCAE, la manière dont la norme est mise en œuvre ainsi que, si nécessaire, une description de la manière dont la pratique contribue à la réalisation du principal objectif de cette norme, deuxièmement, pour l’ensemble de la conditionnalité, sa contribution globale pour atteindre les objectifs spécifiques environnementaux et climatiques et, troisièmement, la complémentarité entre les conditions de base pertinentes, la conditionnalité et les différentes interventions tendant aux mêmes objectifs spécifiques environnementaux et climatiques.
310
De plus, selon l’annexe III du règlement 2021/2115, la norme BCAE 7 a pour principal objectif la préservation du potentiel des sols qui est visé par l’objectif spécifique E.
311
En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la Commission a examiné les exigences de conditionnalité, dont la norme BCAE 7, en lien avec l’objectif spécifique E, suivant la présentation faite par le PSPAC français en ce qui concerne son architecture environnementale et climatique. En effet, selon le PSPAC français, la conditionnalité permet d’atteindre l’objectif spécifique E grâce aux normes BCAE 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8.
312
Dès lors, les éventuels problèmes de compatibilité affectant la norme BCAE 7 du PSPAC français sont susceptibles d’avoir des répercussions sur l’architecture environnementale et climatique dudit plan et donc sur l’appréciation globale de la contribution effective de la stratégie d’intervention du PSPAC français à l’atteinte de l’objectif spécifique E.
313
Néanmoins, dans la mesure où le contrôle de compatibilité de la Commission repose sur une approche globale de la contribution effective de chaque PSPAC à la réalisation des objectifs spécifiques, il revient aux requérantes d’établir l’influence du non-respect, par une norme de conditionnalité du PSPAC français, des exigences minimales fixées par le règlement 2021/2115, en l’espèce la norme BCAE 7 et l’article 13 dudit règlement, sur le caractère plausible de l’appréciation de la Commission quant à la contribution effective de la stratégie d’intervention dudit PSPAC s’agissant de l’objectif spécifique E.
314
Or, les requérantes se limitent à affirmer que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en approuvant le PSPAC français alors que la norme BCAE 7 qu’il contient ne respecte pas les exigences minimales du règlement 2021/2115.
315
Toutefois, dans la décision attaquée, la Commission a considéré que l’architecture environnementale et climatique du PSPAC français démontrait la contribution effective de la stratégie d’intervention pour atteindre l’objectif spécifique E grâce, notamment, à la contribution globale de l’ensemble des interventions liées à cet objectif et de la conditionnalité ainsi qu’à la complémentarité de ces interventions, des conditions de base pertinentes et de ladite conditionnalité en lien avec ledit objectif.
316
Il s’ensuit que l’appréciation de la contribution effective du PSPAC français à l’objectif spécifique E peut être admise comme étant toujours vraie ou valable.
317
Deuxièmement, les requérantes n’apportent aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause la plausibilité des explications de la Commission dans la sous-section 4.3 de l’annexe de la décision attaquée en ce qui concerne l’effet cumulatif des engagements de l’éco-régime par la voie des pratiques de diversification des cultures et l’absence d’un tel effet entre les différentes voies de l’éco-régime à l’exception du « bonus haies » de l’éco-régime qui est cumulable avec les autres voies dudit éco-régime rappelées au point 285 ci-dessus.
318
Troisièmement, les requérantes n’étayent pas leur argument selon lequel l’ambition des mesures concourant à la diversification des cultures est insuffisante. En effet, il ressort du point 38 des observations de la Commission au titre de l’article 118, paragraphe 3, du règlement 2021/2115, cité par les requérantes au soutien de leur argument, que celle-ci s’est limitée à encourager la République française à renforcer l’ambition des mesures concourant à la diversification des cultures pour mieux favoriser la mise en place de la rotation des cultures sur l’ensemble du territoire.
319
Quatrièmement, en ce qui concerne la capacité de l’éco-régime par la voie de la certification tant à répondre au besoin prioritaire de réduction de l’utilisation des pesticides qu’à détourner les agriculteurs de la voie des pratiques, les requérantes ne démontrent pas à suffisance de droit, conformément à la jurisprudence citée aux points 18 et 19 ci-dessus, que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, les requérantes n’apportent aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause la plausibilité des explications de la Commission dans la sous-section 4.3 de l’annexe de la décision attaquée selon lesquelles non seulement cette voie participe à la satisfaction dudit besoin mais également qu’il convient de prendre en compte les objectifs de chaque voie d’accès à l’éco-régime afin d’en apprécier le rôle global dans le cadre de l’architecture environnementale et climatique du PSPAC français.
320
Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le troisième grief de la première branche du troisième moyen et d’écarter les autres griefs.
2. Sur la seconde branche du troisième moyen, tirée de l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la contribution du PSPAC français à la réalisation des valeurs cibles nationales à long terme en matière de protection des ressources en eau
[ omissis ]
337
Eu égard aux considérations qui précèdent, le troisième moyen doit être écarté, sous réserve de l’erreur manifeste d’appréciation constatée au point 266 ci-dessus.
F. Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation quant à la contribution du PSPAC français à la réalisation de l’objectif spécifique F
[ omissis ]
3. Sur la troisième branche, tirée de l’absence de contribution effective de la stratégie d’intervention du PSPAC français aux besoins F.2, F.3 et F.4
[ omissis ]
e) Sur l’insuffisance des aides à l’agriculture biologique pour répondre aux besoins F.2, F.3 et F.4
[ omissis ]
379
Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a rejeté comme non fondé le motif de réexamen interne tiré de ce que les conditions de mise en œuvre de la norme BCAE 7 prévues par le PSPAC français et entérinées par la décision d’approbation méconnaissaient les exigences minimales de l’article 13, paragraphe 1, du règlement 2021/2115, ainsi que de son annexe III.
380
Il y a lieu de déterminer si l’illégalité constatée est susceptible d’entraîner l’annulation totale ou uniquement partielle de la décision attaquée.
381
À cet égard, selon une jurisprudence constante, l’annulation partielle d’un acte de l’Union n’est possible que pour autant que les éléments dont l’annulation est demandée sont séparables du reste de l’acte. Il n’est pas satisfait à cette exigence de séparabilité lorsque l’annulation partielle d’un acte aurait pour effet de modifier la substance de celui-ci [voir arrêt du 10 mai 2023, Ryanair/Commission (SAS II ; COVID-19), T‑238/21 , non publié, EU:T:2023:247 , point 84 et jurisprudence citée].
382
De plus, il y a lieu de rappeler que la demande de réexamen interne d’un acte administratif tend à faire constater une prétendue illégalité ou l’absence de bien-fondé de l’acte visé (arrêt du 12 septembre 2019, TestBioTech e.a./Commission, C‑82/17 P , EU:C:2019:719 , point 38 ).
383
En l’espèce, il y a lieu de constater que la décision attaquée est structurée en quatre sections afin de répondre à la demande de réexamen interne. La section 1 porte sur la procédure d’approbation du PSPAC, la section 2 est relative à l’« Évaluation de la recevabilité de la demande de réexamen interne », la section 3 porte sur le « Cadre juridique et normatif de la PAC pour l’examen de la décision d’exécution de la Commission adoptée en vertu de l’article 118, paragraphe 4, du règlement 2021/2115 » et, la section 4, porte sur l’« Évaluation des motifs justifiant le réexamen interne de la décision d’exécution de la Commission approuvant le plan stratégique de la France pour la PAC ».
384
Ainsi, bien que la décision attaquée réponde aux motifs de réexamen invoqués selon une structure en quatre sections reprenant l’organisation de la demande de réexamen, celle-ci n’en est pas pour autant divisible. En effet, ainsi qu’il ressort notamment des points 103 et 138 ci-dessus, conformément à la logique du contrôle confié à la Commission par les dispositions du règlement 2021/2115 dans le cadre de la procédure d’approbation d’un PSPAC, celle-ci n’a pas effectué une analyse de chaque motif de manière autonome, mais bien un examen d’ensemble du PSPAC français par rapport auxdits motifs de réexamen. Il en découle une interdépendance entre les quatre sections de la décision attaquée. De ce fait, il n’est pas possible de séparer la section de la décision attaquée entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses autres sections en raison de la logique du contrôle de la Commission ni même d’en tirer des conséquences sur l’issue de la demande de réexamen interne. Par ailleurs, le dispositif de la décision attaquée n’apparaît pas non plus divisible dans la mesure où la Commission conclut au caractère non fondé de la demande de réexamen interne au vu de l’évaluation de l’ensemble des motifs de réexamen présentés.
385
Par conséquent, le recours doit être accueilli et la décision attaquée annulée dans son intégralité.
[ omissis ]
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre élargie)
déclare et arrête :
1)
La décision de la Commission européenne, du 5 mai 2023, rejetant la demande de ClientEarth et de Collectif Nourrir tendant au réexamen interne de la décision d’exécution C(2022) 6012 final de la Commission, du 31 août 2022, portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d’un soutien de l’Union financé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural, est annulée.
2)
La Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux de ClientEarth et de Collectif Nourrir.
3)
La République française supportera ses propres dépens.
Truchot
Kanninen
Sampol Pucurull
Perišin
Meyer
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 octobre 2025.
Signatures
( *1 ) Langue de procédure : le français.
( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.
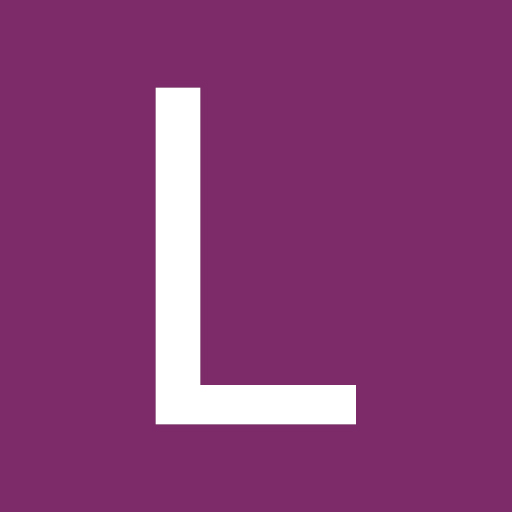
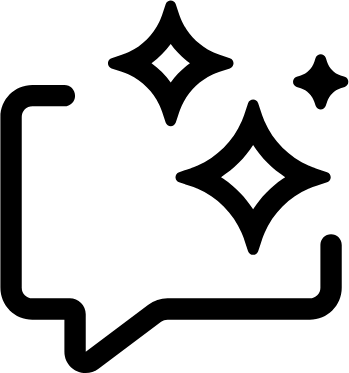 LEXI - AI Legal Assistant
LEXI - AI Legal Assistant