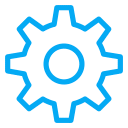Arrêt Du Tribunal (Quatrième Chambre) Du 29 Octobre 2025.
FU contre Parlement européen.
• 62024TJ0530 • ECLI:EU:T:2025:993
- Inbound citations: 0
- •
- Cited paragraphs: 0
- •
- Outbound citations: 0
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
29 octobre 2025 ( *1 )
« Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Article 73 du statut – Accident – Rejet de la déclaration d’accident – Déclaration tardive – Dépassement du délai de dix jours ouvrables à partir de la survenance de l’accident – Notion de “motif légitime” »
Dans l’affaire T‑530/24,
FU, représentée par M e S. Orlandi, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M mes M. Mão Cheia Carreira et D. Boytha, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et M. Alver, en qualité d’agents,
et par
Commission européenne, représentée par M. J.-F. Brakeland et M me O. Dani, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé, lors des délibérations, de M. R. da Silva Passos, président, M mes N. Półtorak et T. Pynnä (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1
Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, FU, demande l’annulation de la décision du 30 novembre 2023 du Parlement européen, par laquelle celui-ci a rejeté, pour cause de tardiveté, sa déclaration d’accident du 27 novembre 2023 (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2
Le 20 août 2023, lors d’un voyage en Grèce, la requérante, fonctionnaire du Parlement, a ressenti une douleur au genou droit à la réception d’un saut.
3
Le 21 août 2023, la requérante s’est rendue chez un médecin en Grèce, lequel lui a notamment conseillé d’attendre, avant de réaliser un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM), que le genou désenfle.
4
Le 12 septembre 2023, ayant toujours des douleurs au genou à son retour de voyage, la requérante a consulté son médecin traitant qui lui a demandé de procéder à des examens médicaux, effectués par un autre médecin.
5
Le 12 octobre 2023, la requérante a réalisé une IRM.
6
Le 19 octobre 2023, sur la base des résultats de l’IRM, un médecin spécialiste en orthopédie a recommandé à la requérante de consulter un chirurgien pour obtenir un second avis et d’envisager, le cas échéant, une intervention chirurgicale.
7
Le 24 octobre 2023, un chirurgien a confirmé la nécessité d’une intervention chirurgicale.
8
Le 15 novembre 2023, un autre médecin spécialiste a également conseillé une intervention chirurgicale.
9
Le 27 novembre 2023, la requérante a déclaré son accident auprès du Parlement (ci-après la « déclaration d’accident »). Dans la déclaration d’accident, le médecin traitant de la requérante a précisé que, le jour de l’examen, il n’était pas possible d’estimer la gravité de la blessure.
10
Le 30 novembre 2023, par la décision attaquée, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a informé la requérante du rejet de sa déclaration d’accident, jugée tardive.
11
Le 27 février 2024, la requérante a introduit une réclamation contre la décision attaquée, qui a été rejetée par décision du Parlement du 12 juillet 2024, notifiée à la requérante le même jour.
Conclusions des parties
12
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–
annuler la décision attaquée ;
–
condamner le Parlement aux dépens.
13
Le Parlement, soutenu par le Conseil de l’Union européenne, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–
rejeter le recours ;
–
condamner la requérante aux dépens.
14
La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
En droit
15
Au soutien de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, premièrement, d’une violation de l’obligation de motivation ainsi que de l’article 15, paragraphe 2, de la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après la « réglementation de couverture ») et d’une erreur manifeste d’appréciation, deuxièmement, d’une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité et, troisièmement, à titre subsidiaire, d’une exception d’illégalité de l’article 15, paragraphe 2, de la réglementation de couverture.
Sur la recevabilité du recours
16
Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, le Parlement avance deux motifs pour contester la recevabilité du recours.
Sur le premier motif d’irrecevabilité, tiré du manque de clarté de la requête
17
Le Parlement fait valoir que la requérante n’aurait ni structuré sa requête autour de moyens clairement identifiés, ni suivi l’ordre indiqué au début de sa requête, ni regroupé ses arguments sous un titre correspondant à l’intitulé de ces moyens. En outre, la requérante aurait également tiré des conclusions sur la base de motifs qui n’ont pas été développés à suffisance de droit, tels que la violation des articles 4 et 7 de la réglementation de couverture, la violation du devoir de sollicitude et du droit à une bonne administration, ainsi que la méconnaissance de l’obligation de motivation.
18
La requérante conteste cette argumentation.
19
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal prévoit que la requête doit contenir les « moyens et [les] arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens ». Ainsi, selon une jurisprudence constante, il n’incombe pas au juge de l’Union européenne de répondre aux arguments invoqués par une partie qui ne sont pas suffisamment clairs et précis, dans la mesure où ils ne font l’objet d’aucun autre développement et ne sont pas accompagnés d’une argumentation spécifique les étayant (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2024, FFPE section Conseil/Conseil, T‑179/23 , EU:T:2024:897 , point 128 et jurisprudence citée).
20
En l’espèce, bien que la requérante indique soulever les trois moyens mentionnés au point 15 ci-dessus, il est exact que la requête ne repose pas sur l’invocation successive de ces moyens et que ceux-ci ne sont pas présentés sous des intitulés distincts. Toutefois, la présentation des arguments dans le corps de la requête permet d’identifier, de manière suffisamment compréhensible, les trois moyens annoncés et les arguments avancés à leur soutien.
21
En outre, en ce qui concerne les arguments relatifs à la prétendue violation des articles 4 et 7 de la réglementation de couverture, la requérante fait valoir que les cas de déclaration tardive d’accident ne constituent pas un cas d’exclusion de la couverture ou des prestations prévu dans lesdits articles. À cet égard, il convient de constater que, si l’argumentation n’est pas étayée par des considérations propres, elle semble cependant se rattacher à la prétendue interprétation erronée de l’article 15, paragraphe 2, de la réglementation de couverture invoquée dans le cadre du premier moyen portant sur une violation dudit article et une erreur manifeste d’appréciation.
22
Il en va de même de la prétendue violation du principe de sollicitude et de celle du droit à une bonne administration. À cet égard, la requérante fait valoir qu’une interprétation restrictive de l’article 15, paragraphe 2, de la réglementation de couverture serait contraire au droit à une bonne administration, qui aurait imposé à l’administration de traiter équitablement les affaires de toute personne, ainsi qu’au devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents, qui l’aurait contrainte à un examen approfondi de toutes les circonstances du cas d’espèce.
23
Enfin, en ce qui concerne la violation de l’obligation de motivation, la requérante fait valoir que l’AIPN a méconnu son obligation de motivation en ne précisant pas la notion de « motif légitime » ni les critères applicables au cas d’espèce. À cet égard, l’argumentation est étroitement liée à celle portant sur la notion de « motif légitime » prévue à l’article 15, paragraphe 2, de la réglementation de couverture développée dans le cadre du premier moyen, de sorte qu’il doit être considéré qu’elle s’y rattache.
24
Par conséquent, le premier motif d’irrecevabilité doit être écarté.
Sur le second motif d’irrecevabilité, tiré du non-respect de la règle de concordance
25
Le Parlement fait valoir que la requérante ne s’est pas conformée à la règle de concordance entre la réclamation et la requête. Dans sa réclamation, la requérante n’aurait soulevé aucun argument concernant la prétendue violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, la prétendue violation des articles 4 et 7 de la réglementation de couverture et la prétendue violation de l’obligation de motivation ainsi que l’exception d’illégalité de l’article 15, paragraphe 2, de la réglementation de couverture.
26
La requérante conteste cette argumentation.
27
À cet égard, il convient de rappeler que la règle de concordance entre la réclamation et la requête exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’administration ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée. Ainsi, dans les recours en matière de fonction publique, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement. En outre, il importe de souligner, d’une part, que, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent en général à ce stade sans le concours d’un avocat, l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture et, d’autre part, que l’article 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») n’a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2024, WS/EUIPO, T‑221/23, non publié, EU:T:2024:820 , points 47 à 49 et jurisprudence citée).
28
Ainsi qu’il a été précisé aux points 21 à 23 ci-dessus, les arguments relatifs à la violation des articles 4 et 7 de la réglementation de couverture, au devoir de sollicitude et au droit à une bonne administration ainsi qu’à la prétendue méconnaissance de l’obligation de motivation sont avancés par la requérante au soutien du premier moyen. Ce moyen repose sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation. En ce qui concerne la prétendue violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, la contestation se rattache à la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation. Partant, il n’y a pas lieu de considérer que ces arguments constituent des nouveaux moyens au regard de la réclamation.
29
S’agissant de l’exception d’illégalité invoquée dans le cadre du troisième moyen, il ressort de la jurisprudence que, en principe, l’économie de la voie de droit incidente que constitue l’exception d’illégalité justifie que soit déclarée recevable une telle exception soulevée pour la première fois devant le juge de l’Union, en dérogation à la règle de concordance entre la requête et la réclamation (arrêt du 16 décembre 2020, RN/Commission, T‑442/17 RENV , EU:T:2020:618 , point 60 ).
30
Partant, le fait que l’exception d’illégalité de l’article 15, paragraphe 2, de la réglementation de couverture ait été soulevée pour la première fois au stade de la requête n’emporte pas l’irrecevabilité de cette exception.
31
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le motif d’irrecevabilité tiré du non-respect de la règle de concordance.
Sur le fond
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation ainsi que de l’article 15, paragraphe 2 de la réglementation de couverture et d’une erreur manifeste d’appréciation
32
D’une part, la requérante fait valoir que le point de départ du délai dans lequel la déclaration d’accident doit être faite devrait être fixé par rapport au moment où l’assuré prend conscience qu’il a été victime d’un accident. Or, elle aurait pris conscience graduellement de l’importance de sa blessure en raison du caractère mineur de l’accident et de l’apparition tardive des symptômes. Le retard de sa déclaration d’accident aurait donc été involontaire. Le délai pour procéder à la déclaration d’accident aurait été raisonnable au regard de l’absence de connaissance de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’au 15 novembre 2023.
33
D’autre part, la requérante soutient que le retard dans la déclaration d’accident est également justifié par le fait qu’il lui était impossible de consulter un médecin apte à procéder aux constatations requises. Or, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la réglementation de couverture et aux termes mêmes du formulaire de déclaration d’accident, la déclaration d’accident doit être assortie d’un rapport médical, spécifiant la nature des lésions et les suites probables de l’accident.
34
Le Parlement, soutenu par le Conseil et la Commission, conteste cette argumentation.
35
La réglementation de couverture a été adoptée par les institutions de l’Union sur le fondement de l’article 73, paragraphe 1, du statut.
36
L’article 2, paragraphe 1, de la réglementation de couverture définit la notion d’« accident » comme désignant « tout évènement soudain ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique de l’assuré et dont la cause ou l’une des causes est extérieure à l’organisme de la victime ».
37
En outre, l’article 15, paragraphe 1, de la réglementation de couverture, intitulé « Déclaration d’accident », prévoit que « [l’]assuré victime d’un accident ou ses ayants droit doivent déclarer l’accident à l’administration de l’institution dont relève l’assuré ». Le paragraphe 2 du même article dispose ce qui suit :
« La déclaration doit être faite dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle l’accident s’est produit. Toutefois, ce délai peut être dépassé en cas de force majeure ou pour tout autre motif légitime, pour autant que l’assuré apporte la preuve de l’accident et établisse le lien de causalité entre cet accident et les atteintes à son intégrité physique et psychique. »
38
Il ressort de l’article 15, paragraphe 2, de la réglementation de couverture que c’est la date à laquelle l’accident s’est produit qui fait courir le délai de dix jours ouvrables dans lequel la déclaration doit être faite, et non pas la date à laquelle l’assuré prend conscience de son accident. En outre, l’article 15, paragraphe 2, de la réglementation de couverture prévoit que l’assuré peut dépasser le délai de dix jours pour effectuer sa déclaration en cas de force majeure ou pour tout autre motif légitime, pour autant que l’assuré apporte la preuve de l’accident et établisse le lien de causalité entre cet accident et les atteintes à son intégrité physique et psychique.
39
La notion de « motif légitime » pour une déclaration tardive d’accident n’est pas définie par la réglementation de couverture ou par la jurisprudence. Cette notion devrait s’appliquer de manière stricte pour deux raisons : d’une part, parce qu’elle constitue une exception à une obligation bien établie de présenter sa déclaration d’accident dans un délai de dix jours ouvrables et, d’autre part, parce qu’il s’agit d’une notion relative à des dispositions du droit de l’Union qui ouvrent droit à des prestations financières (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2023, OP/Parlement, T‑143/22 , EU:T:2023:313 , point 99 et jurisprudence citée). Selon la jurisprudence concernant une demande de transfert des droits à pension acquis, afin de justifier un non-respect du délai dans une situation qui ne saurait être considérée comme étant un cas de force majeure, le fonctionnaire doit démontrer avoir été confronté à une situation exceptionnelle résultant de causes qui ne lui sont pas imputables. Les conditions requises pour justifier une telle situation sont moins exigeantes que celles requises pour justifier d’un cas de force majeure et il incombe à la personne en cause de prouver l’existence ou la survenance d’évènements externes l’empêchant de respecter une obligation, tandis que, pour justifier de l’existence d’un cas de force majeure, cette personne doit démontrer non seulement la survenance d’évènements anormaux et étrangers à sa volonté, mais aussi qu’elle a adopté un comportement diligent pour se prémunir contre les conséquences de ces évènements (voir, en ce sens, arrêt du 9 octobre 2024, CF/Commission, T‑51/24 , non publié, EU:T:2024:686 , point 77 ).
40
À cet égard, il convient d’interpréter la notion de « motif légitime » en ce sens que l’assuré doit démontrer avoir été confronté à une situation exceptionnelle résultant de causes qui ne lui sont pas imputables et qui relèvent de son incapacité à présenter une déclaration d’accident dans les dix jours ouvrables suivant l’accident.
41
En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante tiré d’un défaut de motivation, la requérante soutient que la décision attaquée ne précise pas la notion de « motif légitime » et les critères applicables. Toutefois, il ressort de cette décision que la déclaration d’accident a été rejetée pour tardiveté et que le délai pour déclarer un accident fait référence au jour de l’accident, et non au jour où l’assuré a ressenti une aggravation de son état de santé ni au jour où un diagnostic complet a été obtenu. Il y est également constaté que la requérante a pris conscience de l’accident le jour même et qu’elle n’a fourni aucune preuve d’un cas de force majeure ni d’aucun motif légitime l’empêchant de soumettre la déclaration d’accident dans le délai prévu. Partant, la décision attaquée comprend une explication claire et non équivoque des raisons pour lesquelles les motifs soulevés par la requérante ne constituent pas un motif légitime pour justifier le retard dans la présentation de la déclaration d’accident, ce qui lui a permis de connaître les justifications de cette décision et au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de celle-ci. Il s’ensuit que le Parlement n’a pas méconnu l’obligation de motivation consacrée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2017, Icap e.a./Commission, T‑180/15 , EU:T:2017:795 , point 287 et jurisprudence citée).
42
En second lieu, eu égard au point 40 ci-dessus, la requérante considère à tort que la simple administration de la preuve de l’accident suffirait à justifier le retard de la déclaration d’accident. Il s’ensuit également que, en l’absence de justification par un cas de force majeure ou un autre motif légitime, la tardiveté d’une déclaration d’accident entraîne le refus de la couverture de l’accident. Néanmoins, ainsi que le précisent le Parlement, le Conseil et la Commission, même si l’assuré ne peut pas bénéficier de la couverture complémentaire de l’assurance accident à défaut de preuve d’un cas de force majeur ou de tout autre motif légitime, ce dernier reste éligible au remboursement de ses frais médicaux par le régime commun d’assurance maladie.
43
En l’espèce, quant à savoir si le retard de la déclaration d’accident pouvait être justifié par des motifs légitimes, il convient de relever que la requérante a, dans sa déclaration d’accident, décrit les symptômes, à savoir le genou enflé et une difficulté à marcher, qu’elle a pu constater dès le lendemain de l’accident. Elle a expliqué que le médecin qu’elle a consulté au centre médical ce jour-là lui a conseillé de faire une IRM à son retour de voyage. Elle affirme que les douleurs ont persisté à son retour. Dans ces circonstances, elle ne pouvait ignorer avant l’expiration du délai de dix jours ouvrables suivant la date de l’accident qu’elle avait subi un accident au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la réglementation de couverture. Elle ne saurait donc soutenir avoir pris conscience tardivement de la gravité de ses blessures afin de démontrer que le retard de sa déclaration d’accident était justifié par un motif légitime.
44
Par ailleurs, certes, il ressort du formulaire de déclaration d’accident que cette dernière doit être accompagnée d’un avis médical émis par un médecin. Cependant, il n’est nullement exigé qu’un diagnostic complet soit posé pour pouvoir déclarer un accident. En effet, l’article 15, paragraphe 1, de la réglementation de couverture ne prévoit qu’un certificat médical « spécifiant la nature des lésions et les suites probables de l’accident ». Or, il ressort de la déclaration d’accident que la requérante s’est rendue, dans le délai de dix jours prescrit à l’article 15, paragraphe 1, de la réglementation de couverture, dans un centre médical et elle ne démontre pas que le médecin qu’elle a consulté aurait refusé de lui fournir un certificat médical.
45
Eu égard aux considérations qui précèdent, la requérante n’a pas prouvé l’existence d’un cas de force majeure ou d’un motif légitime qui l’auraient empêchée de respecter le délai de dix jours ouvrables prescrit à l’article 15, paragraphe 2, de la réglementation de couverture. En considérant qu’elle n’a pas présenté un motif légitime justifiant le retard avec lequel elle a introduit sa déclaration d’accident, le Parlement n’a ni commis une erreur d’appréciation ni fait une application inexacte de l’article 15 de la réglementation de couverture. À cet égard, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur.
46
Un tel constat n’est pas susceptible d’être remis en cause par les arguments supplémentaires invoqués par la requérante.
47
La requérante argue que les cas de déclaration tardive d’accident ne constituent pas un cas d’exclusion de la couverture ou des prestations prévu aux articles 4 et 7 de la réglementation de couverture. À cet égard, il convient de remarquer que les articles 4 et 7 de la réglementation de couverture fixent des conditions substantielles pour l’acceptation d’un accident qui sont indépendantes du délai prévu à l’article 15, paragraphe 2, de la réglementation de couverture.
48
En outre, selon la requérante, l’interprétation de l’article 15, paragraphe 2, de la réglementation de couverture figurant dans la décision attaquée est contraire au droit à une bonne administration, qui impose à l’administration de traiter équitablement les affaires de toute personne, ainsi qu’au devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents, qui la contraint à un examen approfondi de toutes les circonstances du cas d’espèce. Ainsi qu’il ressort du point 41 ci-dessus, l’AIPN a procédé à un examen approfondi des circonstances du cas d’espèce et, sans autre explication apportée par la requérante, il n’a pas été établi que l’interprétation de l’article 15, paragraphe 2, de la réglementation de couverture était contraire au principe de bonne administration et au devoir de sollicitude.
49
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité
50
Par son deuxième moyen, la requérante soutient qu’auraient été violés les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité.
51
Le Parlement, soutenu par le Conseil, estime que le deuxième moyen est irrecevable.
52
À cet égard, au soutien du présent moyen, la requérante se limite à alléguer, d’une part, que le Parlement a appliqué de manière arbitraire le critère du « motif légitime » prévu à l’article 15, paragraphe 2, de la réglementation de couverture et, d’autre part, que le rejet de sa déclaration d’accident méconnaît le principe de proportionnalité, dès lors que le dépassement du délai ne résulte pas d’une négligence, sans autre explication.
53
Partant, dans la mesure où la requérante ne développe pas son argumentation, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant irrecevable en application de la jurisprudence rappelée au point 19 ci-dessus.
Sur le troisième moyen, tiré d’une exception d’illégalité de l’article 15 de la réglementation de couverture
54
À titre subsidiaire, la requérante soulève une exception d’illégalité de l’article 15, paragraphe 2, de la réglementation de couverture. Si cet article devait être interprété comme imposant strictement un délai de dix jours ouvrables pour la déclaration d’accident, cette disposition devrait être déclarée illégale au regard de l’atteinte injustifiable et disproportionnée portée au droit statutaire à une couverture contre le risque d’accident, visé à l’article 73 du statut. La formulation de cette disposition s’opposerait à une interprétation restrictive s’agissant des motifs susceptibles d’être pris en compte pour examiner le caractère justifié du dépassement du délai de déclaration. La clause, interprétée comme le fait l’AIPN, s’apparenterait à une clause abusive entraînant un déséquilibre entre les droits respectifs des assurés et de l’assureur et méconnaîtrait le droit à la sécurité sociale inscrit à l’article 73 du statut.
55
Le Parlement, soutenu par le Conseil et la Commission, conteste cette argumentation.
56
L’exception d’illégalité invoquée par la requérante vise l’inapplicabilité de l’article 15, paragraphe 2, de la réglementation de couverture en raison de l’absence de conformité dudit article avec l’article 73 du statut, et ce en ce qu’il prévoit que la déclaration d’accident doit être présentée dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date à laquelle l’accident s’est produit.
57
À cet égard, tout d’abord, il ressort clairement de l’article 73, paragraphe 1, du statut que le fonctionnaire est couvert contre les risques d’accident « [d]ans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des autorités investies du pouvoir de nomination des institutions ». Cet article a servi de base juridique à l’adoption de la réglementation de couverture et la fixation des conditions de remboursement des frais encourus relève donc de la compétence octroyée par l’article 73 du statut aux institutions.
58
Ensuite, le délai prévu à l’article 15, paragraphe 2, de la réglementation de couverture connaît des exceptions, à savoir les cas de force majeure et l’existence de motifs légitimes.
59
En outre, ainsi que le soutiennent le Parlement, la Commission et le Conseil, l’établissement d’une condition temporelle pour la présentation d’une déclaration d’accident constitue une mesure nécessaire afin de prévenir les abus de droit et les fraudes. En effet, une telle condition vise à permettre aux institutions de vérifier, avec suffisamment de certitude, la réalité de l’accident déclaré ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et les lésions.
60
Enfin, dans la mesure où les assurés peuvent annexer un certificat médical de premier constat à leur déclaration d’accident, laquelle peut être complétée par la suite, un délai de dix jours n’est pas déraisonnable.
61
Dès lors, le délai fixé à l’article 15, paragraphe 2, de la réglementation de couverture et dans lequel, sauf cas de force majeure ou motif légitime, il convient de déclarer un accident afin de bénéficier du remboursement des frais encourus ne saurait être contraire à l’article 73, paragraphe 1, du statut.
62
Par conséquent, il y a lieu d’écarter l’exception d’illégalité comme étant non fondée, de sorte que le recours se trouve être intégralement rejeté.
Sur les dépens
63
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement, conformément aux conclusions de ce dernier.
64
Selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Le Conseil et la Commission supporteront donc leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1)
Le recours est rejeté.
2)
FU supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen.
3)
Le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.
da Silva Passos
Półtorak
Pynnä
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 octobre 2025.
Signatures
( *1 ) Langue de procédure : le français.
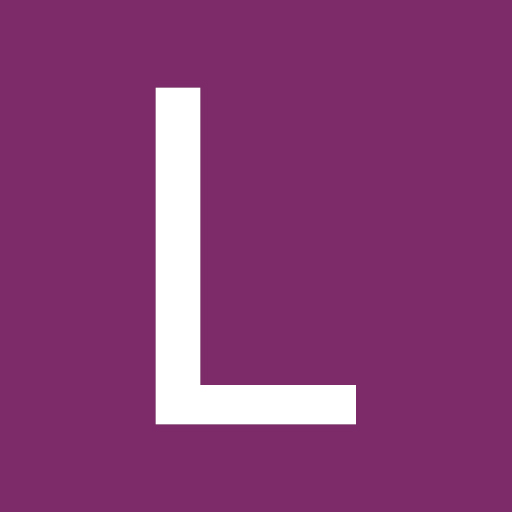
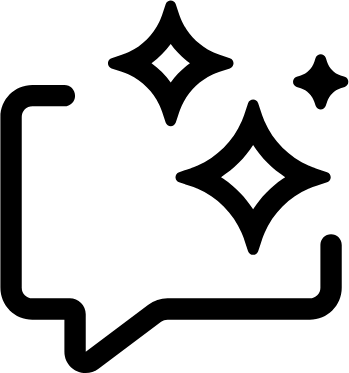 LEXI - AI Legal Assistant
LEXI - AI Legal Assistant