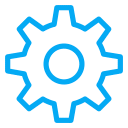Arrêt Du Tribunal (Dixième Chambre) Du 3 Septembre 2025.
DF contre Commission européenne.
• 62024TJ0153 • ECLI:EU:T:2025:829
- Inbound citations: 0
- •
- Cited paragraphs: 0
- •
- Outbound citations: 20
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
3 septembre 2025 ( * )
« Fonction publique – Agents contractuels – Recrutement – Refus d’engagement pour inaptitude physique à l’exercice des fonctions – Avis de la commission médicale – Étendue de la compétence de la commission médicale – Lien compréhensible entre les constatations médicales et la conclusion d’inaptitude – Devoir de sollicitude – Principe de bonne administration – Responsabilité – Préjudices matériel et moral »
Dans l’affaire T‑153/24,
DF, représentée par M es A. Guillerme et S. Napolitano, avocates,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J.-F. Brakeland et M me K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de M me O. Porchia, présidente, MM. L. Madise (rapporteur) et P. Nihoul, juges,
greffier : M me M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 8 avril 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, DF, demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 12 mai 2023 mettant fin au processus de son recrutement (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, la réparation des préjudices moral et matériel qu’elle aurait subis du fait de cette décision.
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
2 La requérante a travaillé en tant qu’avocate depuis 2006. Le 9 janvier 2021, un « burn-out » lui a été diagnostiqué et elle a été placée en congé de maladie. Durant ce congé, elle a fait l’objet d’un accompagnement par une équipe pluridisciplinaire composée de son médecin spécialiste en psychotraumatologie et expert médical (ci-après le « médecin spécialiste »), de son médecin traitant et de sa psychologue clinicienne.
3 En juin 2022, la requérante a entrepris des démarches pour reprendre sa vie professionnelle. Dans ce contexte, elle a déposé sa candidature pour un poste vacant au sein de la Commission.
4 La requérante a été contactée en août 2022 par le chef de l’unité « Copyright » de la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies de la Commission et, après avoir réussi une procédure de sélection, elle a participé à un entretien d’embauche le 10 octobre 2022 et a été contactée par courriel pour se voir proposer un poste à compter du mois de janvier 2023.
5 Le 14 novembre 2022, la requérante s’est soumise à un examen médical d’embauche réalisé par le médecin-conseil de la Commission (ci‑après le « médecin-conseil »). Dans le cadre de cet examen, la requérante a rempli un questionnaire et, à la question visant à savoir si, dans le passé, elle avait eu une « incapacité permanente, partielle de travail après accident ou maladie », elle a mentionné son burn-out. Le médecin-conseil a alors demandé qu’elle soit examinée par un psychiatre de l’institution.
6 Le 23 novembre 2022, la requérante a été reçue par le psychiatre médecin-conseil de la Commission (ci-après le « psychiatre de l’institution »).
7 Le psychiatre de l’institution a, par la suite, transmis au médecin‑conseil son avis selon lequel la requérante était inapte au travail.
8 Le 28 novembre 2022, la requérante a transmis au psychiatre de l’institution plusieurs documents émis par le médecin spécialiste, à savoir un certificat médical daté du 24 novembre 2022 attestant son aptitude à reprendre le travail à compter du 1 er octobre 2022 et un courrier adressé à sa mutuelle, dans lequel ce médecin spécialiste précisait avoir omis d’informer sa patiente qu’elle devait prévenir ladite mutuelle de la fin de son incapacité de travail. Le médecin spécialiste a transmis, en même temps, à la mutuelle de la requérante le certificat attestant son aptitude au travail depuis le 1 er octobre 2022. Enfin, la requérante a communiqué au psychiatre de l’institution un rapport établi par sa psychologue clinicienne indiquant notamment que le parcours pluridisciplinaire qu’elle avait suivi lui avait permis de résoudre sa symptomatologie.
9 Le 1 er décembre 2022, le psychiatre de l’institution a accusé réception des documents transmis par la requérante.
10 Le 6 décembre 2022, la requérante a reçu, par un courriel émanant du service médical de la Commission, l’information selon laquelle, à la suite de son examen médical d’embauche du 14 novembre 2022, un avis négatif avait été émis et, au titre de l’article 33 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), elle pouvait, dans un délai de vingt jours, demander que son cas soit soumis à une commission médicale composée de trois médecins choisis par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») parmi les médecins-conseils des institutions.
11 Le même jour, à savoir le 6 décembre 2022, la requérante a demandé à connaître la motivation de l’avis négatif mentionné au point 10 ci-dessus et a manifesté sa volonté de faire appel pour le contester.
12 Par un courriel du 7 décembre 2022, le service médical de la Commission a accusé réception de la demande de la requérante et a informé cette dernière, d’une part, que l’accès à son dossier médical était régi par l’article 26 bis du statut, par la conclusion n o 221/4 adoptée par le collège des chefs d’administration le 19 février 2004 ainsi que par la décision (UE) 2019/154 de la Commission, du 30 janvier 2019, établissant les règles internes concernant la limitation du droit d’accès des personnes concernées à leur dossier médical (JO 2019, L 27, p. 33), et, d’autre part, qu’il disposait d’un délai d’un mois pour répondre à sa demande d’accès et qu’un éventuel recours contre l’avis négatif devait être introduit dans un délai de vingt jours à compter de l’accès au dossier médical.
13 Le 8 décembre 2022, la requérante a reçu un courrier dans lequel sa mutuelle prenait acte de la fin de son invalidité le 30 septembre 2022 et lui demandait le remboursement des indemnités trop perçues pour les mois d’octobre et de novembre 2022.
14 Par courriel du 11 janvier 2023, la requérante a demandé à connaître les suites qui avaient été données à sa demande d’accès à son dossier médical. Le service médical de la Commission a répondu par un courriel du 13 janvier 2023 que le traitement de sa demande avait été retardé en raison de circonstances internes telles que la période de congés de fin d’année et que son dossier allait lui être envoyé au début de la semaine suivante.
15 Le 13 janvier 2023, le médecin-conseil a complété et signé son rapport contenant son avis négatif et, le 20 janvier 2023, ce rapport a été transmis à la requérante.
16 Le même jour, à savoir le 20 janvier 2023, la requérante a confirmé introduire un appel devant la commission médicale, conformément à l’article 33 du statut et à l’article 83 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »). Elle a également précisé qu’elle se faisait assister par un spécialiste en psychiatrie médicolégale, en médecine d’assurance et en expertise médicale (ci-après le « spécialiste médicolégal »).
17 Le 31 janvier 2023, le conseil de la requérante a adressé un courrier à la Commission dans lequel il demandait, premièrement, à savoir si l’appel de la requérante devant la commission médicale avait été enregistré, deuxièmement, à connaître le délai envisagé pour le traiter et, troisièmement, à obtenir une copie du rapport du psychiatre de l’institution, contenant l’avis de ce dernier, qui était mentionné dans le rapport du médecin-conseil du 13 janvier 2023.
18 Le 7 février 2023, un courriel de relance a été adressé à la Commission en raison de l’absence de réponse de cette dernière au courrier du 31 janvier 2023.
19 Le 8 février 2023, la Commission a, notamment, répondu que la motivation du service médical avait été communiquée à la requérante le 20 janvier 2023 et a confirmé que l’appel introduit par la requérante avait bien été enregistré.
20 Ce même jour, à savoir le 8 février 2023, le conseil de la requérante a adressé à la Commission un courriel réitérant la demande d’accès au rapport du psychiatre de l’institution mentionné dans le rapport du médecin-conseil du 13 janvier 2023.
21 Le 15 février 2023, la Commission a informé la requérante que le rapport du psychiatre de l’institution allait être transmis au spécialiste médicolégal qu’elle avait nommé.
22 Ce même jour, à savoir le 15 février 2023, n’ayant pas reçu le rapport du psychiatre de l’institution, le spécialiste médicolégal a contacté ledit psychiatre pour lui adresser son propre rapport, dans lequel il critiquait notamment l’absence d’une quelconque évaluation spécifique ou d’un test psychométrique de la requérante et soulignait l’impossibilité d’admettre les termes du refus opposé par le service médical à la candidature de la requérante.
23 Le 22 février 2023, le conseil de la requérante a, à nouveau, relancé la Commission en vue d’obtenir le rapport du psychiatre de l’institution.
24 Le 23 février 2023, la Commission a répondu qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour répondre à la demande de la requérante, conformément à la réglementation de l’Union européenne pertinente, et a indiqué que le rapport du psychiatre de l’institution avait été envoyé par courrier au spécialiste médicolégal que la requérante avait nommé.
25 Le 24 février 2023, le conseil de la requérante a adressé un courrier à la Commission, indiquant notamment que la demande d’accès au rapport du psychiatre de l’institution était incluse dans la demande d’accès au dossier médical de la requérante introduite le 6 décembre 2022 (voir point 11 ci-dessus) sur le fondement de l’article 26 bis du statut et devait, selon la réglementation pertinente de l’Union, être traitée sans délai et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de cette date.
26 Le 6 mars 2023, le spécialiste médicolégal a reçu le rapport du psychiatre de l’institution. Le 13 mars 2023, il a notamment conclu qu’il était impossible d’admettre les termes du refus opposé par le service médical à la candidature de la requérante, fondé sur le rapport dudit psychiatre.
27 Le 15 mars 2023, le conseil de la requérante a transmis, à l’attention de la commission médicale, des observations ainsi que les certificats et rapports médicaux des praticiens de la requérante.
28 Le même jour, soit le 15 mars 2023, le service médical a informé la requérante et ses praticiens que la commission médicale se réunirait le 20 mars 2023. Les praticiens de la requérante ont informé la commission médicale de leur indisponibilité à si brève échéance, tout en indiquant qu’ils restaient à sa disposition. La requérante, dans sa réponse transmise par courriel, a indiqué que, en cas de questions ou de réserves sur les rapports de ses praticiens, la commission médicale pouvait prendre contact avec ces derniers pour échanger avec eux à une date ultérieure.
29 Le 17 mars 2023, la Commission a adopté une décision en vue de constituer la commission médicale composée de trois médecins.
30 Le 20 mars 2023, la commission médicale s’est réunie afin d’examiner le recours de la requérante et a entendu cette dernière.
31 Après avoir été relancée à plusieurs reprises, le 20 avril 2023, la Commission a informé la requérante que, le 20 mars 2023, la commission médicale avait confirmé son inaptitude au travail. La requérante a donc demandé à se voir communiquer le rapport de ladite commission.
32 Le 24 avril 2023, la Commission a accusé réception de la demande de la requérante de connaître les motifs de l’avis de la commission médicale et a indiqué que, conformément aux règles internes en matière de données à caractère médical, le médecin-conseil examinerait ladite demande et y répondrait dans un délai d’un mois.
33 Le même jour, soit le 24 avril 2023, le conseil de la requérante a adressé un courriel à la Commission indiquant notamment que la demande de la requérante devait être traitée, conformément à la réglementation de l’Union pertinente, sans délai ou, au plus tard, dans un délai d’un mois qui expirait le 3 mai 2023, dès lors que la demande d’accès au rapport contenant l’avis de la commission médicale datait du 3 avril 2023.
34 Le 25 avril 2023, le conseil de la requérante a adressé un courrier à la Commission en vue de l’inviter à effectuer des vérifications complémentaires et d’attirer son attention sur certains points avant l’adoption d’une décision formelle.
35 Le 27 avril 2023, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») a informé la requérante de son intention de ne pas poursuivre la procédure de recrutement, puisque cette dernière ne remplissait pas les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice des fonctions envisagées prévues à l’article 82, paragraphe 3, sous d), du RAA.
36 Par courriel du 28 avril 2023, la requérante a adressé à l’AHCC ses observations en renvoyant, pour le surplus, au courrier du 25 avril 2023. En outre, la requérante a confirmé son accord pour que cette autorité accède aux avis du médecin‑conseil et de la commission médicale.
37 Par courriel sécurisé du 4 mai 2023, le service médical a transmis à la requérante son dossier médical. Cependant, cette dernière y a eu accès uniquement le 10 mai 2023, après l’intervention du service informatique de la Commission.
38 Le 12 mai 2023, par la décision attaquée, l’AHCC a informé la requérante de sa décision de ne pas poursuivre la procédure de recrutement au motif que cette dernière ne possédait pas les aptitudes physiques requises pour l’exercice des fonctions envisagées et, par conséquent, ne remplissait pas les conditions fixées par l’article 82, paragraphe 3, sous d), du RAA.
39 Le 27 juillet 2023, le médecin spécialiste a adressé un courrier aux médecins-conseils de la commission médicale, en raison de la déclaration erronée figurant dans leur rapport selon laquelle lui-même et le spécialiste médicolégal avaient été entendus le 20 mars 2023 par cette commission, ainsi que des observations contenues dans leur rapport selon lesquelles il n’aurait pas respecté les règles déontologiques. Il demandait la rectification des informations erronées, à défaut de laquelle il déposerait plainte auprès du président du conseil de l’ordre des médecins compétent en Belgique. À cet égard, le 23 novembre 2023, la requérante a été informée qu’un corrigendum du rapport de la commission médicale avait été adopté.
40 Le 7 août 2023, la requérante a introduit une réclamation, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision attaquée.
41 La Commission n’ayant pas répondu dans un délai de quatre mois à compter de la date de la réclamation de la requérante, une décision implicite de rejet de cette réclamation est intervenue le 7 décembre 2023.
42 Le 19 mars 2024, à savoir le lendemain de l’introduction du recours devant le Tribunal, la Commission a communiqué à la requérante une décision explicite de rejet de sa réclamation.
Conclusions des parties
43 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– lui octroyer une somme d’un montant de 85 000 euros à titre de réparation des préjudices matériel et moral subis, susceptible d’augmentation en cours de procédure et soumise à des intérêts moratoires à compter de la date du prononcé de l’arrêt et jusqu’à son paiement intégral, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses principales opérations de refinancement, majoré de 3,5 points de pourcentage ;
– condamner la Commission aux dépens.
44 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
Sur les conclusions en annulation
45 La requérante soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré de ce que la décision attaquée serait fondée sur un rapport de la commission médicale entaché d’erreurs de fait et de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation. Le deuxième moyen est tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit quant à l’étendue des compétences de l’AHCC. Le troisième moyen est tiré de ce que la décision attaquée aurait été adoptée en violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.
Sur le premier moyen, tiré de ce que la décision attaquée serait fondée sur un rapport de la commission médicale entaché d’ erreur s de fait et de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’ appréciation
46 Le premier moyen comporte trois branches. Dans le cadre de la première branche, la requérante fait valoir que le rapport de la commission médicale a été adopté en violation de l’article 33, second alinéa, du statut et qu’il est entaché d’une erreur matérielle ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation résultant de l’absence de prise en compte de son certificat médical attestant son aptitude à reprendre le travail à compter du 1 er octobre 2022. Par la deuxième branche, la requérante allègue une absence de lien compréhensible entre les constatations médicales contenues dans le rapport de la commission médicale et la conclusion de son inaptitude à l’exercice des fonctions envisagées. La troisième branche est tirée d’une erreur de droit commise par la commission médicale dans l’interprétation et dans l’application de la notion de « troubles futurs », comportant une violation de l’article 33 du statut, de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et du principe de proportionnalité.
Sur la première branche du premier moyen, tirée de ce que le rapport de la commission médicale a été adopté en violation de l’article 33, second alinéa, du statut et est entaché d’une erreur matérielle ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation
47 La requérante allègue que, pour établir son rapport, la commission médicale n’a pas pris en compte le certificat médical attestant son aptitude à reprendre le travail à compter du 1 er octobre 2022 et qu’elle a commis différents types d’erreurs.
48 En premier lieu, selon la requérante, la commission médicale n’a pas réexaminé, de manière approfondie, sa situation médicale et s’est placée, à tort, à la date de ses examens médicaux d’embauche avec le médecin-conseil et le psychiatre de l’institution, sans prendre en compte tous les documents de son dossier médical qu’elle avait communiqués postérieurement auxdits examens. Ce faisant, la commission médicale aurait mal interprété l’étendue de ses compétences au sens de l’article 33 du statut, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et, par conséquent, elle aurait mal appliqué ladite disposition.
49 En deuxième lieu, la commission médicale aurait commis une erreur matérielle en considérant que la date d’adoption de l’avis négatif du médecin‑conseil était le 28 novembre 2022, alors que cet avis aurait été adopté le 13 janvier 2023, laissant aux médecins de l’institution suffisamment de temps pour examiner les documents présentés postérieurement aux examens médicaux d’embauche. À cet égard, l’avis du 13 janvier 2023 serait lui-même entaché d’irrégularités au motif qu’il ne prendrait pas en compte l’ensemble des données pertinentes pour apprécier la situation de la requérante au moment de son adoption et contiendrait une erreur matérielle, résultant de ce qu’il indique que, à la date de l’examen médical d’embauche du 14 novembre 2022, la requérante était en congé de maladie, sans tenir compte de son certificat médical attestant son aptitude à reprendre le travail à compter du 1 er octobre 2022.
50 En troisième lieu, la commission médicale aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. En effet, d’une part, elle n’aurait pas relevé que l’avis du médecin‑conseil du 13 janvier 2023 était entaché de l’erreur matérielle mentionnée au point 49 ci-dessus. D’autre part, la commission médicale aurait elle-même omis de tenir compte du certificat médical de la requérante attestant son aptitude à reprendre le travail à compter du 1 er octobre 2022 ainsi que de l’intégrité du médecin spécialiste ayant signé ce certificat. L’erreur manifeste d’appréciation serait susceptible d’être identifiée par le juge de l’Union. En effet, la communication tardive, à l’administration belge, du certificat de fin d’incapacité serait une question purement administrative n’ayant pas d’impact sur l’aptitude physique de la requérante à l’exercice de fonctions au sein de la Commission.
51 La Commission conteste les arguments de la requérante.
52 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, s’agissant des agents contractuels, l’article 82, paragraphe 3, sous d), du RAA est rédigé, en substance, dans les mêmes termes que l’article 28, sous e), du statut et prévoit :
« 3. Nul ne peut être engagé comme agent contractuel :
d) s’il ne remplit les conditions d’aptitudes physiques requises pour l’exercice de ses fonctions […] »
53 Aux termes de l’article 83 du RAA :
« Avant qu’il ne soit procédé à son engagement, l’agent contractuel est soumis à l’examen médical d’un médecin-conseil de l’institution, afin de permettre à celle‑ci de s’assurer qu’il remplit les conditions exigées à l’article 82, paragraphe 3, [sous] d).
L’article 33, second alinéa, du statut est applicable par analogie. »
54 Selon l’article 33, second alinéa, du statut :
« Lorsque l’examen médical prévu au premier alinéa a donné lieu à un avis médical négatif, le candidat peut demander, dans les vingt jours de la notification qui lui en est faite par l’institution, que son cas soit soumis à l’avis d’une commission médicale composée de trois médecins choisis par l’autorité investie du pouvoir de nomination parmi les médecins-conseils des institutions. Le médecin‑conseil qui a émis le premier avis négatif est entendu par la commission médicale. Le candidat peut saisir la commission médicale de l’avis d’un médecin de son choix. […] »
55 En l’espèce, la décision attaquée portant refus de recrutement de la requérante est fondée sur un seul motif, à savoir l’inaptitude physique de celle-ci à l’exercice des fonctions envisagées. Cette inaptitude ressort de l’avis négatif du médecin-conseil fondé sur l’avis du psychiatre de l’institution et confirmé par la commission médicale saisie par la requérante conformément à l’article 33, second alinéa, du statut.
56 L’examen médical, visé à l’article 33, premier alinéa, du statut en ce qui concerne les fonctionnaires et à l’article 83 du RAA en ce qui concerne les agents contractuels, a pour objectif de vérifier si, du point de vue de son état de santé, tant physique que psychique ou psychologique, le candidat à un poste est capable de remplir toutes les obligations qui sont susceptibles de lui incomber compte tenu de la nature de ses fonctions, conformément à l’article 28, sous e), du statut en ce qui concerne les fonctionnaires et à l’article 82, paragraphe 3, sous d), du RAA en ce qui concerne les agents contractuels.
57 Dans le cadre de l’examen médical mentionné au point 56 ci-dessus, il incombe au candidat de répondre au questionnaire médical ainsi qu’aux questions posées par le médecin de manière complète et sincère (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, EU:T:2000:86, point 77).
58 Si le candidat souhaite contester le bien‑fondé de l’avis négatif du médecin‑conseil, il doit saisir une commission médicale de l’avis de son médecin traitant, accompagné de tous les documents médicaux probants, et demander, le cas échéant, l’audition de son médecin traitant par ladite commission. En effet, la finalité de la procédure prévue à l’article 33, second alinéa, du statut consiste à permettre le réexamen d’un avis médical négatif par un organe statutaire, lequel doit émettre un avis définitif sur l’aptitude physique du candidat en tenant compte de tous les documents qui ont constitué, jusqu’à ce moment, le dossier médical de l’intéressé. Il appartient à la commission médicale d’apprécier l’opportunité de soumettre le candidat à un nouvel examen médical, en ordonnant éventuellement des tests complémentaires ou en demandant l’avis d’autres médecins spécialistes (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 1994, A/Commission, T‑10/93, EU:T:1994:39, point 27 et jurisprudence citée).
59 En ce qui concerne l’étendue du contrôle juridictionnel exercé sur la légalité d’un refus de recrutement motivé par une inaptitude physique, il a été jugé qu’il existait un lien étroit entre les avis des médecins de l’institution, celui de la commission médicale constatant l’inaptitude physique d’un candidat à l’exercice des fonctions envisagées et la décision de l’administration de ne pas le recruter. Ce lien étroit justifie, au vu de la cohésion des différents actes de la procédure de recrutement, que le Tribunal examine la légalité des actes préparatoires ayant abouti à la décision finale de ne pas recruter le candidat (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2009, V/Commission, F‑33/08, EU:F:2009:141, point 133 et jurisprudence citée).
60 C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner si, comme le prétend la requérante, la décision attaquée est illégale en ce qu’elle a été adoptée sur la base d’un rapport de la commission médicale entaché d’erreurs de fait et de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation. Plus précisément, il s’agit d’apprécier si la commission médicale devait relever l’irrégularité de l’avis négatif du médecin‑conseil et conclure à l’aptitude de la requérante à l’exercice des fonctions envisagées à la suite d’un réexamen complet de sa situation, conformément à l’article 33, second alinéa, du statut tel qu’interprété par le juge de l’Union.
61 En premier lieu, s’agissant de la violation de l’article 33 du statut alléguée par la requérante, il y a lieu de noter, à l’instar de la Commission, que le texte, le contexte et l’objectif de ladite disposition permettent de considérer que la commission médicale n’est pas tenue de soumettre à un nouvel examen médical un candidat déclaré inapte au travail et donc d’apprécier l’aptitude au travail de ce candidat à la date à laquelle elle se réunit.
62 En effet, premièrement, il ressort du texte de l’article 33, second alinéa, du statut que l’objet du contrôle de la commission médicale est l’avis négatif du médecin-conseil. D’ailleurs, il ressort en substance de la jurisprudence citée au point 58 ci‑dessus que la saisine de la commission médicale vise à permettre le réexamen d’un avis médical négatif.
63 Deuxièmement, il ressort de l’interprétation contextuelle de l’article 33 du statut ainsi que de l’article 83 du RAA que c’est l’examen médical en tant que tel qui est déterminant pour la nomination ou l’engagement d’un candidat. Pour cette raison, seule l’audition du médecin-conseil ayant délivré l’avis négatif est obligatoire. Cela confirme que c’est la validité de son avis qui est examinée au regard des éléments ressortant des examens médicaux d’embauche effectués par les médecins de l’institution. En effet, tant la participation du candidat déclaré inapte que la possibilité, pour celui-ci, de produire l’avis d’un médecin de son choix devant la commission médicale s’avèrent facultatives, comme cela ressort de la jurisprudence citée au point 58 ci-dessus. Selon cette même jurisprudence, il appartient à la commission médicale d’apprécier l’opportunité de soumettre le candidat à un nouvel examen médical, en ordonnant des tests complémentaires ou en demandant l’avis d’autres médecins spécialistes.
64 Troisièmement, comme cela est rappelé au point 56 ci-dessus, l’examen médical d’embauche vise à satisfaire l’intérêt légitime des institutions de l’Union à vérifier, préalablement à l’engagement d’un fonctionnaire ou d’un agent, que le candidat est en mesure d’accomplir la mission qui lui sera confiée. Ainsi, la finalité de l’article 33, second alinéa, du statut est de permettre à la commission médicale de vérifier que cet examen médical d’embauche a eu lieu correctement et que la situation médicale du candidat a été appréciée lors des examens médicaux d’embauche. C’est au moment des examens médicaux d’embauche que le candidat est évalué physiquement apte à l’exercice des fonctions envisagées, et non à une date ultérieure, telle que, par exemple, celle de la réunion de la commission médicale.
65 Les arrêts du 18 septembre 1992, X/Commission (T‑121/89 et T‑13/90, EU:T:1992:96, points 44 et 45), et du 13 décembre 2007, N/Commission (F‑95/05, EU:F:2007:226, points 62 et 63), mentionnés par la requérante, ne contredisent pas une telle interprétation de l’article 33 du statut. En effet, comme cela est précisé au point 63 ci-dessus, la possibilité de demander davantage d’examens médicaux est une faculté reconnue à la commission médicale, qui peut estimer qu’il n’est pas nécessaire d’y recourir pour réexaminer un avis médical négatif portant sur la situation du candidat à la date de ses examens médicaux d’embauche. Ces arrêts ne viennent donc pas au soutien de la thèse selon laquelle la commission médicale est tenue de procéder à un nouvel examen médical du candidat postérieurement à la date de ses examens médicaux d’embauche.
66 En l’espèce, il ressort de la partie « conclusions » du rapport de la commission médicale que le motif ayant conduit cette dernière à valider l’avis négatif du médecin-conseil, qui avait déclaré la requérante physiquement inapte à l’exercice des fonctions envisagées, est le fait que, lors des examens médicaux d’embauche effectués par les médecins de l’institution, respectivement le 14 et le 23 novembre 2022, la requérante se trouvait, pour l’administration belge, en situation d’invalidité depuis plus d’un an en raison de son congé de maladie et que, à ces dates, lesdits médecins ne disposaient pas d’autres informations susceptibles de leur indiquer que la requérante était guérie.
67 À cet égard il importe de noter que l’inaptitude physique de la requérante à l’exercice des fonctions envisagées a été constatée à la suite d’un double examen médical de celle-ci, effectué par des médecins de l’institution dans l’exercice de leurs fonctions et sur la base des informations fournies par la requérante oralement et par écrit lors de ses examens médicaux d’embauche. Ces médecins ont constaté que la requérante avait déclaré avoir souffert d’un burn-out, qu’elle était toujours en congé de maladie au moment de ses examens médicaux d’embauche, qu’elle n’avait pas arrêté ses traitements et qu’elle faisait encore l’objet d’un suivi médical à la date desdits examens. Il s’agit d’informations que les médecins de l’institution ont pu prendre en considération, conformément à la jurisprudence citée au point 57 ci-dessus, comme étant fournies par la requérante « de manière complète et sincère ».
68 La commission médicale a à juste titre pris en compte la situation de la requérante à la date de ses examens médicaux d’embauche et a correctement considéré que les avis des médecins de l’institution avaient été adoptés de manière régulière.
69 Par ailleurs, il convient de constater que la commission médicale n’a pas violé l’article 33 du statut en ne procédant pas elle-même à un nouvel examen médical de la requérante sur la base de circonstances intervenues postérieurement aux examens médicaux d’embauche.
70 Premièrement, la commission médicale a correctement identifié l’étendue de ses compétences, l’objet de son contrôle, la date à laquelle elle devait se placer et l’objectif qu’elle devait poursuivre. Plus précisément, elle a pertinemment vérifié que des examens médicaux d’embauche avaient eu lieu et a correctement considéré que l’objet de son examen était l’avis négatif du médecin‑conseil de l’institution, fondé sur l’avis du psychiatre de l’institution, en se plaçant aux dates auxquelles la requérante avait été examinée par lesdits médecins de l’institution.
71 Deuxièmement, dans le cadre de sa marge d’appréciation, la commission médicale a considéré qu’il n’était pas nécessaire de demander un examen complémentaire de la situation médicale de la requérante, car celle-ci avait été correctement examinée par les médecins de l’institution et un avis négatif avait été régulièrement émis le 28 novembre 2022 sur la base des informations dont les médecins de l’institution disposaient à la date des examens médicaux d’embauche ou, au plus tard, à la date d’émission de l’avis négatif du médecin-conseil (voir points 66 à 68 ci-dessus).
72 En deuxième lieu, il convient d’observer ce qui suit s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le rapport de la commission médicale est entaché d’une erreur matérielle au motif qu’il indique que l’avis négatif du médecin‑conseil a été signé le 28 novembre 2022, alors qu’il aurait été signé le 13 janvier 2023, laissant aux médecins de l’institution suffisamment de temps pour examiner les documents présentés postérieurement aux examens médicaux d’embauche (voir point 49 ci-dessus).
73 Dans la partie « conclusions » de son rapport, la commission médicale indique, notamment, que la requérante, au moment de ses examens médicaux d’embauche du 14 novembre 2022 avec le médecin-conseil et du 23 novembre 2022 avec le psychiatre de l’institution, a été correctement considérée comme inapte au travail. La commission médicale estime que tel était également le cas le 28 novembre 2022, au moment de la signature par le médecin-conseil de son avis négatif.
74 La décision de rejet de la réclamation précise que l’avis négatif du médecin-conseil du 28 novembre 2022 figurait dans la partie du questionnaire de l’examen médical d’embauche qu’il appartenait à ce médecin de remplir. Dans cette partie du questionnaire en cause, le médecin-conseil aurait indiqué que, en raison de l’avis négatif du psychiatre de l’institution, il considérait que la requérante était inapte à l’exercice des fonctions envisagées.
75 Le 6 décembre 2022, la requérante a été informée que, à la suite de ses examens médicaux d’embauche, un avis négatif avait été émis. La requérante ne pouvait ignorer que cet avis avait été émis par le médecin-conseil, seul compétent pour émettre un tel avis. Certes, le 6 décembre 2022, la requérante n’a pas été informée de la date exacte à laquelle ledit avis négatif avait été émis et signé, à savoir le 28 novembre 2022. Cependant, elle ne saurait présumer qu’un tel avis a été émis et signé le 13 janvier 2023 seulement, à savoir postérieurement au 6 décembre 2022 et presque deux mois après ses examens médicaux d’embauche.
76 La seule circonstance selon laquelle, en réponse à sa demande du 6 décembre 2022 de se voir communiquer les motifs de l’avis négatif du médecin-conseil, un rapport de ce dernier, daté du 13 janvier 2023, lui a été communiqué ne saurait démontrer que c’est seulement à cette dernière date que le médecin-conseil a émis et signé son avis négatif.
77 Au contraire, c’est précisément l’émission d’un avis négatif le 28 novembre 2022 qui a justifié que la requérante soit informée de son existence le 6 décembre 2022 et que, en réponse à sa demande du même jour, elle en reçoive les motifs détaillés le 13 janvier 2023.
78 Il s’ensuit que la commission médicale n’a pas commis d’erreur matérielle lorsqu’elle a indiqué que l’avis négatif avait été signé par le médecin-conseil le 28 novembre 2022.
79 La requérante soutient, en outre, que le rapport du médecin-conseil du 13 janvier 2023 est lui-même entaché d’irrégularités au motif qu’il ne prend pas en compte l’ensemble des données pertinentes pour apprécier sa situation au moment de l’adoption de ce rapport et qu’il contient une erreur matérielle, résultant de ce qu’il indique que, à la date de l’examen médical d’embauche du 14 novembre 2022, elle était en congé de maladie, sans tenir compte de son certificat médical attestant son aptitude à reprendre le travail à compter du 1 er octobre 2022.
80 À cet égard, il suffit de constater que le médecin-conseil n’a pas examiné la situation médicale de la requérante à la date du 13 janvier 2023, mais s’est limité à développer les motifs de son avis négatif émis le 28 novembre 2022 en rappelant les circonstances existant au moment des examens médicaux d’embauche.
81 Il s’ensuit que la requérante fait valoir erronément que le rapport du 13 janvier 2023 est entaché d’une erreur matérielle au motif que le médecin-conseil a omis d’apprécier sa situation à cette date et a donc à tort omis de prendre en compte son certificat médical, daté du 24 novembre 2022, attestant qu’elle était apte au travail à partir du 1 er octobre 2022. En effet, ledit certificat a été transmis au psychiatre de l’institution à une date postérieure aux examens médicaux d’embauche des 14 et 23 novembre 2022.
82 En troisième lieu, premièrement, la requérante soutient que la commission médicale a commis une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’elle a elle-même omis de constater l’erreur matérielle commise par le médecin-conseil en ce que ce dernier n’a pas constaté, le 13 janvier 2023, que, en raison de son certificat médical daté du 24 novembre 2022, elle était apte au travail à la date de ses examens médicaux d’embauche (voir point 50 ci-dessus).
83 Cependant, il convient de constater que, dans la mesure où le rapport du médecin-conseil du 13 janvier 2023 n’est pas entaché d’une telle erreur (voir point 81 ci-dessus), la commission médicale n’a pas elle-même commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle n’a pas identifié cette prétendue erreur matérielle.
84 En effet, la commission médicale a correctement considéré que l’avis négatif avait été émis le 28 novembre 2022, et non le 13 janvier 2023 (voir point 78 ci-dessus). Par ailleurs, cette même commission a correctement conclu que la requérante avait à juste titre été considérée comme inapte à l’exercice des fonctions envisagées aux dates des examens médicaux d’embauche sur la base des informations disponibles à ces dates et, au plus tard, à la date de la signature, par le médecin-conseil, le 28 novembre 2022, de son avis négatif, sur la base des informations à la disposition dudit médecin à cette dernière date (voir point 71 ci-dessus).
85 À cet égard, il convient d’observer que, lors de la signature de son avis négatif, le 28 novembre 2022, le médecin-conseil disposait de l’avis du psychiatre de l’institution du 23 novembre 2022, mais ne disposait pas du certificat médical du médecin spécialiste de la requérante, daté du 24 novembre 2022 et attestant que la requérante était apte au travail avec effet rétroactif à compter du 1 er octobre 2022. En effet, il ressort du dossier soumis au Tribunal que, le 28 novembre 2022, ce certificat avait été communiqué uniquement au psychiatre de l’institution.
86 Il y a donc lieu d’écarter l’argument de la requérante tiré de ce que la commission médicale a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a omis de constater que, à la date d’émission de l’avis négatif du médecin-conseil, ce dernier n’avait, à tort, pas pris en compte son certificat médical daté du 24 novembre 2022, susceptible d’attester qu’elle était apte au travail au moment des examens médicaux d’embauche.
87 Deuxièmement, la requérante soutient que la commission médicale a commis une erreur manifeste d’appréciation au motif que cette commission a omis de tenir compte de son certificat attestant avec effet rétroactif son aptitude au travail à compter du 1 er octobre 2022, de la valeur probante de ce certificat et de l’intégrité du médecin spécialiste signataire dudit document.
88 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 33, second alinéa, du statut, la commission médicale n’était pas tenue d’apprécier la situation médicale de la requérante à la date de sa réunion (voir point 61 ci-dessus). Ainsi, la commission médicale a pu pertinemment considérer que les rapports médicaux produits en vue de sa réunion du 20 mars 2023 n’existaient pas lors des examens médicaux d’embauche de la requérante et attestaient de faits qui étaient intervenus postérieurement auxdits examens et qui étaient donc inconnus des médecins de l’institution à la date de ces examens, et même à la date de l’émission des avis respectifs les concernant.
89 Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la commission médicale a validé l’avis négatif du médecin-conseil de l’institution et a écarté les rapports médicaux produits par la requérante pour attester, en substance, qu’elle ne présentait plus de « troubles actuels », puisqu’elle n’était plus en situation d’invalidité ni en congé de maladie à la date des examens médicaux d’embauche en raison d’un certificat médical émis postérieurement auxdits examens, avec effet rétroactif.
90 À la lumière de ce qui précède, les arguments de la requérante tirés de ce que la commission médicale aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en confirmant un avis négatif fondé sur la circonstance selon laquelle elle était en congé de maladie au moment de ses examens médicaux d’embauche ou de l’adoption de l’avis négatif du médecin-conseil doivent être rejetés.
91 Aucun des arguments avancés dans le cadre de la première branche du premier moyen n’ayant prospéré, il y a lieu de constater que le rapport de la commission médicale n’est pas entaché des erreurs de droit et de fait ni de l’erreur manifeste d’appréciation alléguées par la requérante dans le cadre de ladite branche et qu’il n’est donc pas irrégulier.
Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, tirées, respectivement, de l’absence de lien compréhensible entre les constatations contenues dans le rapport de la commission médicale et les conclusions dudit rapport ainsi que d’une erreur de droit commise par la commission médicale dans l’interprétation et l’application de la notion de « troubles futurs »
92 Dans le cadre de la deuxième branche de son premier moyen, la requérante fait valoir que la conclusion de la commission médicale selon laquelle elle était inapte à exercer ses fonctions est fondée sur la constatation erronée, figurant dans l’avis du médecin-conseil du 13 janvier 2023, selon laquelle elle était en situation d’invalidité et en congé de maladie depuis plus d’un an pour les autorités belges. Cette conclusion ne tiendrait pas compte de ce que ladite incapacité de travail aurait formellement pris fin le 1 er octobre 2022. Ainsi, dès lors qu’elle était capable d’exercer ses fonctions au moment de la procédure de recrutement, la commission médicale ne pouvait pas émettre un avis d’inaptitude au travail à son égard, sauf à établir un pronostic, médicalement fondé, de troubles futurs susceptibles de mettre en cause, dans un avenir prévisible, l’accomplissement normal des fonctions envisagées. Or, la commission médicale ne se serait pas acquittée de cette obligation.
93 En effet, sans effectuer elle-même un pronostic, la commission médicale se serait contentée de faire référence aux considérations du psychiatre de l’institution, selon lesquelles un risque de rechute ne pouvait pas être exclu, et de souligner, d’une part, que les rapports des praticiens traitant la requérante ne contenaient pas de pronostics futurs et, d’autre part, que la requérante n’avait même pas repris un travail à mi‑temps au moment des examens médicaux d’embauche. Ces considérations ne sauraient constituer un pronostic médicalement fondé pour les raisons qui suivent.
94 Premièrement, l’absence de troubles actuels de la requérante au moment de la procédure de recrutement aurait été constatée par le psychiatre de l’institution lui-même, comme en attesterait le rapport du spécialiste médicolégal et comme cela ressortirait de la décision explicite de rejet de la réclamation. Cette absence de troubles actuels aurait également été certifiée par les rapports médicaux transmis à la commission médicale le 15 mars 2023. Par conséquent, si la commission médicale avait estimé qu’aucun rapport ne comportait de pronostic de la situation future de la requérante, il lui aurait incombé d’évaluer de façon précise, documentée et in concreto le pronostic du psychiatre de l’institution. De même, si la commission médicale avait considéré que les tests de retour de capacité cognitive et de résistance au stress n’étaient pas suffisants d’un point de vue médical pour démontrer l’aptitude de la requérante à reprendre le travail, il lui aurait incombé de procéder à des tests et à des vérifications complémentaires pour accomplir sa mission.
95 Deuxièmement, la commission médicale n’aurait pas pu se fonder sur la durée du congé de maladie et sur l’absence de reprise d’activité professionnelle de la requérante depuis la fin de son état d’invalidité en tant qu’éléments de nature à constituer un pronostic médicalement fondé de troubles futurs. En effet, d’une part, le burn-out de la requérante aurait été également lié à sa situation familiale qui, comme cela a été noté par la commission médicale elle-même, s’était améliorée. D’autre part, son absence de reprise d’activité professionnelle au 14 novembre 2022 aurait été liée à la circonstance selon laquelle un poste lui avait été proposé lors de l’examen d’embauche du 10 octobre 2022 et, par conséquent, il n’aurait pas été envisageable pour elle de reprendre contact avec ses clients en tant qu’avocate indépendante avant de prendre ses fonctions au sein de la Commission à partir de janvier 2023.
96 Troisièmement, le pronostic de la commission médicale ne saurait davantage reposer sur les prétendues déclarations de la requérante, lors de l’examen effectué le 23 novembre 2022 par le psychiatre de l’institution, selon lesquelles elle se sentait toujours en burn-out. Ces déclarations, qui n’apparaissent pas dans l’avis dudit psychiatre, ressortiraient d’un témoignage de celui-ci devant l’ordre des médecins compétent en Belgique, le 31 janvier 2024, à savoir plus de quatorze mois après ledit examen. À cet égard, si le Tribunal voulait utiliser ledit témoignage, la requérante lui demande de l’obtenir par le biais d’une mesure d’organisation de la procédure et de lui donner accès à ce témoignage pour garantir l’exercice de ses droits de la défense.
97 Au vu de tout ce qui précède, la requérante soutient que la commission médicale n’a pas établi un lien compréhensible entre ses constatations médicales et la conclusion à laquelle elle est arrivée. Ainsi, son rapport serait entaché d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation et la décision attaquée, qui se fonde sur ce rapport, devrait être annulée.
98 Dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, la requérante fait valoir que la commission médicale a commis également une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de la notion de « troubles futurs », qui affecte la régularité de son avis. Ladite notion aurait été interprétée comme concernant des maladies évolutives et comme visant le cas où, à la date de son embauche, une personne est atteinte d’une affection qui n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions envisagées, mais qui, dans un avenir prévisible, va évoluer en mettant en cause la capacité de cette personne à accomplir lesdites fonctions. La définition de la notion de « troubles futurs » retenue par la commission médicale ne correspondrait pas à celle établie par la jurisprudence, selon laquelle seuls des éléments statistiques précis et chiffrés concernant un risque de récidive ou un constat d’absence de symptômes pathologiques actuels liés à une maladie latente constituent des éléments permettant d’établir un pronostic avec un degré de certitude suffisant.
99 Ainsi, selon la requérante, la notion de « troubles futurs » ne saurait être interprétée comme visant tout risque de rechute d’une maladie dont le candidat à l’embauche a guéri. Une telle approche, suivie par la commission médicale, qui conduirait à refuser un poste à un candidat au seul motif que, dans le passé, il aurait souffert d’une affection, sans tenir compte du fait qu’il en serait complètement guéri, méconnaîtrait la finalité de l’article 33 du statut, le principe de non-discrimination visé à l’article 21 de la Charte et les dispositions de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).
100 Cette approche serait également contraire au principe de proportionnalité, étant donné qu’un avis d’inaptitude ne serait nullement nécessaire pour atteindre l’objectif, fixé à l’article 82 du RAA, de recruter des agents remplissant les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice des fonctions envisagées. À ce titre, la requérante souligne que la commission médicale n’a même pas examiné le poste qu’elle postulait et constaté qu’il s’agissait d’un poste de nature temporaire ne présentant pas un degré de complexité particulier.
101 Enfin, l’approche suivie par la commission médicale méconnaîtrait l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap, qui s’étend également aux parents d’enfants handicapés. En effet, d’une part, la commission médicale aurait considéré de manière illégale un burn-out circonscrit dans le temps comme étant une maladie permanente et invalidante. D’autre part, l’approche suivie par la commission médicale reviendrait à considérer que, dès lors que l’un de ses enfants est porteur d’un handicap permanent, le parent ayant eu un burn-out demeurerait inapte à travailler de façon permanente.
102 La Commission conteste les arguments avancés par la requérante dans le cadre des deuxième et troisième branches du premier moyen. En outre, interrogée lors de l’audience, elle précise que la commission médicale n’a pas fondé son avis d’inaptitude sur un pronostic de troubles futurs.
103 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon le juge de l’Union, un avis négatif du médecin-conseil d’une institution peut être fondé non seulement sur l’existence de troubles physiques ou psychiques actuels, mais également sur un pronostic, médicalement fondé, de troubles futurs, susceptibles de mettre en cause, dans un avenir prévisible, l’accomplissement normal des fonctions envisagées (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 1994, A/Commission, T‑10/93, EU:T:1994:39, point 62).
104 En outre, il importe de noter que, sur des questions relevant spécifiquement de la médecine, le Tribunal ne saurait substituer sa propre appréciation à l’avis médical. Il est cependant censé, dans le cadre de la mission qui lui est propre, contrôler si la procédure de recrutement s’est déroulée dans la légalité et, plus spécifiquement, examiner si la décision attaquée refusant le recrutement d’un candidat en raison d’une inaptitude physique repose sur un avis médical motivé établissant un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et la conclusion d’inaptitude à laquelle il arrive (voir arrêt du 18 septembre 1992, X/Commission, T‑121/89 et T‑13/90, EU:T:1992:96, point 45 et jurisprudence citée ; arrêt du 14 avril 1994, A/Commission, T‑10/93, EU:T:1994:39, point 61). L’appréciation des médecins, notamment celle de la commission médicale, doit être tenue pour définitive lorsqu’elle est intervenue dans des conditions régulières (voir arrêt du 15 juin 2011, V/Commission, T‑510/09 P, EU:T:2011:272, point 68 et jurisprudence citée).
105 En l’espèce, d’une part, le raisonnement de la requérante repose sur la prémisse selon laquelle la commission médicale s’est fondée sur la constatation erronée, figurant dans l’avis du médecin-conseil du 13 janvier 2023, selon laquelle elle était en invalidité et en congé de maladie depuis plus d’un an pour les autorités belges. D’autre part, le raisonnement de la requérante se fonde sur la conviction qu’elle ne présentait pas de troubles actuels au moment des examens médicaux d’embauche et que la commission médicale aurait donc validé un pronostic de troubles futurs potentiels formulé par le psychiatre de l’institution lors de la réunion de ladite commission.
106 En premier lieu, force est de constater que la requérante considère à tort que la commission médicale s’est fondée sur les constatations du médecin-conseil à la date du 13 janvier 2023. En effet, lors de l’examen de la première branche du premier moyen (voir point 66 ci-dessus), il a été jugé que la commission médicale avait correctement pris en compte la situation de la requérante au moment de ses examens médicaux d’embauche, à savoir les 14 et 23 novembre 2022. À cet égard, la commission médicale a pertinemment constaté que, à ces dates, la requérante était encore en situation d’invalidité et en congé de maladie sur la base des informations à la disposition des médecins de l’institution. En outre, la commission médicale a correctement constaté que le médecin-conseil n’avait pas commis d’erreur de droit ou de fait en considérant que la requérante était inapte au travail à la date de signature, le 28 novembre 2022, de son avis négatif fondé sur les informations dont il disposait à cette date.
107 En second lieu, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle il n’existe pas de lien compréhensible entre les constatations de la commission médicale et ses conclusions, il importe d’observer que la commission médicale a validé un avis négatif fondé sur un constat de troubles actuels à la date des examens médicaux d’embauche. Ni les médecins de l’institution ni la commission médicale n’ont procédé à un examen de la requérante postérieur aux dates des examens médicaux d’embauche ou fondé leur appréciation de la situation médicale de la requérante sur un pronostic de troubles futurs. Par ailleurs, les propos attribués au psychiatre de l’institution dans la partie « discussion » du rapport de la commission médicale ne sauraient impliquer que l’éventuelle existence de troubles futurs a été prise en considération en tant que fondement de l’inaptitude de la requérante, d’autant plus qu’ils sont formulés en des termes hypothétiques.
108 S’agissant des documents fournis par la requérante à la commission médicale pour démontrer une absence de troubles actuels à la date des examens médicaux d’embauche, ceux-ci consistent en un rapport médical du médecin spécialiste du 24 novembre 2022 concernant l’état de santé de la requérante, accompagné des résultats de tests psychométriques effectués le 15 avril 2021, en une attestation médicale du même médecin du 25 novembre 2022, en un rapport de la psychologue de la requérante du 28 novembre 2022, en un rapport du spécialiste médicolégal du 27 janvier 2023 et en un autre rapport de ce même médecin du 13 mars 2023 critiquant l’évaluation médicale du psychiatre de l’institution.
109 À cet égard, la commission médicale a considéré que les documents mentionnés au point 108 ci-dessus ne remettaient pas en cause les avis des médecins de l’institution selon lesquels la requérante était inapte au travail à la date des examens médicaux d’embauche. Comme cela est indiqué au point 88 ci‑dessus, ces documents n’existaient pas au moment desdits examens et, en outre, ils étaient inconnus des médecins de l’institution ayant examiné la requérante au moment de l’établissement de leurs avis respectifs.
110 En outre, s’agissant de l’examen de ces documents par la commission médicale elle-même à la date de sa réunion, il ressort de la partie « discussion » de son rapport que, tout d’abord, cette commission a critiqué, d’un point de vue déontologique, la pratique du médecin spécialiste de la requérante consistant à émettre, postérieurement aux examens médicaux d’embauche, un certificat médical avec effet rétroactif. Puis, elle a rappelé les observations de la requérante selon lesquelles sa situation auprès de la mutuelle belge était incertaine au moment de ses examens médicaux d’embauche ainsi que les observations du psychiatre de l’institution selon lesquelles il existait un risque élevé de rechute lié à la circonstance selon laquelle la requérante était restée longtemps en congé de maladie. Enfin, la commission médicale a exprimé ses propres considérations quant aux circonstances qui, en l’espèce, justifiaient de valider l’avis négatif du médecin-conseil du 28 novembre 2022. Plus précisément, elle a souligné que la pratique habituelle en cas de congé de maladie de longue durée était de reprendre le travail à mi-temps et qu’un éventuel avis d’aptitude aurait impliqué de constater une capacité de travail de 100 %.
111 Ces considérations de la commission médicale permettent de comprendre que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, c’est encore une fois la situation de cette dernière à la date de ses examens médicaux d’embauche, à savoir le fait qu’elle n’avait pas recommencé à travailler à mi-temps après son congé de maladie de longue durée, qui, selon ladite commission, justifiait de ne pas avoir émis un avis d’aptitude au travail pour un poste impliquant une reprise à plein temps.
112 Il en résulte qu’il existe un lien compréhensible entre, d’une part, les constatations de la commission médicale selon lesquelles, à la différence de la pratique habituelle en cas de congé de maladie de longue durée, la requérante n’avait pas encore recommencé à travailler à mi-temps et était, en raison de troubles actuels, physiquement inapte à exercer les fonctions envisagées pour un poste exigeant une capacité de travail de 100 % et, d’autre part, les conclusions de ladite commission visant à valider l’avis négatif du médecin-conseil du 28 novembre 2022. En effet, cet avis négatif ne fait qu’attester l’inaptitude physique de la requérante à l’exercice des fonctions envisagées en raison de sa condition de santé au moment des examens médicaux d’embauche et ne se fonde pas sur un pronostic futur de son état de santé.
113 À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du premier moyen, sans qu’il soit besoin d’adopter la mesure d’organisation de la procédure mentionnée au point 96 ci-dessus.
114 Dans la mesure où l’avis de la commission médicale repose sur le constat de troubles actuels, et non sur un pronostic de troubles futurs, les arguments avancés par la requérante au soutien de la troisième branche du premier moyen doivent également être rejetés.
115 En tout état de cause, même à supposer que la commission médicale ait pu prendre en compte, quod non, à titre surabondant, un pronostic de troubles futurs formulé par le psychiatre de l’institution lors de sa réunion le 20 mars 2023, la prétendue illégalité de ce deuxième fondement du rapport de la commission médicale ne saurait priver de validité ledit rapport en tant qu’il est correctement fondé sur le constat de troubles actuels.
116 Ainsi, les arguments de la requérante avancés dans le cadre de la troisième branche du premier moyen s’avèrent, en tout état de cause, inopérants aux fins de l’appréciation de la légalité de la décision attaquée, qui demeure fondée sur un rapport valide de la commission médicale.
117 Les trois branches du premier moyen ayant été écartées, il y a lieu de rejeter ce moyen dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, tiré de ce que l’AHCC aurait commis une erreur de droit quant à l’étendue de ses compétences
118 La requérante fait valoir que l’AHCC a commis une erreur de droit en considérant qu’elle ne pouvait pas vérifier si le rapport de la commission médicale était entaché d’illégalité avant d’adopter la décision attaquée. En effet, en dépit du fait que la requérante avait fait une demande en ce sens et avait autorisé l’AHCC à accéder aux rapports et aux conclusions du médecin-conseil et de la commission médicale la concernant, cette autorité aurait refusé de vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve produits, leur fiabilité, leur cohérence ainsi que leur caractère pertinent et susceptible d’étayer les conclusions qui en étaient tirées.
119 Selon la requérante, il ne s’agissait pas de procéder à une évaluation médicale de son cas. L’AHCC aurait uniquement dû vérifier la matérialité des éléments factuels sur lesquels la commission médicale s’était fondée ainsi que l’existence d’un lien compréhensible entre les constatations médicales et la conclusion qui en découlait. Selon la requérante, le pouvoir d’appréciation en matière médicale reconnu au médecin n’est pas contesté et tant le juge que l’administration peuvent vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreurs procédurales ou de détournement de pouvoir commis par la commission médicale.
120 Les vérifications d’ordre purement procédural effectuées par l’AHCC au stade de l’adoption de la décision attaquée n’auraient pas été suffisantes et cette dernière n’aurait pas pu refuser de vérifier tant la matérialité des faits sur lesquels la commission médicale s’était fondée que le lien compréhensible entre les constatations de cette dernière et sa conclusion. S’agissant des appréciations de nature médicale, tant l’AHCC que le juge de l’Union seraient compétents pour vérifier si la commission médicale avait pris en compte tous les éléments pertinents.
121 Le refus de l’AHCC de procéder aux vérifications nécessaires obligerait la requérante à saisir le Tribunal pour obtenir ledit contrôle. Ainsi, le comportement de l’AHCC méconnaîtrait également le principe de bonne administration.
122 La Commission rétorque que l’AHCC n’a commis aucune erreur de droit lors de l’adoption de la décision attaquée, puisqu’elle a procédé à des vérifications de nature procédurale en examinant tous les éléments ne relevant pas de l’évaluation médicale. Elle ajoute que le deuxième moyen est inopérant, puisque ni l’avis négatif du médecin-conseil ni le rapport de la commission médicale n’étaient entachés d’irrégularités.
123 En l’espèce, dans sa lettre du 25 avril 2023, la requérante demandait, en substance, à l’AHCC de vérifier, d’abord, le respect de règles de forme concernant les motifs de l’avis d’inaptitude, ensuite, la matérialité, la fiabilité et la cohérence des éléments factuels sur lesquels la commission médicale s’était fondée et, enfin, l’existence d’un lien compréhensible entre les constations médicales et la conclusion qui en découlait. Cette demande était fondée sur la prémisse selon laquelle le rapport de la commission médicale était entaché des irrégularités alléguées dans le cadre du premier moyen.
124 À cet égard, premièrement, il ressort de la lecture de la décision attaquée que l’AHCC a communiqué à la requérante la décision de ne pas poursuivre son recrutement au motif qu’elle avait été informée, par le service médical, que, à l’issue de la procédure visée à l’article 83 du RAA, il avait été conclu qu’elle ne possédait pas les aptitudes physiques requises pour l’exercice des fonctions envisagées. Deuxièmement, il est indiqué dans la décision attaquée que l’AHCC n’est pas compétente pour évaluer les conditions physiques de la requérante et qu’elle a donc considéré inapproprié d’accéder aux données médicales de cette dernière. Troisièmement, la décision attaquée fait état de ce que l’AHCC a vérifié les aspects procéduraux de la procédure de recrutement et a constaté que celle-ci s’était déroulée correctement.
125 À ce dernier titre, l’ensemble des éléments vérifiés par l’AHCC ressort de la décision attaquée. Plus précisément, l’AHCC a vérifié que la requérante avait fait l’objet d’un examen médical, qu’elle avait été informée de l’émission d’un avis négatif à son égard et qu’elle avait pu, en application de l’article 33, second alinéa, du statut, saisir une commission médicale et lui transmettre des rapports et des documents médicaux des praticiens la traitant. L’AHCC a également observé que ces rapports et documents médicaux avaient été examinés et écartés par la commission médicale comme étant insusceptibles de remettre en cause les avis des médecins de l’institution et que, lors de la réunion de ladite commission, le 20 mars 2023, tant les médecins de l’institution que la requérante avaient été entendus.
126 Or, dans la mesure où, lors de l’examen du premier moyen du recours, le Tribunal a constaté que ni l’avis négatif du médecin-conseil ni le rapport de la commission médicale contenant l’avis de cette dernière n’étaient entachés des erreurs de fait et de droit alléguées par la requérante, même à supposer que l’AHCC n’ait pas procédé aux vérifications demandées par cette dernière, une telle omission ne saurait entraîner l’annulation de la décision attaquée.
127 En d’autres termes, la décision attaquée étant fondée sur un rapport de la commission médicale non entaché d’irrégularité et présentant un lien compréhensible entre les constatations et les conclusions qui y figurent, les arguments de la requérante tirés de ce que l’AHCC n’a pas procédé aux vérifications demandées doivent être rejetés comme inopérants.
128 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter également le deuxième moyen du recours.
Sur le troisième moyen, tiré de la méconnaissance du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude
129 La requérante soutient que le service médical et l’AHCC n’ont pas respecté le principe de bonne administration et le devoir de sollicitude dans la gestion du processus de recrutement. La nécessité de respecter ledit principe et ledit devoir dans le cadre d’une procédure de recrutement externe aurait été reconnue par la jurisprudence.
130 Premièrement, la méconnaissance du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude résulterait des délais déraisonnables de traitement des demandes d’accès de la requérante aux éléments de son dossier appliqués par le service médical. À titre d’exemple, les motifs de l’avis négatif établi par le médecin‑conseil, demandés le 6 décembre 2022, auraient été communiqués, après de multiples relances auprès de la Commission, le 20 janvier 2023 seulement et de manière incomplète, car le rapport du psychiatre de l’institution sur lequel ledit avis était fondé n’était pas joint. Ce dernier rapport aurait été transmis à la requérante par l’intermédiaire du spécialiste médicolégal de cette dernière, le 6 mars 2023 seulement, à savoir quatre mois après sa rédaction par ledit psychiatre. Un tel délai serait injustifié, d’autant plus que la requérante aurait dû, en principe, prendre ses fonctions en janvier 2023.
131 Afin de justifier l’absence de célérité dans le traitement de ses demandes, le service médical se serait semble-t-il fondé sur l’article 14 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n o 45/2001 et la décision n o 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39), et aurait soutenu qu’il disposait d’un délai d’un mois pour traiter chacune des demandes de la requérante. Cependant, il ressortirait de cette disposition que l’administration devait traiter sans délai et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois, une demande d’accès à un dossier médical. Quoi qu’il en soit, il serait abusif d’appliquer cette disposition à une procédure de recrutement, car elle devrait s’articuler avec le principe de bonne administration et avec le devoir de sollicitude exigeant, en l’espèce, la plus grande célérité de la part de l’administration. Ainsi, la position du service médical relèverait plutôt d’une manœuvre dilatoire visant à empêcher le recrutement de la requérante. En outre, l’exigence de procéder à un examen particulièrement rigoureux des données médicales de la requérante ne saurait justifier un délai plus étendu pour traiter les demandes de cette dernière. En effet, les avis des médecins-conseils auraient été rédigés immédiatement, voire le jour même de la demande d’accès de la requérante, et les procédures de communication de ces avis seraient habituelles. Enfin, la justification du retard lié aux congés de fin d’année ne saurait davantage être retenue.
132 Deuxièmement, la mise en place d’une commission médicale aurait pris plus de trois mois et, après la réunion de cette commission, le 20 mars 2023, un autre mois se serait écoulé avant que la requérante ne soit informée du contenu du rapport de ladite commission. En outre, plusieurs relances de la requérante et de son conseil auraient eu lieu avant que la requérante n’obtienne, le 10 mai 2023, le rapport et les conclusions de la commission médicale. À ce propos, l’écoulement déraisonnable du temps aurait eu une incidence négative sur le contenu de la décision attaquée. En effet, plus de cinq mois se seraient écoulés entre la date à laquelle le médecin‑conseil aurait donné son avis (soit le 28 novembre 2022) et celle à laquelle la requérante aurait reçu l’avis de la commission médicale (soit le 10 mai 2023) et la décision attaquée (soit le 12 mai 2023). La jurisprudence citée par la Commission, selon laquelle un délai d’un an pour transmettre les conclusions de la commission médicale et un délai de cinq mois pour adopter la décision de l’AIPN seraient considérés comme étant déraisonnables, ne saurait être appliquée par analogie en l’espèce. En effet, le caractère raisonnable d’un délai devrait être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et ladite jurisprudence concernerait un délai pris par une commission d’invalidité pour transmettre ses conclusions à un fonctionnaire ou à un agent déjà en poste s’agissant de son droit à recevoir une pension d’invalidité.
133 Troisièmement, la méconnaissance du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude par la Commission aurait perduré même après l’adoption de la décision attaquée. En effet, la requérante n’aurait pas reçu de décision explicite de l’AHCC en réponse à sa réclamation avant le dernier jour du délai de recours allongé du délai de distance, malgré les indications contraires de la Commission selon lesquelles une réponse allait lui être fournie rapidement, ce qui l’a placée dans une situation d’insécurité juridique quant à la recevabilité de son recours et dans une situation d’incertitude, d’attente et d’urgence inacceptable.
134 La Commission conteste les arguments avancés par la requérante dans le cadre du troisième moyen.
135 En premier lieu, il importe de rappeler que la Cour a reconnu le devoir de sollicitude de l’administration d’une institution ou d’un organisme de l’Union à l’égard de ses agents. Elle a précisé que ce devoir reflétait l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut avait créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public et a jugé que ledit devoir ainsi que le principe de bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte, impliquaient, notamment, que, lorsqu’elle statuait sur la situation d’un fonctionnaire ou d’un agent tout comme sur celle d’un candidat à un poste de fonctionnaire ou d’agent, l’administration tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui de la personne concernée (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2020, Schokker/AESA, C‑310/19 P, non publié, EU:C:2020:435, point 55).
136 En second lieu, il importe de noter qu’il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation d’observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général du droit de l’Union dont le juge de l’Union assure le respect et qui est d’ailleurs repris comme une composante du droit à une bonne administration par l’article 41, paragraphe 1, de la Charte (voir arrêt du 17 mai 2018, Commission/AV, T‑701/16 P, EU:T:2018:276, point 45 et jurisprudence citée).
137 Toutefois, la violation du principe du respect du délai raisonnable ne justifie pas, en règle générale, l’annulation de la décision prise à l’issue d’une procédure administrative. En effet, ce n’est que lorsque l’écoulement excessif du temps est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l’issue de la procédure administrative que le non-respect du principe du délai raisonnable affecte la validité de la procédure administrative (voir arrêt du 17 mai 2018, Commission/AV, T‑701/16 P, EU:T:2018:276, point 46 et jurisprudence citée).
138 C’est à la lumière de cette jurisprudence que doit être examiné le troisième moyen.
139 À titre liminaire, il importe de noter que les arguments avancés par la requérante pour faire valoir une violation du devoir de sollicitude se confondent avec ceux avancés pour faire valoir une violation du principe de bonne administration. En effet, selon la requérante, tant la violation du devoir de sollicitude que la violation du principe de bonne administration résultent des délais déraisonnables de traitement de ses demandes au cours des différentes étapes de la procédure administrative.
140 À titre principal, premièrement, s’agissant du respect du délai raisonnable dans la conduite de la procédure de recrutement, il importe d’observer que le non-respect de ce délai pour transmettre à la requérante le rapport du psychiatre de l’institution lui permettant de comprendre les motifs de l’avis négatif émis à son égard, à le supposer établi, n’a pas d’incidence sur la régularité du rapport de la commission médicale ni sur la légalité de la décision attaquée. En effet, à l’instar de la Commission, il convient de noter que, même en l’absence du retard qu’elle allègue dans la communication qui lui a été faite des motifs de l’avis négatif, la requérante n’aurait pas été reconnue apte à l’exercice des fonctions envisagées et la décision attaquée n’aurait pas pu être différente.
141 Deuxièmement, il importe de constater que la mise en place d’une commission médicale dans un délai de trois mois et la communication à la requérante du rapport de ladite commission sont intervenues dans un délai raisonnable. En effet, la requérante a introduit son recours le 20 janvier 2023 et ladite commission a été mandatée par décision du directeur compétent du 17 mars 2023. Par ailleurs, la commission médicale s’est réunie le 20 mars 2023 et, le 4 mai 2023, la requérante a reçu le rapport établi par ladite commission contenant l’avis de cette dernière.
142 Troisièmement, s’agissant du retard dans l’adoption de la décision de rejet de la réclamation, force est de constater que ce grief est inopérant au regard des conclusions en annulation qui visent uniquement la décision attaquée. À cet égard il importe de rappeler que, si une irrégularité affectant le déroulement de la procédure de réclamation peut conduire à l’annulation de la décision rejetant la réclamation, dans l’hypothèse où la partie requérante a présenté des conclusions tendant spécifiquement à l’annulation de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 29 mai 2024, Canel Ferreiro/Conseil, T‑766/22, EU:T:2024:336, points 31 et 33), une telle irrégularité, propre à la procédure de réclamation, ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision initiale, c’est-à-dire, en l’espèce, la décision attaquée.
143 Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen du recours ainsi que, par conséquent, les conclusions en annulation.
Sur les conclusions en indemnité
144 Par sa demande en indemnité, la requérante demande la réparation des préjudices matériel et moral que le comportement illégal de la Commission lui aurait causés. Ce comportement illégal résulterait, d’une part, de ce que, par la décision implicite de rejet de la réclamation, l’AIPN aurait confirmé la décision attaquée, qui est illégale en tant qu’elle est fondée sur l’avis irrégulier de la commission médicale. Ledit comportement illégal découlerait, d’autre part, de la méconnaissance du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude dans le traitement des demandes présentées par la requérante ainsi que du déroulement de la procédure d’adoption de la décision attaquée en général, y compris de la procédure de réclamation.
145 S’agissant du préjudice matériel, la requérante soutient qu’elle a été privée d’une chance réelle d’être recrutée pour une durée déterminée, puisqu’elle avait été informée de l’intention du chef de l’unité « Copyright » de la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies de la Commission de l’embaucher et avait reçu une offre à cet égard. Son engagement était subordonné uniquement à la reconnaissance de son aptitude physique à l’exercice de ses fonctions. Par conséquent, si la commission médicale avait adopté un avis régulier, elle aurait été considérée comme apte à exercer ses fonctions et son recrutement aurait eu lieu. Elle évalue cette perte de chance, ex æquo et bono, à un montant de 60 000 euros en se basant sur la rémunération qu’elle aurait pu percevoir pour la durée de son engagement en qualité d’agent.
146 La requérante ajoute que, lorsque la chance dont un candidat a été privé ne peut pas être quantifiée sous la forme d’un coefficient mathématique, la jurisprudence admet une évaluation ex æquo et bono du préjudice. C’est l’évaluation que la requérante aurait faite en l’espèce en tenant compte de la perte de chance de recevoir une rémunération dans le cadre d’un contrat susceptible d’être renouvelé pour six ans, de la perte des allocations familiales et de cotisation au régime de pension de l’Union ainsi que du retard dans la reprise de son travail en tant que travailleuse indépendante en raison de la durée de la procédure en cause.
147 S’agissant du préjudice moral, la requérante fait valoir que le comportement de l’administration, et notamment celui du service médical, l’a empêchée de finaliser le processus de recrutement pour un poste qui l’intéressait beaucoup et a entraîné pour elle un sentiment de frustration et d’injustice important. Ce sentiment aurait été accentué par l’absence de célérité dans le traitement de ses demandes ainsi que dans le déroulement de la procédure en général, y compris dans la procédure de réclamation. Cette absence de célérité l’aurait placée dans l’incertitude pendant plusieurs mois et l’aurait empêchée de « passer à un autre projet professionnel ».
148 Le recrutement pour le poste pour lequel la requérante se portait candidate étant initialement envisagé pour le mois de janvier 2023, il serait probable qu’il ait déjà été pourvu. Ainsi, l’annulation de la décision attaquée ne constituerait pas une réparation adéquate et, en tout état de cause, serait insusceptible de réparer la méconnaissance du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude. La requérante demande donc à se voir accorder, en réparation de son préjudice moral, une indemnité évaluée ex æquo et bono à 25 000 euros.
149 Enfin, la requérante soutient que son préjudice moral s’est accentué entre la date de l’introduction de sa réclamation et celle de l’introduction de son recours au regard, notamment, de la manière dont a été traitée sa réclamation.
150 La Commission conteste les conclusions en indemnité.
151 À titre liminaire, d’une part, il importe d’observer que la requérante fait valoir que c’est l’illégalité de la décision attaquée qui est à l’origine des préjudices matériel et moral qu’elle prétend avoir subis. D’autre part, la requérante demande la réparation du préjudice moral prétendument subi en raison de la durée excessivement longue de la procédure précontentieuse, résultant de l’adoption de la décision de rejet de la réclamation le lendemain de l’introduction du recours devant le Tribunal.
152 S’agissant des conclusions indemnitaires visant à obtenir la réparation des préjudices matériel et moral résultant de la prétendue illégalité de la décision attaquée, il ressort de la jurisprudence que, en matière de fonction publique, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions à fin d’annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme non fondées (voir arrêt du 19 décembre 2019, HK/Commission, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, point 93 et jurisprudence citée). En l’espèce, lesdites conclusions indemnitaires présentent un lien étroit avec les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée. Dès lors que les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée ont été rejetées, il convient, par voie de conséquence, de rejeter également lesdites conclusions indemnitaires comme non fondées.
153 S’agissant des conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice moral résultant de la durée excessivement longue de la procédure précontentieuse en raison de l’adoption de la décision de rejet de la réclamation le lendemain de l’introduction du recours devant le Tribunal, il importe d’observer ce qui suit.
154 Selon la jurisprudence, lorsqu’il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité, cette dernière est recevable en tant qu’accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédée tant d’une demande invitant l’AHCC à réparer les préjudices prétendument subis que d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande (voir arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE, T‑462/17, non publié, EU:T:2019:397, point 182 et jurisprudence citée). En revanche, lorsque l’action indemnitaire ne présente pas de lien direct avec le recours en annulation, notamment lorsqu’elle est fondée sur un comportement postérieur à l’adoption de la décision attaquée, la recevabilité de l’action indemnitaire est subordonnée au respect de la procédure précontentieuse (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, XI/Commission, T‑528/18, non publié, EU:T:2019:594, point 53).
155 En l’espèce, le comportement reproché à l’administration, à savoir l’adoption tardive d’une décision de rejet de la réclamation, ne résulte pas directement de l’adoption de la décision attaquée. Ledit comportement a été mis en œuvre par l’administration postérieurement à la décision attaquée et est, ainsi, détachable de celle-ci. Il en résulte que, en tant qu’elles sont fondées sur un tel comportement de l’administration, les conclusions indemnitaires ne présentent pas un lien direct avec les conclusions en annulation.
156 Or, il ne ressort pas du dossier que la demande indemnitaire mentionnée au point 153 ci-dessus a été précédée d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions du statut. Par conséquent, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice moral causé par le comportement fautif de l’administration résultant de l’adoption tardive de la décision de rejet de la réclamation doivent être rejetées comme irrecevables.
157 Il résulte de ce qui précède que les conclusions en indemnité doivent être rejetées, ainsi que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
158 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Cependant, conformément à l’article 135 du règlement de procédure, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut, d’une part, décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre, et, d’autre part, condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance.
159 En l’espèce, compte tenu de l’absence de réponse explicite à la réclamation de la requérante dans le délai de quatre mois suivant cette réclamation, il apparaît approprié de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) DF et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.
Porchia
Madise
Nihoul
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
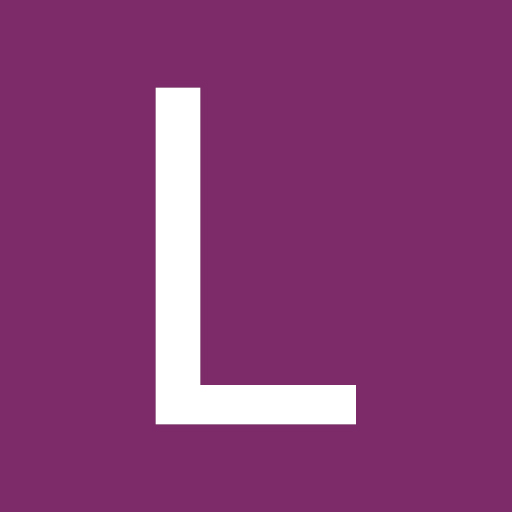
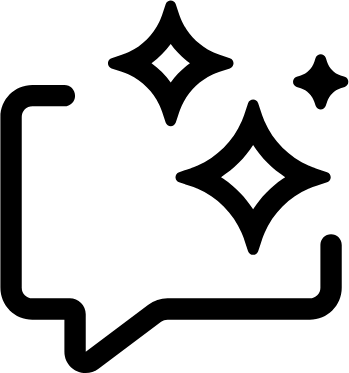 LEXI - AI Legal Assistant
LEXI - AI Legal Assistant