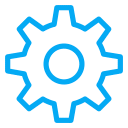Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er août 2025. Commission européenne contre Royaume d'Espagne.
• 62024CJ0070 • ECLI:EU:C:2025:615
- Inbound citations: 0
- •
- Cited paragraphs: 0
- •
- Outbound citations: 76
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
1 er août 2025 ( * )
« Manquement d’État – Article 258 TFUE – Équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants – Directive (UE) 2019/1158 – Article 20, paragraphe 1 – Absence de transposition et de communication des mesures de transposition – Article 260, paragraphe 3, TFUE – Demande de condamnation au paiement d’une somme forfaitaire et d’une astreinte journalière – Critères d’établissement du montant de la sanction »
Dans l’affaire C‑70/24,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 et de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, introduit le 30 janvier 2024,
Commission européenne, représentée par M mes I. Galindo Martín et E. Schmidt, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne, représenté par M me A. Pérez-Zurita Gutiérrez, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Kumin, président de chambre, M. F. Biltgen (rapporteur), président de la première chambre, et M me I. Ziemele, juge,
avocat général : M me J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour :
– de déclarer que, en ayant omis d’adopter toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil (JO 2019, L 188, p. 79), ou, en tout état de cause, en ayant omis de les communiquer à la Commission, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2019/1158 ;
– de condamner le Royaume d’Espagne à verser à la Commission une somme forfaitaire correspondant au plus élevé des deux montants suivants :
– un montant journalier de 9 760 euros multiplié par le nombre de jours de persistance de l’infraction intervenus entre le jour suivant l’expiration du délai de transposition de la directive 2019/1158 fixé à l’article 20, paragraphe 1, de celle-ci et la date à laquelle le Royaume d’Espagne met fin à l’infraction ou, à défaut de régularisation, le jour du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire au titre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE ;
– une somme forfaitaire minimale de 6 832 000 euros ;
– de déclarer que, si le manquement constaté au premier tiret persiste jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire, le Royaume d’Espagne est condamné à verser à la Commission une astreinte journalière d’un montant de 43 920 euros à compter de la date de cet arrêt jusqu’à ce que cet État membre se conforme à l’obligation qui lui incombe, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2019/1158, de notifier les mesures de transposition de cette directive, et
– de condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.
Le cadre juridique
La directive 2019/1158
2 Les considérants 6, 16, 34 et 41 de la directive 2019/1158 énoncent :
« (6) Les politiques relatives à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée devraient contribuer à la réalisation de l’égalité des sexes en encourageant la participation des femmes au marché du travail, le partage des responsabilités familiales à part égales entre les hommes et les femmes et la réduction des écarts de revenus et de salaire entre les hommes et les femmes. [...]
[...]
(16) La présente directive fixe des exigences minimales en matière de congé de paternité, de congé parental et de congé d’aidant, ainsi qu’en matière de formules souples de travail pour les travailleurs qui sont parents ou les aidants. En facilitant la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale pour ces parents et aidants, la présente directive devrait contribuer aux objectifs définis par le traité en matière d’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et d’égalité de traitement sur le lieu de travail, ainsi qu’en ce qui concerne la promotion d’un niveau d’emploi élevé dans l’Union [européenne].
[...]
(34) Afin d’encourager les travailleurs qui sont parents et les aidants à rester dans la population active, ces travailleurs devraient être en mesure d’adapter leurs horaires de travail à leurs besoins et préférences personnels. À cette fin, et pour répondre aux besoins des travailleurs, ils ont le droit de demander des formules souples de travail afin d’aménager leurs régimes de travail, y compris, dans la mesure du possible, par le recours au travail à distance, à des horaires de travail souples ou à une réduction du temps de travail, dans le but de s’occuper de leurs proches.
[...]
(41) Les travailleurs qui exercent leur droit à prendre un congé ou à demander des formules souples de travail au titre de la présente directive devraient être protégés contre le licenciement et contre toute action préparatoire en vue d’un possible licenciement au motif qu’ils ont demandé un tel congé, l’ont pris ou ont exercé leur droit de demander de telles formules souples de travail, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, notamment son arrêt [du 11 octobre 2007, Paquay (C‑460/06, EU:C:2007:601)]. Des travailleurs qui considèrent qu’ils ont été licenciés au motif qu’ils ont exercé de tels droits devraient être en mesure de demander à l’employeur de justifier dûment le licenciement. Lorsqu’un travailleur a demandé ou pris un congé de paternité, un congé parental ou un congé d’aidant tels qu’ils sont visés dans la présente directive, l’employeur devrait fournir les motifs du licenciement par écrit. »
3 L’article 1 er de cette directive, intitulé « Objet », prévoit :
« La présente directive fixe des exigences minimales conçues pour parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les opportunités sur le marché du travail et le traitement au travail, en facilitant la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale pour les travailleurs qui sont parents ou les aidants.
[...] »
4 L’article 2 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », énonce :
« La présente directive s’applique à tous les travailleurs, hommes et femmes, qui ont un contrat de travail ou une relation de travail au sens de la législation, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans chaque État membre, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice. »
5 Aux termes de l’article 5 de la même directive, intitulé « Congé parental » :
« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que chaque travailleur ait un droit individuel à un congé parental de quatre mois, à prendre avant que l’enfant n’atteigne un âge déterminé pouvant aller jusqu’à huit ans, à définir par chaque État membre ou par les conventions collectives. [...]
2. Les États membres font en sorte que deux mois de congé parental ne puissent pas être transférés.
[...] »
6 L’article 8 de la directive 2019/1158, intitulé « Rémunération ou allocation », dispose :
« 1. Dans le respect des circonstances nationales, telles que la législation, les conventions collectives ou la pratique nationales, et compte tenu des pouvoirs délégués aux partenaires sociaux, les États membres font en sorte que les travailleurs qui exercent leur droit au congé prévu à l’article 4, paragraphe 1, ou à l’article 5, paragraphe 2, reçoivent une rémunération ou une allocation conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
[...]
3. En ce qui concerne le congé parental visé à l’article 5, paragraphe 2, cette rémunération ou allocation est définie par l’État membre ou les partenaires sociaux et elle est fixée de manière à faciliter la prise du congé parental par les deux parents. »
7 L’article 9 de cette directive prévoit :
« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs dont les enfants ont jusqu’à un âge défini, qui ne peut être inférieur à huit ans, ainsi que les aidants, aient le droit de demander des formules souples de travail dans le but de s’occuper de membres de leur famille. La durée de ces formules souples de travail peut faire l’objet d’une limitation raisonnable.
2. Les employeurs examinent les demandes de formules souples de travail visées au paragraphe 1 et y répondent dans un délai raisonnable, en tenant compte à la fois de leurs propres besoins et de ceux des travailleurs. Les employeurs justifient tout refus d’une telle demande ou tout report de ces formules.
3. Lorsque les formules souples de travail visées au paragraphe 1 sont d’une durée limitée, le travailleur a le droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période convenue. Le travailleur a aussi le droit de demander à revenir au régime de travail de départ avant la fin de la période convenue, dès lors qu’un changement de circonstances le justifie. L’employeur examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de départ et y répond, en tenant compte à la fois de ses propres besoins et de ceux du travailleur.
4. Les États membres peuvent subordonner le droit de demander des formules souples de travail à des périodes de travail ou à une exigence d’ancienneté, qui ne doivent pas dépasser six mois. En cas de contrats à durée déterminée successifs, au sens de la directive 1999/70/CE [du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43)], avec un même employeur, la somme de ces contrats est prise en considération aux fins du calcul de la période de référence. »
8 L’article 12 de la directive 2019/1158, relatif à la protection contre le licenciement et à la charge de la preuve, dispose :
« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le licenciement de travailleurs et toutes mesures préparatoires en vue d’un licenciement au motif qu’ils ont demandé ou ont pris un congé prévu aux articles 4, 5 et 6 ou au motif qu’ils ont exercé le droit de demander une formule souple de travail visée à l’article 9.
2. Les travailleurs qui considèrent qu’ils ont été licenciés au motif qu’ils ont demandé ou ont pris un congé prévu aux articles 4, 5 et 6 ou au motif qu’ils ont exercé le droit de demander une formule souple de travail visée à l’article 9 peuvent demander à leur employeur de leur fournir les motifs dûment étayés de leur licenciement. En ce qui concerne le licenciement d’un travailleur qui a demandé ou a pris un congé prévu à l’article 4, 5 ou 6, l’employeur fournit les motifs du licenciement par écrit.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque les travailleurs qui considèrent qu’ils ont été licenciés au motif qu’ils ont demandé ou pris un congé prévu aux articles 4, 5 et 6 établissent, devant une juridiction ou une autre autorité compétente, des faits laissant présumer qu’ils ont été licenciés pour de tels motifs, il incombe à l’employeur de prouver que le licenciement était fondé sur d’autres motifs.
[...] »
9 L’article 20 de cette directive prévoit :
« 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 2 août 2022. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, pour la rémunération ou l’allocation correspondant aux deux dernières semaines de congé parental comme prévu à l’article 8, paragraphe 3, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 2 août 2024. Ils en informent immédiatement la Commission.
3. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans les domaines régis par la présente directive.
[...]
6. Aux fins du respect des articles 4, 5, 6 et 8 de la présente directive et de la directive 92/85/CEE [du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO 1992, L 348, p. 1)], les États membres peuvent tenir compte de toute période d’absence du travail pour raison familiale, en particulier le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental et le congé d’aidant, prévu au niveau national, et de toute rémunération ou allocation versée à ce titre, allant au-delà des normes minimales prévues par la présente directive ou la directive 92/85/CEE, pour autant que les exigences minimales relatives à ces congés soient respectées et qu’il n’y ait pas de régression du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines régis par ces directives.
[...] »
La communication de 2023
10 La communication de la Commission 2023/C 2/01, intitulée « Sanctions financières dans les procédures d’infraction » (JO 2023, C 2, p. 1, ci‑après la « communication de 2023 »), prévoit, à ses points 3 et 4, les règles relatives respectivement à l’« astreinte » et à la « somme forfaitaire ».
11 Le point 3.2 de cette communication, relatif à l’application du coefficient de gravité dans le cadre du calcul de l’astreinte journalière, dispose :
« Une infraction relative à [...] l’absence de communication de mesures de transposition d’une directive adoptée dans le cadre d’une procédure législative est toujours considérée comme grave. Afin d’adapter le montant de la sanction aux circonstances particulières de l’espèce, la Commission détermine le coefficient de gravité sur la base de deux paramètres : l’importance des règles de l’Union enfreintes ou non transposées et les effets de l’infraction sur des intérêts d’ordre général ou particulier.
[...] »
12 Le point 3.2.2 de ladite communication énonce :
« Pour les recours introduits en vertu de l’article 260, paragraphe 3, [TFUE], la Commission applique systématiquement un coefficient de gravité de 10 en cas de manquement complet à l’obligation de communiquer les mesures de transposition. Dans une Union fondée sur le respect de l’état de droit, toutes les directives législatives doivent être considérées comme étant d’une importance égale et doivent être intégralement transposées par les États membres dans les délais qui y sont fixés.
En cas de manquement partiel à l’obligation de communiquer les mesures de transposition, l’importance de la lacune de transposition doit être prise en considération lors de la fixation d’un coefficient de gravité qui sera inférieur à 10. En outre, les effets de l’infraction sur des intérêts d’ordre général ou particulier pourraient être pris en compte [...] »
13 Aux termes du point 3.3 de la même communication, intitulé « Application du coefficient de durée » :
« [...]
Le coefficient de durée est exprimé sous la forme d’un multiplicateur compris entre 1 et 3. Il est calculé à un taux de 0,10 par mois à compter de la date du premier arrêt ou du jour suivant l’expiration du délai de transposition de la directive en question.
[...] »
14 Le point 3.4 de la communication de 2023, intitulé « Capacité de paiement de l’État membre », prévoit :
« [...]
Le niveau de sanction requis pour produire un effet dissuasif variera en fonction de la capacité de paiement des États membres. Cet effet dissuasif se reflète dans le facteur n. Il se définit comme une moyenne géométrique pondérée du produit intérieur brut (PIB) de l’État membre concerné par rapport à la moyenne des PIB des États membres, dont le poids est égal à deux, et de la population de l’État membre concerné par rapport à la moyenne de la population des États membres, dont le poids est égal à un. Cela représente la capacité de paiement de l’État membre concerné par rapport à la capacité de paiement des autres États membres :
[...]
La Commission a [...] décidé de revoir sa méthode de calcul du facteur n, qui repose désormais principalement sur le PIB des États membres et, à titre subsidiaire, sur leur population en tant que critère démographique permettant de maintenir un écart raisonnable entre les différents États membres. La prise en compte de la population des États membres pour un tiers du calcul du facteur n réduit dans une mesure raisonnable la variation des facteurs n des États membres en comparaison avec un calcul fondé uniquement sur le PIB des États membres. Elle ajoute également un élément de stabilité dans le calcul du facteur n, étant donné qu’il est peu probable que la population varie de manière significative sur une base annuelle. En revanche, le PIB d’un État membre est susceptible de connaître des fluctuations annuelles plus importantes, en particulier en période de crise économique. Dans le même temps, étant donné que le PIB de l’État membre représente encore deux tiers du calcul, il demeure le facteur prédominant aux fins de l’évaluation de sa capacité de paiement.
[...] »
15 Le point 4.2 de cette communication précise la méthode de calcul de la somme forfaitaire comme suit :
« La somme forfaitaire est calculée d’une manière globalement similaire à la méthode de calcul de l’astreinte, à savoir :
– en multipliant un forfait par un coefficient de gravité ;
– en multipliant le résultat par le facteur n ;
– en multipliant le résultat par le nombre de jours de persistance de l’infraction [...]
[...] »
16 Le point 4.2.1 de ladite communication prévoit :
« Aux fins du calcul de la somme forfaitaire, le montant journalier doit être multiplié par le nombre de jours de persistance de l’infraction. Ce nombre de jours est défini comme suit :
[...]
– pour les recours introduits en vertu de l’article 260, paragraphe 3, [TFUE], il s’agit du nombre de jours compris entre le jour suivant l’expiration du délai de transposition fixé dans la directive concernée et la date à laquelle l’infraction prend fin ou, à défaut de régularisation, la date du prononcé de l’arrêt au titre de l’article 260 [TFUE].
[...] »
17 Aux termes du point 4.2.2 de la même communication :
« Pour le calcul de la somme forfaitaire, la Commission applique le même coefficient de gravité et le même facteur n fixe que pour le calcul de l’astreinte [...]
Le forfait de la somme forfaitaire est inférieur à celui des astreintes. [...]
Le forfait applicable à la somme forfaitaire est fixé au point 2 de l’annexe I.
[...] »
18 L’annexe I de la communication de 2023, intitulée « Données servant au calcul des sanctions financières proposées à la Cour », prévoit, à son point 1, que le forfait de l’astreinte visé au point 3.1 de cette communication est fixé à 3 000 euros par jour, à son point 2, que le forfait de la somme forfaitaire mentionné au point 4.2.2 de ladite communication est fixé à 1 000 euros par jour, ce qui correspond à un tiers du forfait de l’astreinte, et, à son point 3, que le facteur « n » pour le Royaume d’Espagne est fixé à 2,44. Au point 5 de cette annexe I, il est précisé que la somme forfaitaire minimale fixée pour cet État membre s’élève à 6 832 000 euros.
La procédure précontentieuse
19 N’ayant reçu du Royaume d’Espagne aucune notification concernant l’adoption des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2019/1158, la Commission a adressé, le 21 septembre 2022, une lettre de mise en demeure à cet État membre. Dans sa réponse du 18 novembre 2022, le Royaume d’Espagne a informé la Commission que la transposition de cette directive dans le droit national prendrait la forme d’une loi et d’un décret royal et qu’elle serait informée au plus tôt, de manière précise et détaillée, des dispositions de cette loi ainsi que des autres dispositions nationales ayant déjà transposé certaines dispositions de ladite directive.
20 Le 19 avril 2023, n’ayant pas reçu de notification sur la transposition de la directive 2019/1158, la Commission a adressé un avis motivé au Royaume d’Espagne, par lequel elle l’invitait à adopter les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de la directive 2019/1158 dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
21 La réponse du Royaume d’Espagne, du 6 juin 2023, comprenait un tableau de correspondance entre les articles de la directive 2019/1158 et les dispositions nationales ainsi qu’un rapport du ministère espagnol du Travail et de l’Économie sociale qui indiquait qu’un projet de loi sur les familles visant à assurer la transposition de cette directive avait été abandonné à la suite de la dissolution du Parlement espagnol. Les 28 juillet, 31 juillet et 7 septembre 2023, le Royaume d’Espagne a transmis à la Commission de nouvelles informations sur la transposition de ladite directive.
22 À la lumière de ces informations et considérant que cet État membre n’avait pas encore adopté toutes les mesures nécessaires pour transposer, dans le droit interne, l’article 8, paragraphe 3, et les articles 9 et 12 de la directive 2019/1158, la Commission a décidé, le 16 novembre 2023, de saisir la Cour du présent recours.
23 Le 21 décembre 2023, le Royaume d’Espagne a communiqué à la Commission le Real Decreto-ley 7/2023, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo [décret-loi royal 7/2023, portant adoptions de mesures urgentes pour achever la transposition de la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, relative à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, et pour simplifier et améliorer le niveau d’assistance aux prestations de chômage], du 19 décembre 2023 (BOE n o 303, du 20 décembre 2023, ci-après le « décret-loi royal 7/2023 »), ainsi que deux nouveaux tableaux de correspondance entre les articles de la directive 2019/1158 et les dispositions nationales.
24 Le 10 janvier 2024, le Congreso de los Diputados (Congrès des députés, Espagne) a refusé de valider le décret‑loi royal 7/2023.
25 Le 22 janvier 2024, le Royaume d’Espagne a communiqué à la Commission un rapport, daté du 19 janvier 2024, sur l’état de la transposition de la directive 2019/1158 à la suite de l’abrogation du décret-loi royal 7/2023 et a indiqué que le gouvernement espagnol avait l’intention d’introduire, dans un projet de loi relatif au budget général de l’État pour l’année 2024, des mesures complétant la transposition de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 9 de la directive 2019/1158.
26 Le 30 janvier 2024, la Commission a introduit le présent recours.
Les développements intervenus au cours de la procédure devant la Cour
27 Dans son mémoire en réplique du 27 mai 2024, la Commission a indiqué que le Royaume d’Espagne l’avait informée, le même jour, de l’adoption du Real Decreto-ley 2/2024, por el que se adoptan medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, y para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo [décret‑loi royal 2/2024, portant adoption de mesures urgentes pour la simplification et l’amélioration du niveau d’assistance de la protection contre le chômage et pour compléter la transposition de la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil], du 21 mai 2024 (BOE n o 124, du 22 mai 2024, ci-après le « décret-loi royal 2/2024 »), au regard, en particulier, de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 9 de la directive 2019/1158.
28 Le décret-loi royal 2/2024 a été validé par le Parlement espagnol le 20 juin 2024.
29 Le 7 juillet 2024, dans ses observations sur les nouvelles mesures de transposition de la directive 2019/1158 issues du décret-loi royal 2/2024, la Commission a estimé que cet acte ne mettait pas fin à l’infraction en cause et a maintenu ses conclusions présentées dans la requête.
Sur le recours
Sur le manquement au titre de l’article 258 TFUE
Argumentation des parties
30 La Commission rappelle que, aux termes de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, les directives lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Ainsi, les États membres sont tenus d’adopter les dispositions nécessaires pour la transposition des directives dans leur système juridique national, dans les délais prescrits dans ces directives, et de lui communiquer immédiatement ces dispositions.
31 Cette institution précise que l’existence d’un manquement à ces obligations doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé qu’elle lui a adressé.
32 Or, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé ainsi qu’à la date de l’introduction du présent recours, le Royaume d’Espagne n’aurait pas pris toutes les mesures nécessaires pour transposer l’article 8, paragraphe 3, et les articles 9 et 12 de la directive 2019/1158 dans son droit national ou, en tout état de cause, ne les lui aurait pas communiquées.
33 La Commission relève que le Royaume d’Espagne ne conteste pas l’infraction reprochée relative à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2019/1158 pour les mères biologiques dont la relation de travail relève du droit du travail, ainsi qu’à l’article 9 de celle-ci pour les agents publics dont la relation de travail relève du droit administratif.
34 Le décret-loi royal°7/2023, qui devait procéder à la transposition de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 9 de la directive 2019/1158, n’ayant pas été validé par le Congrès des députés, le Royaume d’Espagne aurait informé la Commission de son intention d’introduire, dans un projet de loi relatif au budget général de l’État pour l’année 2024 dont l’adoption était prévue pour le mois de mars ou le mois d’avril 2024, des mesures ayant pour objet la transposition de ces dispositions.
35 En ce qui concerne la transposition de l’article 12 de la directive 2019/1158 et l’argument du Royaume d’Espagne selon lequel cet article ne s’applique pas aux agents publics dont la relation de travail relève du droit administratif, la Commission, d’une part, rappelle la jurisprudence aux termes de laquelle ce n’est que lorsque la transposition d’une directive n’a pas d’objet pour des motifs géographiques que cette transposition ne s’impose pas, et, d’autre part, estime que cet article 12 s’applique également aux agents publics dont la relation de travail relève du droit administratif, même si, les concernant, la cessation de leur relation de travail n’est pas qualifiée de « licenciement » par le droit national. Toute cessation de la relation de travail intervenue sans le consentement du travailleur devrait être couverte par la notion de « licenciement » et les agents publics devraient être protégés, ainsi que le prévoirait la directive 2019/1158, contre l’invocation par l’administration, en ce qui concerne, respectivement, les fonctionnaires et les agents non titulaires, de motifs disciplinaires ou de raisons d’ordre organisationnel qui ne seraient pas les véritables motifs de ladite cessation. La Commission considère, en conséquence, que le Royaume d’Espagne est tenu de transposer dans son droit interne l’article 12 de cette directive.
36 La Commission soutient que le Royaume d’Espagne n’a, en tout état de cause, pas notifié, en tant que mesures de transposition de la directive 2019/1158, les dispositions du Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (décret royal législatif 5/2015, portant refonte de la loi sur le statut de base des agents publics), du 30 octobre 2015 (BOE n° 261, du 31 octobre 2015), qui établissent les listes exhaustives des causes précises et objectives de résiliation d’une relation de travail ainsi que les règles relatives à la procédure de résiliation. En outre, selon la Commission, ces dispositions ne semblent pas contenir une référence à cette directive contrairement à ce qu’exige l’article 20, paragraphe 3, de celle‑ci. Un acte positif de transposition de ladite directive serait en tout état de cause nécessaire.
37 Le Royaume d’Espagne soutient que, selon la Commission, le manquement en cause n’est que partiel, dans la mesure où, d’une part, seuls 3 des 22 articles de la directive 2019/1158 n’auraient pas été pleinement transposés dans le droit national et où, d’autre part, ces trois articles auraient été transposés pour une partie importante des citoyens concernés, au moyen de l’adoption du Real Decreto-ley 5/2023, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad ; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea (décret-loi royal 5/2023, portant adoption et prorogation de certaines mesures visant à remédier aux conséquences économiques et sociales de la guerre en Ukraine, à soutenir la reconstruction de l’île de La Palma et à remédier à d’autres situations de vulnérabilité ; de certaines mesures de transposition des directives de l’Union européenne relatives aux modifications structurelles des sociétés commerciales et à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants; et de certaines mesures de mise en œuvre et d’application du droit de l’Union européenne), du 28 juin 2023 (BOE n o 154, du 29 juin 2023, ci-après le « décret-loi royal 5/2023 »), qui leur aurait reconnu des droits en matière de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.
38 Concernant la transposition de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2019/1158, le Royaume d’Espagne soutient que la législation espagnole reconnaît la pleine égalité des deux parents dans la jouissance des congés visant à concilier la vie professionnelle et la vie familiale des travailleurs, afin de promouvoir la coresponsabilité et l’égalité effective entre les femmes et les hommes, et que, étant plus favorable que la législation de l’Union, il y a lieu de considérer que cette législation est conforme aux objectifs de cette directive.
39 En ce qui concerne la situation de la mère biologique dont la relation de travail est régie par le droit du travail, les exigences de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2019/1158 seraient partiellement satisfaites par le droit national. D’une part, le congé de seize semaines pour chaque parent, prévu par le droit national, fournirait un cadre juridique approprié pour inciter les hommes à assumer leur part de responsabilité en matière de soins, permettant ainsi d’atteindre un équilibre entre les hommes et les femmes en vue de briser les stéréotypes et d’éviter l’éloignement des femmes du monde professionnel. Ce congé serait pleinement conforme aux exigences de l’article 8, paragraphe 3, de ladite directive pour le parent autre que la mère biologique et partiellement conforme à cette disposition en ce qui concerne la mère biologique pendant les deux semaines qui dépassent les quatorze semaines de congé de maternité. D’autre part, le congé pour soins au nourrisson, qui est rémunéré par l’employeur et qui donne droit à une heure d’absence par jour jusqu’à ce que le nourrisson atteigne l’âge de neuf mois, constituerait une transposition partielle de ladite disposition dans la mesure où il est possible, si la convention collective applicable le prévoit, de cumuler ces heures d’absence et de les transformer en jours ouvrables complets équivalant à au moins quatorze jours de travail rémunérés. De nombreuses conventions collectives prévoiraient désormais un tel cumul, lequel bénéficie donc à un grand nombre de travailleurs couverts par de telles conventions collectives.
40 Quant à l’article 9 de la directive 2019/1158, il aurait été transposé dans le droit espagnol en ce qui concerne les travailleurs dont la relation de travail est régie par le droit du travail, y compris le personnel contractuel de l’administration, par le décret-loi royal 5/2023, ce qu’admettrait la Commission pour laquelle l’infraction ne concernerait que les aidants qui sont des agents publics soumis au droit administratif.
41 En ce qui concerne l’article 12 de la directive 2019/1158, le Royaume d’Espagne considère qu’il a été intégralement transposé par le décret-loi royal 5/2023, mais qu’il n’est applicable ni aux fonctionnaires ni aux agents non titulaires compte tenu du régime qui leur est applicable en vertu du droit national, rendant ainsi inutile sa transposition les concernant.
42 Contrairement à ce que fait valoir la Commission, dans le cas des fonctionnaires et des agents non titulaires, la cessation de la relation de travail ne serait pas la conséquence d’une décision de l’administration visant à mettre fin à cette relation, en tant que manifestation de l’exercice d’un pouvoir ou d’une compétence, dans la mesure où l’administration se limite en réalité à constater ou à formaliser la cessation de la relation de travail causée par des circonstances objectives.
43 En réponse à l’argument selon lequel, s’agissant de deux motifs de cessation de la relation de travail, à savoir la sanction disciplinaire et la suppression de poste d’un agent non titulaire, les objectifs de la directive 2019/1158 pourraient être méconnus, le Royaume d’Espagne rappelle, d’une part, qu’aucun de ces motifs ne constitue un licenciement et qu’ils ne relèvent donc pas du champ d’application de l’article 12 de cette directive, et, d’autre part, que la réglementation nationale applicable protège suffisamment les droits des personnes potentiellement affectées par lesdites sanction disciplinaire et suppression de poste.
44 Par ailleurs, la suppression de poste d’un agent non titulaire résulterait d’une décision purement et exclusivement organisationnelle qui n’aurait pas de lien avec la situation particulière de l’agent occupant le poste et qui serait potentiellement préjudiciable à l’unité administrative concernée. La sanction de révocation infligée dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l’administration exercé à l’égard du fonctionnaire n’entraînerait pas, en tant que telle, la cessation de la relation de travail. Cette cessation, qui résulterait d’une décision juridictionnelle et non d’une décision administrative, ne deviendrait définitive qu’à l’issue de l’épuisement des voies de recours juridictionnelles. Par ailleurs, les garanties procédurales qui entourent l’exercice du pouvoir disciplinaire par l’administration, telles que prévues par le droit espagnol, seraient beaucoup plus étendues que celles exigées par l’article 12 de la directive 2019/1158, de sorte que les règles de droit espagnol en la matière ne compromettraient en rien les objectifs de cette directive.
45 Par conséquent, la directive 2019/1158 serait pleinement transposée dans le droit espagnol et les dispositions de droit interne adoptées dans les domaines régis par cette directive auraient été dûment communiquées. En tout état de cause, s’agissant des doutes quant à l’applicabilité de l’article 12 de ladite directive aux fonctionnaires et aux agents non titulaires, le Royaume d’Espagne rappelle que, dans le cadre de la procédure juridictionnelle engagée en application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, il n’appartient pas à la Cour d’examiner si les mesures nationales assurent une transposition correcte des dispositions de la directive en cause.
46 Dans son mémoire en réplique, la Commission observe que le Royaume d’Espagne était tenu de transposer l’article 12 de la directive 2019/1158 en ce qui concerne les travailleurs du secteur public dont la relation de travail relève du droit administratif, ce que cet État membre admettrait ne pas avoir fait. Il conviendrait non pas de déterminer si les mesures nationales adoptées assurent une transposition correcte de cet article en ce qui concerne le groupe de travailleurs auquel elles s’appliquent, mais de savoir si cet État membre était tenu d’adopter des mesures à l’égard d’autres travailleurs.
47 Quant à la transposition de l’article 8, paragraphe 3, de cette directive en ce qui concerne les mères biologiques, et de l’article 9 de ladite directive en ce qui concerne les agents publics dont la relation de travail relève du droit administratif, la Commission indique que le Royaume d’Espagne l’avait informée, le 27 mai 2024, de l’adoption du décret-loi royal 2/2024, qui, à cette date, n’avait pas encore été validé par le Parlement espagnol.
48 Dans ses observations datées du 7 juillet 2024, mentionnées au point 29 du présent arrêt, la Commission a estimé que le décret-loi royal 2/2024, validé par le Parlement espagnol en date du 20 juin 2024, ne mettait pas fin à l’infraction en cause en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 3, et l’article 9 de la directive 2019/1158.
49 En effet, en ce qui concerne la transposition de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2019/1158, la Commission soutient non seulement que la possibilité de cumuler des heures d’allaitement en journées entières de travail ne semble pas donner droit à ce que le travailleur bénéficie de trois semaines complètes de congé, mais également que le Royaume d’Espagne admet que le décret-loi royal 2/2024 ne transpose pas complètement cette disposition, puisque les mères biologiques ne se voient toujours pas garantir le droit à un congé parental rémunéré de deux mois qui aurait dû leur être reconnu au plus tard le 2 août 2022, à l’exception des deux dernières semaines de ce congé pour lesquelles le délai de transposition était fixé au 2 août 2024 en vertu de l’article 20, paragraphe 2, de ladite directive.
50 En ce qui concerne la transposition de l’article 9 de la directive 2019/1158, la Commission soutient que le décret-loi royal 2/2024 n’établit pas lui-même les formules souples de travail pour les travailleurs qui sont parents ou les aidants, mais se limite à poser la base juridique légale aux fins de l’adoption de telles formules par les administrations publiques en vue d’assurer la transposition de cet article.
51 En ce qui concerne la transposition de l’article 12 de la directive 2019/1158, la Commission indique que le décret-loi royal 2/2024 ne contient pas de mesures se rapportant à cet article.
52 Dans son mémoire en duplique, le Royaume d’Espagne admet la transposition partielle de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2019/1158.
53 Pour ce qui est de la transposition de l’article 9 de la directive 2019/1158, le Royaume d’Espagne considère que l’objet d’une mesure de transposition est de reconnaître, au moyen d’une règle de droit national, les droits déjà établis par une directive. Le législateur espagnol aurait ainsi imposé à toutes les administrations publiques l’obligation d’adopter, dans le cadre de leurs relations juridiques en tant qu’employeurs, des mesures permettant des horaires de travail souples et, par conséquent, aurait permis à tout employé du secteur public de se prévaloir du bénéfice de telles mesures. Le droit espagnol irait même plus loin que ce que prévoit cet article, en prolongeant le droit de demander des formules souples de travail jusqu’au douzième anniversaire de l’enfant, et non seulement jusqu’au huitième anniversaire de celui-ci, comme le prévoit la directive 2019/1158.
54 Concernant la transposition de l’article 12 de la directive 2019/1158, le Royaume d’Espagne soutient, en premier lieu, que cet article est relatif au licenciement et ne concerne donc pas les employés du secteur public qui sont inamovibles et dont la relation de travail ne pourrait cesser par la seule volonté de l’administration qui les emploie.
55 En deuxième lieu, le Royaume d’Espagne rappelle que la notion de « licenciement », au sens de la jurisprudence de la Cour, est définie comme la résiliation du contrat de travail par l’employeur, non souhaitée par le travailleur. L’article 12 de la directive 2019/1158 viserait à protéger le travailleur contre le licenciement prononcé au motif que le travailleur a pris un congé visant à concilier la vie professionnelle et la vie familiale de celui-ci. Toutefois, dans le cas des fonctionnaires ou des agents non titulaires, la cessation de la relation de travail ne pourrait résulter de l’exercice d’un pouvoir ou d’une prérogative. Par conséquent, l’administration publique n’ayant pas le pouvoir de mettre fin unilatéralement à la relation de service des fonctionnaires ou des agents non titulaires, l’article 12 de ladite directive ne leur serait pas applicable.
56 Ainsi, le Royaume d’Espagne soutient que l’absence de transposition de l’article 12 de la directive 2019/1158, en ce qui concerne les fonctionnaires et les agents non titulaires, n’est pas manifeste et n’est donc pas comparable au manquement constaté dans l’arrêt du 8 juillet 2019, Commission/Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE – Réseaux à haut débit) (C‑543/17, EU:C:2019:573). En outre, cet État membre aurait communiqué les mesures de transposition de l’article 12 de ladite directive et exposé les raisons pour lesquelles cet article ne serait pas applicable aux travailleurs ne relevant pas du champ d’application du Real Decreto Legislativo 2/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (décret royal législatif 2/2015, portant refonte sur le statut des travailleurs), du 23 octobre 2015 (BOE n° 255, du 24 octobre 2015).
Appréciation de la Cour
57 Aux termes de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2019/1158, les États membres devaient, au plus tard le 2 août 2022, mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci et en informer immédiatement la Commission. En outre, en vertu de l’article 20, paragraphe 4, de cette directive, les États membres doivent communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans les domaines régis par ladite directive.
58 Conformément à une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé, les changements intervenus par la suite ne pouvant être pris en compte par la Cour [arrêt du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte) , C‑149/23, EU:C:2025:145, point 45 et jurisprudence citée].
59 En l’espèce, par l’avis motivé du 19 avril 2023, la Commission a invité le Royaume d’Espagne à se conformer à ses obligations visées dans cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis.
60 Or, le Royaume d’Espagne a admis, s’agissant de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 9 de la directive 2019/1158, que, à l’expiration de ce délai, il n’avait pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces dispositions et, partant, qu’il n’avait pas non plus communiqué celles-ci à la Commission à l’expiration dudit délai.
61 En ce qui concerne la transposition de l’article 12 de la directive 2019/1158, la Cour a itérativement jugé qu’il convient de retenir une interprétation de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, qui, d’une part, permet à la fois de garantir les prérogatives détenues par la Commission en vue d’assurer l’application effective du droit de l’Union et de protéger les droits de la défense ainsi que la position procédurale dont bénéficient les États membres au titre de l’application combinée de l’article 258 et de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, et, d’autre part, met la Cour en position de pouvoir exercer sa fonction juridictionnelle [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2019, Commission/Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE – Réseaux à haut débit) , C‑543/17, EU:C:2019:573, point 58].
62 Afin de satisfaire à l’obligation de sécurité juridique et d’assurer la transposition de l’intégralité des dispositions d’une directive sur l’ensemble du territoire concerné, les États membres sont tenus d’indiquer, pour chaque disposition de ladite directive, la ou les dispositions nationales assurant sa transposition. Une fois cette communication intervenue, il incombe à la Commission d’établir, en vue de solliciter l’infliction à l’État membre concerné d’une sanction pécuniaire prévue à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, que certaines mesures de transposition font manifestement défaut ou ne couvrent pas l’ensemble du territoire de cet État membre, étant entendu qu’il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre de la procédure juridictionnelle engagée en application de cette disposition, d’examiner si les mesures nationales communiquées à la Commission assurent une transposition correcte des dispositions de la directive en cause [arrêt du 8 juillet 2019, Commission/Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE – Réseaux à haut débit) , C‑543/17, EU:C:2019:573, point 59].
63 En l’espèce, l’article 12 de la directive 2019/1158 n’a pas été transposé dans le droit espagnol pour une partie des travailleurs, à savoir les travailleurs du secteur public.
64 À cet égard, en ce qui concerne l’argument selon lequel cet article 12 ne serait pas applicable à ces travailleurs, qui seraient protégés contre la cessation unilatérale de leur relation de service par l’administration, il y a lieu de rappeler que l’inexistence dans un État membre déterminé d’une certaine activité visée par une directive ou, comme en l’espèce, l’inexistence dans cet État d’une certaine notion, ne saurait libérer ledit État de son obligation de prendre des mesures législatives, réglementaires et administratives afin d’assurer une transposition adéquate de l’ensemble des dispositions de cette directive. En effet, tant le principe de sécurité juridique que la nécessité de garantir la pleine application des directives, en droit et non seulement en fait, exigent que tous les États membres reprennent les prescriptions de la directive en cause dans un cadre légal clair, précis et transparent prévoyant des dispositions contraignantes dans le domaine concerné par celle-ci. Une telle obligation incombe aux États membres afin de prévenir toute modification de la situation existant à un moment donné dans ces États et en vue de garantir que tous les sujets de droit dans l’Union, en ce compris ceux des États membres dans lesquels une certaine activité ou, comme en l’espèce, une certaine notion visée par une directive n’existe pas, sachent avec clarté et précision quels sont, en toutes circonstances, leurs droits et obligations (voir, par analogie, arrêt du 14 janvier 2010, Commission/République tchèque , C‑343/08, EU:C:2010:14, points 39 à 41).
65 En tout état de cause, selon l’article 2 de la directive 2019/1158, relatif au champ d’application de celle‑ci, cette directive s’applique à tous les travailleurs, hommes et femmes, qui ont un contrat de travail ou une relation de travail, au sens de la législation, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans chaque État membre, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour. Il s’ensuit que, même si la notion de « licenciement » est inconnue du régime statutaire applicable aux travailleurs du secteur public, le Royaume d’Espagne était néanmoins tenu de transposer ladite directive ou, à tout le moins, de notifier les dispositions de droit interne qui leur sont applicables en tant que mesures de transposition de la même directive.
66 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, adopté l’ensemble des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2019/1158 et, partant, en n’ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 20, paragraphes 1 et 4, de cette directive.
Sur la demande présentée au titre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE
Argumentation des parties
67 La Commission soutient que la directive 2019/1158 a été adoptée selon la procédure législative ordinaire et relève donc du champ d’application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE. Ainsi, la méconnaissance par le Royaume d’Espagne des obligations prévues à l’article 20 de cette directive, y compris de celle de notifier les mesures de transposition de ladite directive constituerait un manquement relevant de cet article 260, paragraphe 3.
68 En conséquence, la Commission propose à la Cour de condamner le Royaume d’Espagne au paiement d’une somme forfaitaire et, en cas de persistance de l’infraction à la date du prononcé du présent arrêt, d’une astreinte au titre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE.
69 À cet effet, cette institution indique que la détermination du montant de la somme forfaitaire doit se fonder sur les critères fondamentaux que sont la gravité de l’infraction, sa durée et la nécessité d’assurer l’effet dissuasif de la sanction.
70 S’agissant, premièrement, de la gravité de l’infraction, la Commission précise que la communication de 2023 prévoit l’application systématique d’un coefficient de gravité de 10 en cas de manquement complet à l’obligation de communiquer les mesures de transposition d’une directive. Elle rappelle, à cet égard, que, en cas de manquement partiel à l’obligation de communiquer de telles mesures, l’importance du manquement devra être prise en compte pour déterminer un coefficient de gravité inférieur à 10.
71 Quant à l’importance de la directive 2019/1158, la Commission rappelle, en substance, l’objet et les objectifs de celle-ci. Elle soutient en outre que, en l’absence de transposition complète de cette directive, une partie des parents et des aidants qui travaillent en Espagne seront privés du bénéfice des dispositions de l’article 8, paragraphe 3, ainsi que des articles 9 et 12 de ladite directive, qui visent à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs, ce qui pénaliserait non seulement ces parents et ces aidants mais également les membres de leur famille ayant besoin d’aide, et nuirait donc à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et à l’égalité de traitement sur le lieu du travail.
72 Au vu de ces considérations, la Commission propose, en l’espèce, un coefficient de gravité de 4.
73 En ce qui concerne, deuxièmement, la durée de l’infraction, la Commission rappelle que la communication de 2023 prévoit l’application d’un coefficient de durée qui est calculé à un taux de 0,10 par mois à compter du jour suivant l’expiration du délai de transposition de la directive en question, à savoir, en l’occurrence, le 2 août 2022, jusqu’au jour où la Commission décide de saisir la Cour, à savoir, en l’espèce, le 16 novembre 2023. La durée de l’infraction en cause serait, par conséquent, de 15 mois et le coefficient de durée serait de 1,5.
74 Troisièmement, conformément au point 3 de l’annexe I de la communication de 2023, la Commission rappelle que le facteur « n » pour le Royaume d’Espagne est de 2,44.
75 Ainsi, la Commission propose à la Cour de calculer le montant de la somme forfaitaire à infliger au Royaume d’Espagne en multipliant le montant de base de la somme forfaitaire, fixé à 1 000 euros par jour pour tous les États membres, par le coefficient de gravité de 4 et par le facteur « n » de 2,44, ce qui correspondrait à la somme de 9 760 euros par jour de persistance de l’infraction en cause. Selon la Commission, le paiement de cette somme forfaitaire doit être imposé au Royaume d’Espagne à condition qu’elle soit supérieure à 6 832 000 euros, qui est le montant de la somme forfaitaire minimale fixée pour le Royaume d’Espagne aux termes du point 5 de l’annexe I de la communication de 2023.
76 La Commission demande également l’imposition d’une astreinte d’un montant de 43 920 euros par jour à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire, correspondant à la multiplication d’un forfait d’astreinte journalier, qui est fixé à 3 000 euros par la communication de 2023, par le coefficient de gravité de 4, le coefficient de durée de 1,5 et le facteur « n » de 2,44.
77 Le Royaume d’Espagne considère que les montants des sanctions proposés par la Commission sont manifestement disproportionnés au regard de la gravité du manquement en cause et qu’ils devraient être substantiellement réduits. En ce qui concerne le coefficient de gravité de 4 proposé par cette institution, cet État membre soutient que des coefficients de gravité de 1 ont été appliqués par la Commission précisément dans des cas de manquements résultant de la transposition partielle de trois articles seulement d’une directive, ce qui témoignerait, en l’espèce, de l’insuffisance de la motivation de la requête de la Commission à cet égard, au regard en particulier du principe de proportionnalité et des critères énoncés dans la communication de 2023.
78 En effet, en l’espèce, le manquement en cause concernerait seulement les articles 8 et 9 de la directive 2019/1158, et non l’article 12 de celle‑ci. S’agissant de ces articles 8 et 9, le manquement en cause ne serait que partiel, ces deux articles ayant été transposés pour une partie importante des citoyens concernés. Plus particulièrement, concernant la transposition de l’article 8, paragraphe 3, de cette directive, le congé parental de deux mois, dont les deux dernières semaines devaient faire l’objet d’une transposition dans le droit national au plus tard le 2 août 2024, serait déjà partiellement couvert par le congé de maternité à hauteur de deux semaines et par le congé pour soins au nourrisson, conformément à la convention collective applicable, pour au moins 14 jours ouvrables. Par ailleurs, aucune atteinte aux intérêts généraux et particuliers n’aurait été établie en l’espèce et les effets pratiques de l’absence de transposition complète de ladite directive seraient relativement limités, le droit espagnol étant particulièrement avancé en matière de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, puisqu’il garantit la pleine égalité entre les deux parents dans la jouissance des congés visant à assurer cette conciliation, ce qui irait au‑delà des exigences du droit de l’Union, les objectifs de la directive 2019/1158 n’étant donc pas menacés en Espagne.
79 Dans son mémoire en réplique, la Commission considère qu’elle aurait tenu compte des préjudices subis par les travailleurs concernés et leurs familles ainsi que de la proportion de la population affectée par l’infraction en cause. La part des citoyens concernés par l’absence de transposition complète de la directive 2019/1158 ne serait pas négligeable. En 2022, sur 13 850 800 travailleurs relevant du secteur privé, 6 300 900 seraient des femmes. Partant, même si l’article 8, paragraphe 3, de cette directive ne concernerait que les mères biologiques, ces données chiffrées feraient prendre la mesure de l’importance de la population affectée par l’absence de transposition complète de cette disposition. De même, s’agissant des articles 9 et 12 de ladite directive, la Commission relève que le secteur public compte pas moins de 3 526 200 travailleurs. Seuls 18,12 % des travailleurs relevant du secteur privé auraient pu cumuler les heures d’allaitement dans le cadre du congé pour soins au nourrisson. S’agissant des effets pratiques limités de l’absence de transposition complète de la directive 2019/1158, la Commission fait valoir que, à supposer que le droit espagnol soit particulièrement avancé en matière de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale des travailleurs et qu’il offre des garanties aux travailleurs du secteur public dont la relation de travail relève du droit administratif, ces éléments ne sont pas de nature à compenser l’absence de transposition complète de l’article 8, paragraphe 3, et des articles 9 et 12 de cette directive et n’atténuent pas la gravité d’un tel manquement.
80 La Commission indique examiner actuellement les conséquences de l’arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte) (C‑147/23, EU:C:2024:346), et les éventuelles modifications à apporter à la méthode utilisée pour déterminer la capacité de paiement des États membres, telle que définie dans la communication de 2023. Dans l’attente de cet examen, la Commission continuerait de jouer son rôle de gardienne des traités. Rappelant la large marge d’appréciation de la Cour pour déterminer le montant d’une sanction qu’elle estime approprié, la Commission réaffirme sa volonté de maintenir sa proposition quant au montant de la somme forfaitaire dont le calcul était fondé, antérieurement au prononcé de cet arrêt de la Cour, sur la méthode définie dans la communication de 2023.
81 La Commission ajoute, dans ses observations du 7 juillet 2024 mentionnées au point 29 du présent arrêt, que l’adoption du décret-loi royal 2/2024 n’a aucune incidence sur le montant de la somme forfaitaire proposé dans la mesure où cet acte n’assure pas la transposition de la directive 2019/1158, au regard ni de l’article 8, paragraphe 3, de cette directive ni des articles 9 et 12 de celle-ci. En particulier, bien que la durée du congé parental rémunéré pour les mères biologiques dont la relation de travail est régie par le droit du travail ait été prolongée par le décret-loi royal 2/2024, celui-ci ne garantirait toujours pas à ces mères qui prennent un congé parental le versement d’une rémunération ou d’une allocation équivalent à un revenu correspondant à deux mois moins deux semaines de travail, qui devait leur être garanti pour le 2 août 2022, et ce alors même que cet acte aurait été adopté quelques mois seulement avant le 2 août 2024, date à laquelle devait leur être garanti un congé parental rémunéré de deux mois complets.
82 Dans son mémoire en duplique, le Royaume d’Espagne indique, d’abord, que, après l’entrée en vigueur du décret-loi royal 2/2024, des mesures doivent encore être prises pour que le droit national prévoie une semaine supplémentaire de congé afin que les travailleurs puissent bénéficier, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2019/1158, d’un congé parental de deux mois moins deux semaines. Quant aux articles 9 et 12 de la directive 2019/1158, ils auraient été intégralement transposés dans le droit espagnol. Ensuite, s’agissant des données chiffrées avancées par la Commission, le Royaume d’Espagne précise que les travailleuses du secteur privé relevant du droit du travail, âgées de 16 à 49 ans, auraient été au nombre de 4 565 800 en 2022 et que les employés du secteur public relevant du droit du travail auraient été au nombre de 614 320 au cours de cette année. En ce qui concerne la proportion des travailleurs couverts par une convention collective, la Commission commettrait une erreur manifeste d’interprétation des données exposées dans le mémoire en défense. Enfin, le Royaume d’Espagne conteste l’argument de la Commission relatif à la pertinence, pour déterminer d’éventuelles sanctions financières, de l’état de la législation nationale et, en particulier, des progrès significatifs réalisés par la législation espagnole dans le domaine de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale des travailleurs.
Appréciation de la Cour
83 Il convient de rappeler que l’article 260, paragraphe 3, premier alinéa, TFUE prévoit que, lorsque la Commission saisit la Cour d’un recours en vertu de l’article 258 TFUE, estimant que l’État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d’une directive adoptée conformément à une procédure législative, elle peut, lorsqu’elle le considère approprié, indiquer le montant d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte à payer par cet État membre, qu’elle estime adapté aux circonstances. Conformément à l’article 260, paragraphe 3, second alinéa, TFUE, si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l’État membre concerné le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission, l’obligation de paiement prenant effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.
84 Dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 66 du présent arrêt, il est établi que, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, le Royaume d’Espagne n’avait ni adopté ni, partant, communiqué à la Commission toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition dans son droit interne des dispositions de la directive 2019/1158, il y a lieu de considérer que ce manquement relève du champ d’application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE.
85 Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objectif poursuivi par le mécanisme figurant à l’article 260, paragraphe 3, TFUE est non seulement d’inciter les États membres à mettre fin, dans les plus brefs délais, à un manquement qui, en l’absence d’une telle disposition, aurait tendance à persister, mais également d’alléger et d’accélérer la procédure d’imposition de sanctions pécuniaires concernant les manquements à l’obligation de communication des dispositions nationales de transposition d’une directive adoptée conformément à la procédure législative [arrêt du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte) , C‑149/23, EU:C:2025:145, point 80 et jurisprudence citée].
86 Afin d’atteindre cet objectif, l’article 260, paragraphe 3, TFUE prévoit l’imposition de deux types de sanctions pécuniaires, à savoir une somme forfaitaire et une astreinte journalière.
87 Si l’application d’une astreinte journalière semble particulièrement adaptée pour inciter un État membre à mettre fin, dans les plus brefs délais, à un manquement, la condamnation au paiement d’une somme forfaitaire repose davantage sur l’appréciation des conséquences du défaut d’exécution des obligations pesant sur l’État membre concerné à l’égard des intérêts privés et publics en présence, notamment lorsque le manquement a persisté pendant une longue période [arrêt du 6 mars 2025, Commission/Estonie (Directive lanceurs d’alerte) , C‑154/23, EU:C:2025:148, point 62 et jurisprudence citée].
88 À cet égard, la Commission motive la nature et le montant des sanctions pécuniaires sollicitées, en s’appuyant sur les lignes directrices qu’elle a adoptées, telles que celles contenues dans ses communications, qui, tout en ne liant pas la Cour, contribuent à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l’action menée par la Commission [arrêt du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte) , C‑149/23, EU:C:2025:145, point 83 et jurisprudence citée].
89 S’agissant de l’opportunité d’imposer de telles sanctions pécuniaires, il appartient à la Cour, dans chaque affaire et en fonction des circonstances de l’espèce dont elle se trouve saisie ainsi que du niveau de persuasion et de dissuasion qui lui paraît requis, d’arrêter les sanctions pécuniaires appropriées, notamment pour prévenir la répétition d’infractions analogues au droit de l’Union [arrêt du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte) , C‑149/23, EU:C:2025:145, point 84 et jurisprudence citée].
90 En l’occurrence, il convient de considérer que, premièrement, nonobstant le fait que le Royaume d’Espagne a coopéré avec les services de la Commission au cours de la procédure précontentieuse, l’ensemble des éléments juridiques et factuels entourant le manquement constaté constitue un indicateur de ce que la prévention effective de la répétition future d’infractions analogues au droit de l’Union est de nature à requérir l’adoption d’une mesure dissuasive telle que l’imposition d’une somme forfaitaire. À cet égard, il convient de relever que, tant à l’expiration du délai prévu à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2019/1158 qu’à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé ainsi qu’à la date de l’examen des faits par la Cour, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives permettant une transposition effective de cette directive n’avaient pas été communiquées à la Commission, ce que le Royaume d’Espagne ne conteste pas.
91 Deuxièmement, s’agissant de l’infliction d’une astreinte, une telle sanction ne s’impose en principe que pour autant que persiste le manquement que cette astreinte vise à sanctionner jusqu’à l’examen des faits par la Cour, lequel doit être considéré comme intervenant à la date de la clôture de la procédure devant celle-ci. Il convient de préciser que, dans un cas où, comme en l’espèce, aucune audience n’a été tenue, la date à prendre en compte à cet égard est celle de la clôture de la phase écrite de la procédure [arrêt du 6 mars 2025, Commission/Estonie (Directive lanceurs d’alerte) , C‑154/23, EU:C:2025:148, point 67].
92 Il s’ensuit que, afin de déterminer si, en l’espèce, la condamnation du Royaume d’Espagne au paiement d’une astreinte peut être envisagée, il convient d’examiner si le manquement constaté au point 66 du présent arrêt a persisté jusqu’à la date de clôture de la phase écrite de la procédure devant la Cour, intervenue le 25 novembre 2024.
93 En l’occurrence, il n’est pas contesté que, à la date de cette clôture, le Royaume d’Espagne n’avait ni adopté ni, partant, communiqué toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 2019/1158 dans son droit interne. Par conséquent, il doit être constaté que cet État membre a persisté dans son manquement jusqu’à l’examen des faits par la Cour.
94 Dans ces conditions, la condamnation du Royaume d’Espagne au paiement d’une astreinte journalière, telle que sollicitée par la Commission, constituerait un moyen financier approprié afin d’assurer que cet État membre mette fin, dans les plus brefs délais, au manquement constaté et respecte les obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2019/1158. Toutefois, dès lors qu’il ne saurait être exclu que, à la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire, la transposition de cette directive soit totalement achevée, il ne serait approprié d’infliger une astreinte que dans la mesure où le manquement persisterait à la date de ce prononcé [voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2025, Commission/Estonie (Directive lanceurs d’alerte) , C‑154/23, EU:C:2025:148, point 70].
95 En ce qui concerne le calcul du montant de la somme forfaitaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, seule la Cour est compétente pour infliger une sanction pécuniaire à un État membre. Toutefois, dans le cadre d’une procédure engagée sur le fondement de cette disposition, la Cour ne dispose que d’un pouvoir d’appréciation encadré, dès lors que, en cas de constat d’un manquement par cette dernière, les propositions de la Commission lient la Cour quant à la nature de la sanction pécuniaire qu’elle peut infliger et quant au montant maximal de la sanction qu’elle peut prononcer [arrêt du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte) , C‑149/23, EU:C:2025:145, point 86 et jurisprudence citée].
96 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en la matière tel qu’encadré par les propositions de la Commission, il appartient à la Cour de fixer le montant des sanctions pécuniaires infligées à un État membre en vertu de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, de telle sorte qu’il soit, d’une part, adapté aux circonstances et, d’autre part, proportionné à l’infraction commise. Figurent notamment au rang des facteurs pertinents à cet égard des éléments tels que la gravité du manquement constaté, la période durant laquelle celui-ci a persisté ainsi que la capacité de paiement de l’État membre en cause [arrêt du 6 mars 2025, Commission/Estonie (Directive lanceurs d’alerte) , C‑154/23, EU:C:2025:148, point 72 et jurisprudence citée].
97 Il convient également de rappeler, ainsi qu’il est mentionné au point 88 du présent arrêt, que, dans le cadre de ce pouvoir d’appréciation, des lignes directrices, telles que les communications de la Commission, ne lient pas la Cour, mais contribuent à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l’action menée par la Commission elle-même lorsque cette institution fait des propositions à la Cour [arrêt du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte) , C‑149/23, EU:C:2025:145, point 88 et jurisprudence citée].
98 En l’occurrence, la Commission s’est fondée sur la communication de 2023 pour fixer le montant des sanctions pécuniaires qu’elle demande d’infliger au Royaume d’Espagne.
99 En premier lieu, concernant la gravité du manquement constaté, il convient de rappeler que l’obligation d’adopter des dispositions pour assurer la transposition complète d’une directive et l’obligation de communiquer ces dispositions à la Commission constituent des obligations essentielles des États membres afin d’assurer la pleine effectivité du droit de l’Union, et que le manquement à ces obligations doit, dès lors, être considéré comme étant d’une gravité certaine [arrêt du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte) , C‑149/23, EU:C:2025:145, point 92 et jurisprudence citée].
100 En l’occurrence, il y a lieu de souligner que la directive 2019/1158 est un instrument crucial du droit de l’Union en ce qu’elle établit, ainsi que l’énonce son article 1 er , lu en combinaison avec les considérants 6, 16, 34 et 41 de celle-ci, des exigences minimales conçues pour parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les opportunités sur le marché du travail et le traitement au travail, en facilitant la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale pour les travailleurs qui sont parents ou les aidants. En effet, l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental du droit de l’Union. Les politiques relatives à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée contribuent à la réalisation de l’égalité entre les hommes et les femmes en encourageant la participation des femmes au marché du travail, le partage des responsabilités familiales à parts égales entre les hommes et les femmes et la réduction des écarts de revenus et de salaire entre les hommes et les femmes. Cette directive vise ainsi à renforcer le cadre juridique de l’Union et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes en garantissant des exigences minimales en matière de congé de paternité, de congé parental et de congé d’aidant, ainsi qu’en matière de formules souples de travail pour les travailleurs qui sont parents ou les aidants.
101 Ainsi, l’absence de transposition complète de la directive 2019/1158 dans le délai imparti porte nécessairement atteinte au respect du droit de l’Union et à son application uniforme et effective, nuit à l’égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et leur traitement au travail et doit, par conséquent, être considérée comme étant d’une gravité certaine.
102 Cela étant, en application de la jurisprudence citée au point 96 du présent arrêt, aucun des arguments soulevés par le Royaume d’Espagne ne saurait être pris en compte en tant que circonstance atténuante dans le cadre de l’appréciation de la gravité de l’infraction.
103 Premièrement, doit être rejeté l’argument selon lequel il existe des précédents dans lesquels la Commission aurait appliqué le coefficient de gravité de 1 en cas de transposition partielle de trois articles d’une directive.
104 À cet égard, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 99 du présent arrêt, que l’obligation d’adopter les mesures de transposition d’une directive constitue une obligation essentielle. Or, la circonstance que certaines de ses dispositions ont déjà été transposées dans le droit national ne saurait être considérée comme étant une circonstance atténuante.
105 Deuxièmement, même si, d’une part, l’article 8, paragraphe 3, et l’article 9 de la directive 2019/1158 ont déjà été transposés dans le droit espagnol pour une partie importante des citoyens concernés et, d’autre part, en ce qui concerne la transposition de cet article 8, paragraphe 3, s’agissant de la mère biologique dont le contrat de travail est régi par le droit du travail, le congé parental visé à l’article 5, paragraphe 2, de cette directive serait déjà partiellement couvert par le droit national, il n’en demeure pas moins que l’infraction en cause limite les droits des travailleurs se trouvant sur l’ensemble du territoire national et porte par conséquent atteinte aux intérêts généraux et particuliers.
106 Troisièmement, doit être rejeté l’argument selon lequel la législation espagnole serait particulièrement avancée en matière de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale des travailleurs, dépassant ainsi les exigences du droit de l’Union et respectant les objectifs de la directive 2019/1158. En effet, un État membre ne saurait s’exonérer de son obligation de transposition en invoquant l’instauration de mesures qui ne relèvent pas de la directive 2019/1158 ou qui dépassent les objectifs de celle-ci.
107 En deuxième lieu, dans le cadre de l’appréciation de la durée de l’infraction, il importe de rappeler que, en ce qui concerne le début de la période dont il convient de tenir compte pour fixer le montant de la somme forfaitaire, la date à retenir en vue de l’évaluation de la durée du manquement en cause est non pas celle de l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé de la Commission, mais la date à laquelle expire le délai de transposition prévu par la directive en question [arrêt du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte) , C‑149/23, EU:C:2025:145, point 101 et jurisprudence citée].
108 S’agissant de la fixation d’une astreinte, la durée de l’infraction doit être évaluée en ayant égard au moment auquel la Cour apprécie les faits et non pas à celui où cette dernière est saisie par la Commission [arrêt du 8 juillet 2019, Commission/Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE – Réseaux à haut débit) , C‑543/17, EU:C:2019:573, point 87].
109 Or, il est constant que le Royaume d’Espagne n’avait pas, à l’expiration du délai de transposition prévu à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2019/1158, à savoir le 2 août 2022, adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour assurer une transposition complète de cette directive et, partant, n’avait pas non plus communiqué ces dispositions à la Commission, contrairement à ce que prévoit l’article 20, paragraphe 1, de ladite directive. Il s’ensuit que le manquement en cause, qui n’a pas pris fin à la date de l’examen des faits par la Cour, persiste depuis plus de deux ans et demi.
110 En troisième lieu, en ce qui concerne la capacité de paiement de l’État membre en cause, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, sans préjudice de la possibilité pour la Commission de proposer des sanctions financières fondées sur une pluralité de critères, en vue de permettre, notamment, de maintenir un écart raisonnable entre les divers États membres, il convient de prendre en compte le PIB de cet État en tant que facteur prédominant aux fins de l’appréciation de sa capacité de paiement et de la fixation de sanctions suffisamment dissuasives et proportionnées, afin de prévenir de manière effective la répétition future d’infractions analogues au droit de l’Union [arrêts du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte) , C‑147/23, EU:C:2024:346, point 81, et du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte) , C‑149/23, EU:C:2025:145, point 103].
111 À cet égard, la Cour a itérativement jugé qu’il convenait de prendre en compte l’évolution récente du PIB de l’État membre concerné, telle qu’elle se présente à la date de l’examen des faits par la Cour [arrêts du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte) , C‑147/23, EU:C:2024:346, point 82, et du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte) , C‑149/23, EU:C:2025:145, point 104].
112 En l’occurrence, le facteur « n », représentant la capacité de paiement de l’État membre concerné par rapport à la capacité de paiement des autres États membres, appliqué par la Commission aux termes des points 3.4 et 4.2 de la communication de 2023, se définit comme une moyenne géométrique pondérée du PIB de l’État membre concerné par rapport à la moyenne des PIB des États membres, qui compte pour deux tiers du calcul du facteur « n », et de la population de l’État membre concerné par rapport à la moyenne de la population des États membres, qui compte pour un tiers du calcul du facteur « n », ainsi qu’il ressort de l’équation mentionnée au point 14 du présent arrêt. La Commission justifie cette méthode de calcul du facteur « n » à la fois par l’objectif de maintenir un écart raisonnable des facteurs « n » des États membres, en comparaison avec un calcul fondé uniquement sur le PIB des États membres, et par l’objectif de garantir une certaine stabilité dans le calcul du facteur « n », étant donné qu’il est peu probable que la population varie de manière significative sur une base annuelle [arrêts du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte) , C‑147/23, EU:C:2024:346, point 83, et du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte) , C‑149/23, EU:C:2025:145, point 105].
113 Toutefois, la Cour a jugé que la détermination de la capacité de paiement de l’État membre concerné ne saurait inclure, dans la méthode de calcul du facteur « n », la prise en compte d’un critère démographique selon les modalités prévues aux points 3.4 et 4.2 de la communication de 2023 [arrêts du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte) , C‑147/23, EU:C:2024:346, point 86, et du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte) , C‑149/23, EU:C:2025:145, point 106].
114 Partant, conformément à la jurisprudence rappelée au point 110 du présent arrêt et à défaut d’un critère pertinent avancé par la Commission pour garantir une stabilité de calcul et maintenir un écart raisonnable des facteurs « n » des États membres, c’est en tenant compte de la moyenne du PIB du Royaume d’Espagne des trois dernières années qu’il convient de fixer le montant des sanctions pécuniaires.
115 Au vu de ce qui précède et au regard du pouvoir d’appréciation reconnu à la Cour par l’article 260, paragraphe 3, TFUE, lequel prévoit que celle-ci ne saurait, en ce qui concerne les sanctions financières dont elle inflige le paiement, fixer un montant dépassant celui indiqué par la Commission, il y a lieu de considérer, d’une part, que la prévention effective de la répétition future d’infractions analogues à celle résultant de la violation de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2019/1158 et portant atteinte à la pleine effectivité du droit de l’Union requiert l’imposition d’une somme forfaitaire dont le montant doit être fixé à 6 832 000 euros et, d’autre part, que, dans le cas où le manquement constaté au point 66 du présent arrêt persisterait à la date du prononcé de cet arrêt, de condamner le Royaume d’Espagne à payer à la Commission, à compter de cette date et jusqu’à ce que cet État membre ait mis un terme à ce manquement, une astreinte journalière d’un montant de 19 700 euros.
Sur les dépens
116 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) En ayant omis, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé de la Commission européenne, d’adopter toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, et, partant, en ayant omis de communiquer ces dispositions à la Commission, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2019/1158.
2) En n’ayant pas, à la date de l’examen des faits par la Cour, adopté toutes les mesures nécessaires pour transposer dans son droit interne les dispositions de la directive 2019/1158 ni, partant, communiqué ces mesures à la Commission européenne, le Royaume d’Espagne a persisté dans son manquement.
3) Le Royaume d’Espagne est condamné à payer à la Commission européenne :
– une somme forfaitaire d’un montant de 6 832 000 euros ;
– dans le cas où le manquement constaté au point 1 du dispositif persisterait à la date du prononcé du présent arrêt, une astreinte journalière d’un montant de 19 700 euros à compter de cette date et jusqu’à ce que cet État membre ait mis un terme à ce manquement.
4) Le Royaume d’Espagne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
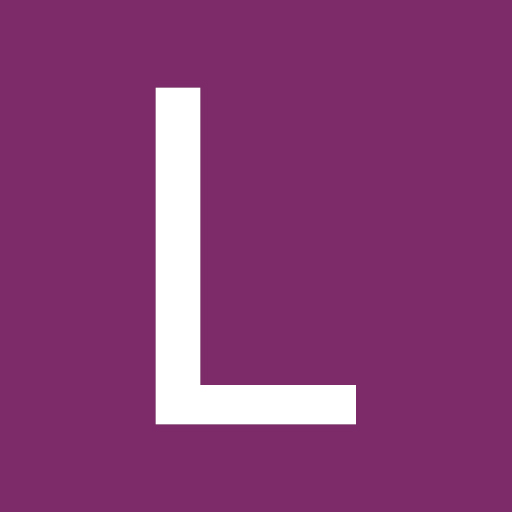
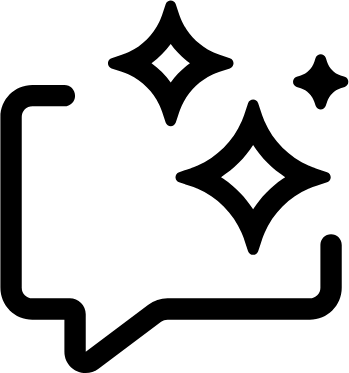 LEXI - AI Legal Assistant
LEXI - AI Legal Assistant