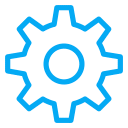Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 23 July 2025.
Rafal Stanecki v European Commission.
• 62024TJ0108 • ECLI:EU:T:2025:750
- Inbound citations: 0
- •
- Cited paragraphs: 0
- •
- Outbound citations: 23
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
23 juillet 2025 ( * )
« Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Suspension de l’avancement d’échelon – Actes contraires à la dignité de la fonction – Article 12 du statut – Erreur manifeste d’appréciation – Liberté d’expression – Proportionnalité de la sanction – Responsabilité »
Dans l’affaire T‑108/24,
Rafal Stanecki, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par M es A. Champetier et S. Rodrigues, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. L. Hohenecker et A. Sauka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, J. Laitenberger et M me M. Stancu (rapporteure), juges,
greffier : M me H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
vu les deux offres de preuve présentées par le requérant le 25 avril 2025,
à la suite de l’audience du 6 mai 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, M. Rafal Stanecki, demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 3 juillet 2023, par laquelle celle-ci lui a infligé la sanction disciplinaire de suspension de l’avancement d’échelon pour une période de douze mois (ci-après la « décision attaquée »), et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il aurait subi à la suite de cette décision.
I. Antécédents du litige
2 Le requérant est fonctionnaire au sein de la Commission.
3 Le 19 décembre 2021, le requérant a eu un échange de courriels (ci-après l’« échange de courriels litigieux »), depuis son adresse électronique personnelle, avec le représentant permanent de la République de Pologne auprès de l’Union européenne (ci-après l’« ambassadeur polonais »).
4 En particulier, à 19 h 49, le requérant a envoyé à l’ambassadeur polonais un courriel (ci-après le « premier courriel »), dont l’objet était « Vœux de Noël à l’ambassadeur [polonais] ». Ce courriel était formulé comme suit :
« […]
À la suite des récents évènements en Pologne, je voudrais vous faire part de mon souhait que vous soyez tenu politiquement responsable, comme vos mandants en Pologne, de vos activités antieuropéennes et prorusses.
Ici, à Bruxelles, vous prêtez votre nom à la destruction de la démocratie et des médias libres. Je voudrais vous assurer que vos activités ici à Bruxelles ne seront certainement pas oubliées.
La question de savoir si vous avez porté atteinte aux intérêts de la Pologne, sciemment ou non, sera tranchée par un tribunal indépendant dans la Pologne libre [...] »
5 Le même jour, à 19 h 57, l’ambassadeur polonais a répondu au requérant, en mettant en copie de son courriel la secrétaire générale de la Commission et le chef de cabinet de la présidente de la Commission (ci-après le « deuxième courriel »). Ce courriel était ainsi rédigé :
« […]
Je vous souhaite un travail efficace sur le changement climatique [et je compte sur] l’activité de la Commission européenne.
J’espère que vous ne m’envoyez pas de menaces et que vous ne voulez pas m’intimider [...] »
6 En réponse à ce deuxième courriel, le requérant a écrit à l’ambassadeur polonais, le même jour à 20 h 47, un autre courriel (ci-après le « troisième courriel »), qui se lit ainsi :
« […]
Je vous remercie de votre réponse rapide et de votre préoccupation concernant la Commission européenne. Je m’inquiéterais davantage de l’avenir de la Pologne et de son adhésion à [l’Union].
La Commission se débrouillera.
Cela vaut la peine de lire un texte avec attention et de réfléchir aux conséquences de ses actes [...] »
7 Considérant comme étant inapproprié l’échange de courriels litigieux, la secrétaire générale de la Commission a demandé à la directrice générale de la direction générale (DG) « Ressources humaines et sécurité » de la Commission (ci-après la « directrice générale HR ») de soumettre cet échange à l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC).
8 Le 12 janvier 2022, la directrice générale HR a, en accord avec la secrétaire générale de la Commission, donné mandat à l’IDOC pour mener une enquête administrative. L’IDOC a remis son rapport d’enquête le 7 avril 2022 (ci-après le « rapport de l’IDOC »), sur lequel le requérant a présenté ses observations écrites, dans le cadre de la procédure prédisciplinaire lancée par la directrice générale HR le 19 avril 2022.
9 Le 30 mai 2022, la directrice générale HR, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’« AIPN »), a présenté un rapport d’enquête administrative par lequel elle a demandé l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant, avec saisine du conseil de discipline (ci-après le « rapport de la directrice générale HR »). Ainsi qu’il ressort de ce rapport, il était reproché au requérant d’avoir méconnu les articles 11, 12 et 17 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), en raison du ton inapproprié utilisé dans l’échange de courriels litigieux.
10 Le 13 avril 2023, le conseil de discipline a émis un avis motivé (ci-après l’« avis du conseil de discipline ») dans lequel il a considéré que le requérant avait méconnu l’article 12 du statut et que la sanction disciplinaire appropriée était l’avertissement par écrit, prévu à l’article 9, paragraphe 1, sous a), de l’annexe IX du statut.
11 Le 3 juillet 2023, l’AIPN tripartite a adopté la décision attaquée en infligeant au requérant une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline, à savoir la suspension de l’avancement d’échelon pour une période de douze mois, prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de l’annexe IX du statut.
12 Le 29 septembre 2023, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée.
13 La Commission a rejeté, le 25 janvier 2024, la réclamation du requérant (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
II. Conclusions des parties
14 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ainsi que, en tant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner la Commission à l’indemniser pour le préjudice subi du fait de la décision attaquée à hauteur de 50 000 euros ;
– condamner la Commission aux dépens.
15 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
III. En droit
16 À titre liminaire, le requérant a demandé, aux points 125 à 129 de la requête ainsi que par acte séparé déposé en même temps que la requête, la jonction de la présente affaire avec l’affaire T‑569/23, Stanecki/Commission.
17 L’affaire T‑569/23 ayant été close par l’arrêt du 22 janvier 2025, Stanecki/Commission (T‑569/23, non publié, sous pourvoi, EU:T:2025:52), par lequel le Tribunal a rejeté le recours, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de jonction.
A. Sur l’objet du recours
18 Le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ainsi que, en tant que de besoin, de la décision de rejet de la réclamation.
19 S’agissant de la demande d’annulation de la décision de rejet de la réclamation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cas où la décision de rejet de la réclamation est dépourvue de contenu autonome, des conclusions formellement dirigées contre cette décision ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée [voir arrêt du 23 mars 2022, NV/eu-LISA, T‑661/20, EU:T:2022:154, point 31 (non publié) et jurisprudence citée].
20 En l’espèce, il convient de constater que la décision de rejet de la réclamation est dépourvue de contenu autonome. En effet, elle ne fait que confirmer, en substance, la décision attaquée.
21 Dès lors, le recours doit être regardé comme étant dirigé contre la décision attaquée, dont la légalité doit être examinée en prenant également en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation [voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2022, NV/eu-LISA, T‑661/20, EU:T:2022:154, point 33 (non publié) et jurisprudence citée].
B. Sur le fond
22 Au soutien de ses conclusions visant l’annulation de la décision attaquée, le requérant invoque quatre moyens, tirés, le premier, d’erreurs manifestes d’appréciation entachant plusieurs actes préparatoires, le deuxième, de la violation de l’article 12 du statut, le troisième, de la violation du droit à la liberté d’expression et, le quatrième, de la violation des articles 10 et 22 de l’annexe IX du statut. Le requérant demande également la réparation du préjudice, d’ordre physique et moral, qu’il aurait subi du fait de la décision attaquée et qu’il évalue à hauteur de 50 000 euros.
1. Sur les conclusions en annulation
a) Sur le premier moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation entachant plusieurs actes préparatoires
23 Le requérant soutient, en substance, que les actes préparatoires de la décision attaquée, à savoir le rapport de l’IDOC, celui de la directrice générale HR et l’avis du conseil de discipline sont entachés d’erreurs manifestes d’appréciation qui ont été reprises par l’AIPN tripartite dans ladite décision.
24 Premièrement, selon le requérant, le rapport de l’IDOC et celui de la directrice générale HR ne tiennent pas suffisamment compte du contexte politique dans lequel l’échange de courriels litigieux a eu lieu, alors que l’avis du conseil de discipline prend en considération ce même contexte pour l’exonérer de toute atteinte à son devoir de loyauté. Le requérant précise que ces deux rapports ne contiennent que des « considérations générales [sur le contexte politique], sans lien avec les motivations [qu’il a] exprimées […] et surtout sans [qu’]en [soient] tir[ées] de quelconques conclusions ».
25 Deuxièmement, le requérant fait valoir que le rapport de la directrice générale HR mentionne qu’il était facilement identifiable comme étant un fonctionnaire de la Commission par le biais d’une « simple recherche Google », sans pour autant étayer cette affirmation par des éléments de preuve. Or, selon le requérant, cette appréciation est erronée, en ce que l’ambassadeur polonais a pu l’identifier, non par une simple recherche sur Internet, mais parce qu’il a pris l’initiative de chercher son nom dans la liste du personnel de la Commission ainsi que dans l’annuaire officiel de l’Union, intitulé « EU Whoiswho ». Le requérant reproche également à la Commission d’avoir produit des preuves concernant le résultat de cette recherche sur Internet seulement au stade de la décision de rejet de la réclamation.
26 Le 25 avril 2025, le requérant a en outre présenté une première offre de preuve à ce sujet, à savoir la décision du 25 mars 2025 du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), qu’il a saisi et qui aurait confirmé l’existence d’une telle liste du personnel de la Commission, en constatant un transfert excessif de données personnelles au regard du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n o 45/2001 et la décision n o 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).
27 Troisièmement, le rapport de l’IDOC ainsi que celui de la directrice générale HR mentionneraient le fait que le requérant n’a pas précisé à l’occasion de l’échange de courriels litigieux qu’il n’écrivait pas en tant que fonctionnaire de la Commission. Selon le requérant, cette appréciation est erronée, car il ne peut pas être exigé d’un fonctionnaire qu’il précise, dans tous ses échanges ayant lieu en dehors de son lieu de travail, qu’il n’écrit pas au nom de l’institution pour laquelle il travaille.
28 La Commission conteste ces arguments.
29 D’une part, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief et ce n’est qu’à l’occasion d’un recours contre la décision prise au terme de la procédure que la partie requérante peut faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés (voir arrêt du 29 mai 2024, Canel Ferreiro/Conseil, T‑766/22, EU:T:2024:336, point 22 et jurisprudence citée).
30 D’autre part, la légalité des actes préparatoires peut être contestée à l’occasion d’un recours contre la décision prise au terme d’une procédure seulement pour autant que ces actes peuvent influencer le contenu de cette décision (voir, en ce sens, ordonnance du 26 juin 2018, Kerstens/Commission, T‑757/17, non publiée, EU:T:2018:391, point 27 et jurisprudence citée).
31 En l’espèce, il convient de vérifier si le requérant est fondé à faire valoir que le rapport de l’IDOC, celui de la directrice générale HR et l’avis du conseil de discipline contiennent des erreurs susceptibles d’entraîner l’illégalité de la décision attaquée.
32 D’emblée, il convient de relever que, en ce qui concerne l’avis du conseil de discipline, le requérant n’explique aucunement en quoi cet avis serait entaché d’une erreur d’appréciation. Au contraire, le requérant s’appuie sur cet avis notamment pour faire valoir que l’AIPN tripartite aurait dû le suivre et ainsi l’exonérer de toute atteinte à son devoir de loyauté.
33 En conséquence, l’argument portant sur l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’avis du conseil de discipline doit être rejeté comme non fondé.
34 En ce qui concerne le rapport de l’IDOC et celui de la directrice générale HR, il y a lieu de relever que le requérant adresse trois reproches à l’encontre de ces actes préparatoires. Il s’agit notamment de l’absence de prise en considération du contexte politique dans lequel l’échange de courriels litigieux a eu lieu, de l’identification aisée de ses fonctions au sein de la Commission par le biais d’une recherche sur Internet et du fait qu’il n’aurait pas pris ses distances en tant que fonctionnaire de cette institution.
35 Premièrement, en ce qui concerne le contexte politique, en premier lieu, il convient de relever que la partie finale du rapport de l’IDOC, intitulée « Analyse », fait bel et bien référence à ce contexte.
36 En particulier, l’IDOC précise, à la page 18 de son rapport, avoir pris en compte le fait que le requérant était préoccupé par la liberté des médias en Pologne, mais qu’il ne ressortait pas de l’échange de courriels litigieux qu’il ait explicité le contexte dans lequel il écrivait ni qu’il ait fait référence à des faits en particulier. En effet, selon l’IDOC, le requérant s’est limité à formuler des remarques générales sur les « récents évènements en Pologne » ainsi que sur les activités « antieuropéennes et prorusses » de l’ambassadeur polonais. L’IDOC a également analysé les arguments du requérant selon lesquels cet ambassadeur avait profité de l’échange de courriels litigieux pour l’attaquer politiquement lui, en tant que membre du personnel de la Commission, et un membre de sa famille, en tant que membre du parti politique d’opposition au Sénat polonais. À cet égard, l’IDOC a relevé que ces arguments n’étaient pas étayés. Sur la base de ces considérations, l’IDOC a finalement conclu que « les arguments [du requérant] ne change[aie]nt pas le constat [selon lequel] il a[vait] adopté un comportement inapproprié à l’égard de [l’ambassadeur polonais] ».
37 Partant, c’est à tort que le requérant affirme que, dans son rapport, l’IDOC n’a pas suffisamment pris en considération le contexte politique dans lequel l’échange de courriels litigieux avait eu lieu.
38 En second lieu, en ce qui concerne le rapport de la directrice générale HR, il convient de relever que celui-ci examine, à la page 10, les commentaires du requérant selon lesquels « le rapport [de l’IDOC] n’a pas analysé en profondeur ses motivations et ses actions, à savoir qu’il agissait dans l’intérêt général de l’U[nion] et de la Pologne en tant qu’État membre ». À cet égard, la directrice générale HR a considéré qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’utiliser un langage inapproprié, que le devoir de loyauté s’opposait au fait de servir les intérêts d’un État membre et que le requérant avait envoyé des courriels non sollicités à l’ambassadeur polonais sur un « sujet controversé ».
39 Il en ressort que l’AIPN a pris en considération le contexte politique entourant l’échange de courriels litigieux et que c’est précisément en raison d’un tel contexte politiquement sensible que le requérant devait, à son avis, éviter de s’adresser de manière inappropriée à l’ambassadeur polonais.
40 Partant, c’est également à tort que le requérant affirme que l’AIPN n’a pas suffisamment pris en considération le contexte politique dans son rapport.
41 Deuxièmement, en ce qui concerne l’identification aisée des fonctions du requérant au sein de la Commission par le biais d’une recherche sur Internet, force est de constater, à l’instar de la Commission, que l’AIPN tripartite n’a pas repris, dans la décision attaquée, l’affirmation figurant dans le rapport de la directrice générale HR concernant le fait qu’une « simple recherche Google » montrerait que le requérant était fonctionnaire à la Commission. Partant, conformément à la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus, une telle erreur entachant le rapport de la directrice générale HR, à la supposer établie, n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée.
42 Pour les mêmes raisons, le requérant ne saurait reprocher à la Commission d’avoir fourni les preuves concernant cette « recherche Google » seulement au stade de la décision de rejet de la réclamation et en réponse aux griefs qu’il avait présentés dans la réclamation. En effet, l’AIPN tripartite ayant décidé de ne pas se fonder sur cet élément, elle n’était pas tenue de fournir une quelconque preuve à ce sujet au stade de la décision attaquée.
43 Pour autant que le requérant fait valoir qu’il a été identifié par l’ambassadeur polonais comme étant un fonctionnaire de la Commission en raison de la diffusion, auprès de la représentation permanente de cet État membre, de la liste du personnel de la Commission, dont la légalité aurait été remise en cause par la décision du 25 mars 2025 du CEPD, il suffit de relever que la décision attaquée ne fait nullement mention de cette liste. En outre, le requérant ne nie pas que son nom était facilement repérable également dans l’annuaire officiel de l’Union « EU Whoiswho », dont la légalité n’a pas été remise en question par le CEPD.
44 Cet argument doit donc être rejeté comme non fondé.
45 Troisièmement, en ce qui concerne le reproche figurant dans le rapport de l’IDOC et dans celui de la directrice générale HR selon lequel le requérant n’aurait pas pris ses distances en tant que fonctionnaire de la Commission, il convient de relever que cet élément a été pris en considération pour étayer l’affirmation selon laquelle, même après avoir été identifié comme étant un fonctionnaire de la Commission par l’ambassadeur polonais, le requérant n’a pas jugé utile, dans le troisième courriel, de dissiper tout doute quant au fait qu’il agissait en son nom et non pour défendre les intérêts de la Commission.
46 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, compte tenu de l’importance de la relation de confiance existant entre l’Union et le fonctionnaire en ce qui concerne tant le fonctionnement intérieur de l’Union que son image à l’extérieur, et au vu de la généralité des termes de l’article 12 du statut, celui-ci couvre toute circonstance ou tout comportement dont le fonctionnaire doit raisonnablement comprendre, au vu de son grade et des fonctions qu’il exerce ainsi que des circonstances propres de l’affaire, qu’il est de nature à apparaître, aux yeux des tiers, comme étant susceptible de provoquer une confusion quant aux intérêts poursuivis par l’Union qu’il est censé servir (voir arrêt du 24 novembre 2021, CX/Commission, T‑743/16 RENV II, non publié, EU:T:2021:824, point 130 et jurisprudence citée).
47 Or, dans la mesure où la circonstance selon laquelle le requérant n’a pas pris ses distances en tant que fonctionnaire de la Commission représente l’un des éléments constitutifs du comportement de ce dernier qui, selon l’IDOC et la directrice générale HR, était susceptible de provoquer, aux yeux des tiers, une confusion quant aux intérêts poursuivis par l’Union qu’il est censé servir, il ne saurait leur être reproché d’en avoir tenu compte dans leurs rapports respectifs.
48 Cet argument doit dès lors être rejeté.
49 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure qu’aucun des actes préparatoires mentionnés par le requérant, à savoir le rapport de l’IDOC, celui de la directrice générale HR et l’avis du conseil de discipline, n’est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation susceptible d’entraîner l’illégalité de la décision attaquée.
50 Le premier moyen doit donc être rejeté comme non fondé.
b) Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 12 du statut
51 Le requérant soutient, en substance, que la décision attaquée méconnaît l’article 12 du statut, en ce qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir porté atteinte à la dignité de ses fonctions à cause de l’échange de courriels litigieux. Le requérant prétend essentiellement que cet échange était d’ordre privé, qu’il n’était pas inapproprié, comme l’aurait également constaté le conseil de discipline, qu’il n’a pas écrit à l’ambassadeur polonais en tant que fonctionnaire de la Commission, mais en sa qualité de citoyen polonais et belge et qu’il ne s’est pas exprimé au nom de celle-ci.
52 S’agissant du caractère inapproprié de cet échange, le requérant affirme, tout d’abord, que ses propos ne sont pas irrespectueux, en ce qu’ils ne dépassent pas les limites du débat politique d’intérêt général et reflètent la dure réalité des faits en Pologne, ce à quoi se réfèrent les « récents évènements », la « destruction de la démocratie et des médias libres » et l’« atteinte aux intérêts de la Pologne ». Ensuite, la phrase « vos activités ici à Bruxelles ne seront certainement pas oubliées » serait une référence au fait que les prises de position du gouvernement polonais ont été relayées à Bruxelles (Belgique) par l’ambassadeur polonais dans l’espace public ainsi que par les médias et les réseaux sociaux. Enfin, la phrase « la question de savoir si vous avez porté atteinte aux intérêts de la Pologne, sciemment ou non, sera tranchée par un tribunal indépendant dans la Pologne libre » serait une référence aux multiples contentieux liés aux violations du droit de l’Union par le législateur polonais, notamment devant la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »).
53 En ce qui concerne la confusion entre ses intérêts personnels et ceux de la Commission, le requérant soutient que c’est l’ambassadeur polonais qui a créé une telle confusion en rendant public l’échange de courriels litigieux.
54 La Commission conteste ces arguments.
55 L’article 12 du statut prévoit que « le fonctionnaire s’abstient de tout acte et de tout comportement qui puissent porter atteinte à la dignité de sa fonction ».
56 Selon une jurisprudence constante, l’article 12 du statut constitue l’une des expressions spécifiques de l’obligation fondamentale de loyauté et de coopération du fonctionnaire à l’égard de l’Union et de ses supérieurs. Ce devoir comporte, au premier chef, l’obligation pour le fonctionnaire de s’abstenir de conduites attentatoires à la dignité de la fonction et au respect dû à l’Union. Ainsi, il doit notamment faire preuve, d’autant plus s’il a un grade élevé, d’un comportement au-dessus de tout soupçon, afin que les liens de confiance existant entre l’Union et lui-même soient toujours préservés. Ces dispositions constituent en définitive les piliers de la déontologie de la fonction publique européenne (voir arrêt du 24 novembre 2021, CX/Commission, T‑743/16 RENV II, non publié, EU:T:2021:824, point 128 et jurisprudence citée).
57 Ces règles, qui expriment les devoirs et responsabilités qui pèsent sur la fonction publique européenne, trouvent leur justification dans les missions d’intérêt général dont l’Union est chargée, impliquant que les citoyens de l’Union et les États membres doivent pouvoir avoir confiance dans le fait que les institutions, par l’entremise de leurs fonctionnaires et agents, veillent au bon accomplissement desdites missions. Ainsi, de telles obligations sont destinées principalement à préserver la relation de confiance qui doit exister entre l’Union et ses fonctionnaires ou agents (voir arrêt du 24 novembre 2021, CX/Commission, T‑743/16 RENV II, non publié, EU:T:2021:824, point 129 et jurisprudence citée).
58 Compte tenu de l’importance de la relation de confiance existant entre l’Union et le fonctionnaire en ce qui concerne tant le fonctionnement intérieur de l’Union que son image à l’extérieur, et au vu de la généralité des termes de l’article 12 du statut, celui-ci couvre toute circonstance ou tout comportement dont le fonctionnaire doit raisonnablement comprendre, au vu de son grade et des fonctions qu’il exerce ainsi que des circonstances propres de l’affaire, qu’il est de nature à apparaître, aux yeux des tiers, comme étant susceptible de provoquer une confusion quant aux intérêts poursuivis par l’Union qu’il est censé servir (voir arrêt du 24 novembre 2021, CX/Commission, T‑743/16 RENV II, non publié, EU:T:2021:824, point 130 et jurisprudence citée).
59 Ainsi, par leur comportement, les fonctionnaires et agents de l’Union doivent présenter une image de dignité conforme à la conduite particulièrement correcte et respectueuse qu’il est légitime d’attendre des membres du personnel d’une organisation publique internationale (voir arrêt du 24 novembre 2021, CX/Commission, T‑743/16 RENV II, non publié, EU:T:2021:824, point 131 et jurisprudence citée).
60 Le respect dû par le fonctionnaire à la dignité de sa fonction ne se limite pas au moment particulier où il exerce telle ou telle tâche spécifique, mais s’impose à lui en toute circonstance (voir arrêt du 19 mai 1999, Connolly/Commission, T‑34/96 et T‑163/96, EU:T:1999:102, point 130 et jurisprudence citée). À cet égard, il convient de préciser que, s’il est vrai que les faits de la vie privée ne peuvent pas, en règle générale, justifier des sanctions disciplinaires, ils peuvent néanmoins faire l’objet d’une procédure disciplinaire lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la dignité des fonctions du fonctionnaire (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 1988, M./Conseil, 175/86 et 209/86, EU:C:1988:180, point 23).
61 Il résulte de la jurisprudence citée aux points 56 à 60 ci-dessus que, dans le cas où le fonctionnaire, tout en agissant dans un cadre privé, est identifiable comme étant un membre du personnel d’une institution et assume un comportement qui, compte tenu du contexte dans lequel il a été réalisé, peut être considéré comme inapproprié et créer une confusion entre les intérêts privés qu’il entend poursuivre par ce comportement et ceux poursuivis par l’Union qu’il est censé servir, ce comportement peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire lorsqu’il est de nature à dégrader la relation de confiance existant entre l’Union et le fonctionnaire, en pouvant constituer un manquement aux obligations découlant de l’article 12 du statut.
62 En l’espèce, il est constant entre les parties que l’échange de courriels litigieux a eu lieu en dehors du cadre de travail de la Commission et que le requérant n’a pas utilisé son courriel professionnel pour s’adresser à l’ambassadeur polonais. Les parties sont toutefois en désaccord sur le caractère inapproprié de l’échange de courriels litigieux, sur la confusion créée par cet échange entre les intérêts privés du requérant et ceux poursuivis par l’Union ainsi que, par conséquent, sur l’atteinte à la relation de confiance existant entre l’Union et le fonctionnaire.
63 En premier lieu, en ce qui concerne le caractère inapproprié de l’échange de courriels litigieux, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que les termes employés par le requérant dans cet échange sont dénués de toute ambiguïté quant à leur caractère hostile et irrespectueux.
64 En effet, d’une part, les propos du requérant sont très vagues et non circonstanciés, dans la mesure où, tout en faisant référence aux « récents évènements en Pologne », aux « activités antieuropéennes et prorusses » et au fait que l’ambassadeur polonais « prêt[e] [son] nom à la destruction de la démocratie et des médias libres », il ne précise pas le rôle que cet ambassadeur aurait joué dans ces évènements ni d’ailleurs de quels évènements il s’agit. En outre, tout en affirmant que la phrase « vos activités ici à Bruxelles ne seront certainement pas oubliées » est une référence au fait que les prises de position du gouvernement polonais ont été relayées à Bruxelles par l’ambassadeur polonais dans l’espace public, le requérant n’a indiqué aucune prétendue déclaration concrète faite par l’ambassadeur polonais au sujet des « récents évènements en Pologne » ou tout autre méfait dont ce dernier serait à l’origine. Le requérant a également confirmé, lors de l’audience de plaidoiries, avoir visé cet ambassadeur seulement en sa qualité de représentant du gouvernement polonais.
65 Ainsi, ces propos, non étayés par la moindre indication d’une base factuelle concernant l’ambassadeur polonais, montrent une attitude du requérant à l’égard de ce dernier ouvertement hostile qui va bien au-delà d’une critique pondérée.
66 D’autre part, il convient de relever que le ton employé par le requérant dans l’échange de courriels litigieux n’est pas conforme à la déférence due à un professionnel dans l’exercice de ses fonctions. En effet, ce ton est irrespectueux en ce qu’il véhicule de manière péremptoire des accusations non étayées qui mettent en cause le travail de l’ambassadeur polonais dans l’exercice de ses fonctions.
67 Il s’ensuit que c’est à juste titre que la Commission a estimé que le contenu et le ton de l’échange de courriels litigieux n’étaient pas appropriés.
68 En deuxième lieu, en ce qui concerne la confusion d’intérêts, il convient de relever, à l’instar du requérant, qu’il ne ressort pas de l’échange de courriels litigieux qu’il aurait expressément affirmé écrire au nom ou pour le compte de la Commission.
69 Toutefois, si le requérant n’a certes pas mentionné sa qualité de fonctionnaire de la Commission, il n’a pas non plus pris de précautions pour circonscrire la portée de ses courriels. Ainsi, dans le premier courriel, il n’a pas précisé, par exemple, qu’il entendait partager, en tant que citoyen polonais et belge, une opinion personnelle sur l’une ou l’autre question ayant trait à la situation de la Pologne. En effet, aucune référence à l’une ou l’autre citoyenneté n’apparaît dans ce texte. Par ailleurs, dans le premier courriel, les termes « [i]ci, à Bruxelles, vous prêtez votre nom à la destruction de la démocratie et des médias libres » et « [j]e voudrais vous assurer que vos activités ici à Bruxelles ne seront certainement pas oubliées » permettaient de comprendre que le requérant était basé à Bruxelles. Dans ce contexte, le requérant ne saurait reprocher à l’ambassadeur polonais d’avoir mené ses propres recherches sur son identité et d’avoir fait le lien avec ses fonctions à la Commission.
70 En outre, le requérant n’a pas non plus jugé utile de préciser clairement, dans sa réponse au deuxième courriel dans lequel l’ambassadeur polonais avait identifié ses fonctions au sein de la Commission, qu’il y avait eu une incompréhension concernant la qualité en laquelle il écrivait et qu’il n’entendait pas s’exprimer en tant que fonctionnaire de la Commission. En effet, dans le troisième courriel, après avoir remercié l’ambassadeur polonais pour sa « préoccupation concernant la Commission », le requérant a fait une référence sibylline au fait que la « Commission se débrouillera », ce qui a accentué la confusion d’intérêts au lieu de la dissiper. Enfin, au vu de son grade élevé, à savoir AD 8, et de son expérience de onze années au sein de la Commission, le requérant ne pouvait pas ignorer que, compte tenu du contexte politique particulièrement sensible et du rôle joué par cette institution dans ce contexte, il devait agir avec circonspection, dès lors que ses propos pouvaient être interprétés comme provenant de la part d’un fonctionnaire de la Commission et comme allant au-delà de la simple opinion personnelle exprimée uniquement en sa qualité de citoyen.
71 Au vu de ces éléments, il convient de considérer que le comportement du requérant a été de nature à apparaître, aux yeux de l’ambassadeur polonais, comme étant susceptible de provoquer une confusion quant aux intérêts poursuivis par l’Union qu’il est censé servir.
72 En troisième lieu, en ce qui concerne l’atteinte à la relation de confiance existant entre l’Union et le requérant, il y a lieu de relever, à l’instar de la Commission, que le comportement du requérant a pu affecter l’image de l’Union à l’extérieur, c’est-à-dire l’image de conduite particulièrement correcte et respectueuse qu’il est légitime d’attendre des membres de son personnel à l’égard notamment d’un représentant permanent d’un État membre, tel que l’ambassadeur polonais.
73 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que c’est à juste titre que la Commission a pu considérer que le comportement du requérant dans le cadre de l’échange de courriels litigieux constituait un manquement aux obligations découlant de l’article 12 du statut.
74 Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme non fondé.
c) Sur le troisième moyen, tiré de la violation du droit à la liberté d’expression
75 Le requérant fait valoir que la Commission a méconnu son droit à la liberté d’expression, prévu à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), à l’article 17 bis du statut ainsi qu’à l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).
76 Le requérant prétend que la décision attaquée constitue une ingérence non justifiée dans son droit à la liberté d’expression, puisqu’il a écrit à l’ambassadeur polonais depuis son adresse électronique personnelle en sa qualité de citoyen polonais et belge pour contribuer au débat politique concernant la situation en Pologne. En outre, selon le requérant, l’ambassadeur polonais étant un personnage public qui s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes par les journalistes et les citoyens, son droit à la liberté d’expression était renforcé.
77 La Commission conteste ces arguments.
78 Il importe de relever que les institutions, les organes et les organismes de l’Union sont tenus de respecter les droits fondamentaux garantis par le droit de l’Union (voir arrêt du 7 septembre 2022, DD/FRA, T‑470/20, non publié, EU:T:2022:511, point 85 et jurisprudence citée).
79 L’article 11, premier alinéa, de la Charte, intitulé « Liberté d’expression et d’information », dispose ce qui suit :
« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. »
80 En outre, l’article 52, paragraphe 1, de la Charte prévoit ce qui suit :
« Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la [...] Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. »
81 Il résulte de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte que, pour être tenue pour conforme au droit de l’Union, une limitation à un droit protégé par la Charte doit, en tout état de cause, répondre à trois conditions. Premièrement, la limitation doit être « prévue par la loi ». En d’autres termes, la mesure dont il s’agit doit avoir une base légale. Deuxièmement, la limitation doit viser un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union. Troisièmement, la limitation ne doit pas être excessive. D’une part, elle doit être nécessaire et proportionnelle au but recherché. D’autre part, le « contenu essentiel », c’est-à-dire la substance, du droit ou de la liberté en cause ne doit pas être atteint (voir arrêt du 7 septembre 2022, DD/FRA, T‑470/20, non publié, EU:T:2022:511, point 88 et jurisprudence citée).
82 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, les fonctionnaires et agents de l’Union jouissent du droit à la liberté d’expression, y compris dans les domaines couverts par l’activité des institutions de l’Union (voir arrêt du 7 septembre 2022, DD/FRA, T‑470/20, non publié, EU:T:2022:511, point 89 et jurisprudence citée).
83 En l’espèce, il importe de souligner que la Commission n’a pas reproché au requérant le fait d’avoir écrit à l’ambassadeur polonais pour formuler des critiques. Ce n’est donc pas le fait de s’être adressé à cet ambassadeur en son nom propre pour exprimer son mécontentement que la Commission reproche au requérant, mais bien la façon dont il a exprimé ses propos dans l’échange de courriels litigieux. Dès lors que, ce faisant, la Commission n’a pas cherché à limiter la possibilité pour le requérant de s’adresser à l’ambassadeur polonais pour lui faire part de ses critiques, il ne saurait lui être valablement reproché d’avoir voulu empêcher, de manière absolue, le requérant d’exercer son droit à la liberté d’expression (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2022, DD/FRA, T‑470/20, non publié, EU:T:2022:511, point 90).
84 En tout état de cause, il convient de constater que les obligations découlant de l’article 12 du statut constituent des restrictions légitimes à l’exercice du droit à la liberté d’expression (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2022, DD/FRA, T‑470/20, non publié, EU:T:2022:511, point 92).
85 En effet, selon une jurisprudence constante, la liberté d’expression est susceptible de faire l’objet des limitations énoncées à l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH, aux termes duquel l’exercice de cette liberté, comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (voir arrêt du 7 septembre 2022, DD/FRA, T‑470/20, non publié, EU:T:2022:511, point 93 et jurisprudence citée).
86 Il y a lieu de relever que l’article 17 bis, paragraphe 1, du statut reconnaît que le fonctionnaire a droit à la liberté d’expression, dans le strict respect des principes de loyauté et d’impartialité. La jurisprudence a établi qu’il était légitime de soumettre les fonctionnaires, en raison de leur statut, à des obligations telles que celles figurant à l’article 12 du statut, qui étaient ainsi « prévues par une loi », conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH, et poursuivaient le but légitime de protéger les intérêts de l’Union. Ces obligations constituent certes des restrictions à l’exercice de la liberté d’expression et sont destinées à préserver la relation de confiance qui doit exister entre l’institution et ses fonctionnaires et peuvent trouver leur justification dans le but légitime de protéger les droits d’autrui au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH (voir arrêt du 7 septembre 2022, DD/FRA, T‑470/20, non publié, EU:T:2022:511, point 94 et jurisprudence citée).
87 Telle qu’exprimée par la jurisprudence, la restriction imposée à la liberté d’expression par des obligations telles que celles dont la base légale est constituée par l’article 12 du statut poursuit le but légitime de protéger les intérêts de l’Union, et en particulier de préserver la relation de confiance qui doit exister entre une institution et ses fonctionnaires (arrêt du 7 septembre 2022, DD/FRA, T‑470/20, non publié, EU:T:2022:511, point 96).
88 Cette limitation ne saurait être considérée comme excessive. Au contraire, en l’espèce, le contenu essentiel de la liberté d’expression a été respecté dans la mesure où le requérant demeurait en mesure d’exprimer librement ses opinions à l’ambassadeur polonais, en exposant ses propos de manière appropriée (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2022, DD/FRA, T‑470/20, non publié, EU:T:2022:511, point 97).
89 Cette conclusion n’est d’ailleurs pas remise en cause par le fait que, selon la jurisprudence de la Cour EDH, l’ambassadeur polonais étant un personnage public qui s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes par les journalistes et les citoyens, le droit à la liberté d’expression du requérant était renforcé. En effet, indépendamment de la question de savoir si ledit ambassadeur peut être considéré comme un personnage public ou plutôt un haut fonctionnaire, comme le soutient la Commission, la jurisprudence de la Cour EDH a précisé que, en tous les cas, les propos formulés à l’égard de ces personnes devaient rester dans les limites acceptables de la liberté d’expression.
90 D’une part, en ce qui concerne la liberté journalistique, la Cour EDH a jugé, au regard des personnages publics, que des accusations se fondant sur une présentation déformée de la réalité, dépourvue de toute base factuelle, devaient être considérées comme franchissant les limites acceptables de la liberté d’expression (Cour EDH, 14 octobre 2008, Petrina c. Roumanie, CE:ECHR:2008:1014JUD007806001, § 48 et 49). D’autre part, la Cour EDH a considéré que les propos adressés à de hauts fonctionnaires relevaient de la restriction à la liberté d’expression lorsque, du fait de leur gravité et de leur ton, et en l’absence de tout élément factuel ou commencement de preuve à leur appui, ils constituaient des attaques personnelles gratuites qui étaient consignées dans des documents écrits ayant été mûrement réfléchis (voir, en ce sens, Cour EDH, 14 mars 2002, Diego Nafría c. Espagne, CE:ECHR:2002:0314JUD004683399, § 40 et 41).
91 Or, ainsi qu’il a été relevé aux points 64 à 67 ci-dessus, au regard du ton irrespectueux et de l’absence de base factuelle des propos du requérant concernant les activités de l’ambassadeur polonais, le requérant s’est en réalité livré, par écrit et à son initiative, à des attaques personnelles gratuites à l’égard de l’ambassadeur polonais.
92 Par conséquent, en considérant que le comportement du requérant, dans le cadre de l’échange de courriels litigieux, pouvait constituer une violation des obligations découlant de l’article 12 du statut, la Commission n’a pas porté illégitimement atteinte à la liberté d’expression de celui-ci et l’exigence de légalité stricte, prévue à l’article 52 de la Charte, a été respectée (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2022, DD/FRA, T‑470/20, non publié, EU:T:2022:511, point 98).
93 Le troisième moyen doit donc être rejeté comme non fondé.
d) Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des articles 10 et 22 de l’annexe IX du statut
94 Le présent moyen est divisé en deux branches.
95 Le Tribunal estime opportun de traiter d’abord la seconde branche du quatrième moyen, en ce qu’elle vise essentiellement l’illégalité externe de la décision attaquée.
1) Sur la seconde branche du quatrième moyen
96 Par la seconde branche du quatrième moyen, premièrement, le requérant fait valoir que la décision attaquée méconnaît l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut, au motif qu’elle ne précise pas suffisamment les raisons pour lesquelles l’AIPN tripartite s’est départie de l’avis du conseil de discipline en ce qui concerne la pondération des circonstances aggravantes et atténuantes ainsi que le choix de la sanction.
97 Deuxièmement, le requérant ajoute que, le 18 juillet 2022, il a été débouté, par la même AIPN que celle qui est ensuite intervenue dans la procédure disciplinaire, d’une demande d’assistance introduite sur le fondement de l’article 24 du statut, visant l’ouverture d’une enquête sur la couverture médiatique de l’échange de courriels litigieux. Le requérant fait valoir à cet égard qu’il ne comprend pas les raisons sous-tendant la décision de rejet de la demande d’assistance portant sur la couverture médiatique de l’échange de courriels litigieux, alors qu’une enquête à ce sujet aurait pu apporter des éclaircissements sur le contexte politique de cet échange et avoir donc un impact sur la décision attaquée. Le requérant en déduit que, étant donné que l’AIPN ayant rejeté cette demande avait un parti pris sur cet échange de courriels, elle ne pouvait pas être impartiale au cours des étapes de la procédure disciplinaire postérieures à cette décision.
98 Le 25 avril 2025, le requérant a en outre présenté une seconde offre de preuve à ce sujet, à savoir des captures d’écran reproduisant des messages de la directrice générale HR publiés sur son compte du réseau social X, dont il affirme avoir pris connaissance le 21 janvier 2025, après la clôture de la phase écrite de la procédure. Selon le requérant, ces messages font état de plusieurs réunions tenues avec l’ambassadeur polonais, manifestement plus fréquentes qu’avec d’autres représentants permanents et dont le calendrier est « troublant », au regard de celui de la procédure disciplinaire en cause.
99 La Commission conteste ces arguments.
100 S’agissant de la prétendue insuffisance de motivation de la décision attaquée au sujet des raisons ayant conduit l’AIPN tripartite à s’écarter de l’avis du conseil de discipline, il convient de rappeler que l’obligation de motivation vise, d’une part, à fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, d’autre part, à permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte. Le caractère suffisant de la motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi du contexte factuel et juridique dans lequel s’inscrit l’adoption de l’acte attaqué. Ainsi, la motivation de la décision infligeant une sanction disciplinaire à un fonctionnaire doit indiquer de manière précise les faits retenus à la charge de l’intéressé ainsi que les considérations qui ont amené l’AIPN à adopter la sanction choisie (voir arrêt du 19 avril 2023, OQ/Commission, T‑162/22, non publié, EU:T:2023:205, point 90 et jurisprudence citée).
101 Il ressort également de la jurisprudence que l’AIPN dispose du pouvoir de procéder à une appréciation de la responsabilité du fonctionnaire différente de celle portée par le conseil de discipline ainsi que de choisir, par la suite, la sanction disciplinaire qu’elle estime adéquate pour sanctionner les fautes disciplinaires retenues. Dans l’hypothèse où la sanction infligée serait plus sévère que celle suggérée par le conseil de discipline, la décision devrait préciser de façon circonstanciée les motifs qui ont conduit ladite autorité à s’écarter de l’avis émis par ce conseil (voir arrêt du 19 avril 2023, OQ/Commission, T‑162/22, non publié, EU:T:2023:205, point 91 et jurisprudence citée).
102 S’agissant de la possibilité pour l’institution de préciser ou de modifier sa motivation au stade de la réponse à la réclamation, il résulte d’une jurisprudence constante, également applicable en matière disciplinaire, d’autant plus qu’il s’agit d’un domaine dans lequel le conseil de discipline ou l’AIPN n’ont pas l’obligation de discuter tous les points de fait et de droit qui ont été soulevés par l’intéressé au cours de la procédure disciplinaire, que le complément de motivation, au stade de la décision de rejet de la réclamation, est conforme à la finalité de l’article 90, paragraphe 2, du statut, aux termes duquel la décision sur la réclamation est elle-même motivée et implique nécessairement que l’AIPN, amenée à statuer sur les arguments de fait et de droit présentés au soutien de la réclamation, ne soit pas liée par la seule motivation, le cas échéant insuffisante, voire inexistante, de la décision faisant l’objet de la réclamation (voir arrêt du 10 juin 2016, HI/Commission, F‑133/15, EU:F:2016:127, point 98 et jurisprudence citée).
103 En l’espèce, outre le fait que le contexte factuel était largement connu du requérant, comme en témoignent les observations formulées par ce dernier au cours de l’enquête de l’IDOC, puis dans le cadre de la procédure disciplinaire, il convient de constater que l’AIPN compétente a fourni une motivation circonstanciée et étoffée tant dans la décision attaquée que dans la décision de rejet de la réclamation, et ce à l’égard des différents arguments que le requérant avait soulevés au cours de la procédure disciplinaire. L’AIPN s’est également expliquée de manière circonstanciée sur les raisons pour lesquelles elle retenait ou non certaines circonstances comme étant atténuantes ou aggravantes et estimait nécessaire d’infliger une sanction plus sévère que celle recommandée par le conseil de discipline (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2016, HI/Commission, F‑133/15, EU:F:2016:127, point 99).
104 En effet, en premier lieu, après avoir rappelé, aux points 15 à 22 de la décision attaquée, l’appréciation contenue dans l’avis du conseil de discipline, l’AIPN tripartite a précisé, aux points 23, 27 et 28 de ladite décision, tout d’abord, qu’elle partageait le point de vue de ce conseil selon lequel les termes et le ton utilisés par le requérant dans les courriels litigieux étaient déplacés et donc inappropriés, d’autant plus qu’ils étaient adressés, de manière non sollicitée, à un haut représentant d’un État membre auprès de l’Union ayant des contacts réguliers avec la Commission. Ensuite, à l’instar du conseil de discipline, elle a considéré qu’il n’y avait pas de violation des articles 11 et 17 bis du statut. Enfin, elle a précisé que, contrairement au conseil de discipline, elle était d’avis que la circonstance selon laquelle il avait envoyé ces courriels en tant que citoyen ne pouvait pas être prise en considération, dès lors qu’il était facilement identifiable comme étant un fonctionnaire de la Commission et qu’il n’avait pas pris ses distances en tant que fonctionnaire, notamment, dans le troisième courriel.
105 En deuxième lieu, aux points 29 et 30 de la décision attaquée, l’AIPN tripartite a expliqué que, contrairement à l’avis du conseil de discipline, deux circonstances aggravantes devaient être retenues, à savoir l’attitude du requérant pendant la procédure disciplinaire ainsi que son ancienneté et son expérience professionnelle et que, pour cette raison, elle considérait qu’une sanction de nature morale, comme celle proposée par le conseil de discipline, n’était pas proportionnée. Au point 31 de la décision attaquée, l’AIPN tripartite a également précisé que, contrairement audit conseil, elle estimait que le fait que les courriels litigieux n’étaient ni insultants ni vulgaires et que le requérant les avait envoyés depuis son adresse électronique personnelle ne pouvait pas constituer une circonstance atténuante et que, si tel avait été le cas, la sanction aurait pu être plus sévère.
106 En troisième lieu, au point 32 de la décision attaquée, l’AIPN tripartite a analysé toutes les circonstances prévues par l’article 10 de l’annexe IX du statut, en tenant compte de l’ensemble des considérations exposées aux points 104 et 105 ci-dessus, y compris celles résultant de son opinion divergente par rapport au conseil de discipline, notamment en ce qui concernait les circonstances aggravantes.
107 En dernier lieu, l’AIPN compétente a, dans la décision de rejet de la réclamation, exhaustivement répondu à tous les griefs soulevés par le requérant dans sa réclamation, notamment à ceux concernant l’appréciation différente des circonstances atténuantes effectuée par l’AIPN tripartite par rapport à celle du conseil de discipline.
108 À cet égard, il convient de relever que la décision de rejet de la réclamation précise, aux points 124 à 129, les raisons pour lesquelles l’AIPN tripartite s’est écartée de l’appréciation contenue dans les points 46 à 49 de l’avis du conseil de discipline au sujet des circonstances atténuantes. Tout d’abord, elle fait notamment état du fait que le conseil de discipline est en réalité parvenu à la même conclusion que l’AIPN tripartite quant au caractère intentionnel du comportement reproché au requérant. Ensuite, l’absence de caractère menaçant ou insultant des propos du requérant a été prise en considération par l’AIPN tripartite, mais seulement en ce sens que, si tel avait été le cas, la sanction aurait été encore plus sévère. En outre, le constat du conseil de discipline selon lequel le comportement du requérant a eu des effets très limités sur l’intégrité, la réputation et les intérêts des institutions était inopérant, en ce qu’il concernait la violation de l’article 11 du statut. Enfin, le conseil de discipline n’a pas affirmé que le requérant avait agi dans l’intérêt de l’Union et de la République de Pologne, ce conseil ayant simplement repris une allégation du requérant en ce sens.
109 Dans ces circonstances, il convient de constater que les raisons pour lesquelles l’AIPN tripartite s’est écartée de l’avis du conseil de discipline et a décidé d’infliger au requérant une sanction plus sévère découlent suffisamment de la décision attaquée, lue à la lumière de la décision de rejet de la réclamation.
110 La circonstance selon laquelle cette motivation ne convainc pas le requérant, qui la conteste au fond, n’implique aucunement que l’AIPN tripartite a méconnu l’obligation de motivation (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2023, OQ/Commission, T‑162/22, non publié, EU:T:2023:205, point 102).
111 Le premier grief de la seconde branche du quatrième moyen doit donc être rejeté comme non fondé.
112 Pour ce qui est du prétendu défaut d’impartialité de l’AIPN, il suffit de constater que ce grief manque en fait. En effet, le requérant s’appuie sur la circonstance selon laquelle l’AIPN qui avait rejeté sa demande d’assistance et qui faisait partie de l’AIPN tripartite ayant adopté la décision attaquée était la directrice générale HR. Or, ainsi qu’il ressort incontestablement de la décision de rejet de la demande d’assistance du 18 juillet 2022, versée en tant qu’annexe A.26 de la requête, celle-ci a été adoptée par le directeur de la direction « Affaires financières, juridiques et partenariats » de la DG « Ressources humaines et sécurité » de la Commission, lequel n’a pas siégé en tant qu’AIPN tripartite lors de l’adoption de la décision attaquée. Ainsi qu’il ressort de l’annexe A.2 de la requête, cette AIPN était en effet composée de la directrice générale HR, de la directrice générale faisant fonction pour la mobilité et les transports et de la directrice générale pour le commerce. En outre, force est de constater que le requérant reste en défaut de présenter la moindre preuve sur l’implication du directeur de la direction « Affaires financières, juridiques et partenariats » de la DG « Ressources humaines et sécurité » dans la procédure disciplinaire ayant mené à l’adoption de la décision attaquée.
113 Lors de l’audience de plaidoiries, le requérant a précisé que l’impartialité de ce directeur était douteuse, puisqu’il existait un lien de subordination par rapport à la directrice générale HR. À cet égard, le Tribunal relève que le requérant n’a pas apporté la moindre preuve que ce lien de subordination a pu vicier, en l’espèce, la décision de rejet de la demande d’assistance. En outre, à la supposer établie, cette violation du principe d’impartialité aurait éventuellement pu affecter seulement cette dernière décision. Or, celle-ci ne faisant pas l’objet du présent recours et étant devenue par ailleurs définitive, cet argument est, dans tous les cas, inopérant.
114 Le second grief de la seconde branche du quatrième moyen doit dès lors être rejeté comme non fondé.
115 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la seconde offre de preuve présentée par le requérant le 25 avril 2025. En effet, les messages de la directrice générale HR sur son compte X, qui datent du 24 mai 2022, du 19 juillet 2023 et du 15 septembre 2023, montrent seulement que celle-ci a rencontré l’ambassadeur polonais dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
116 En particulier, le message du 24 mai 2022 mentionne une rencontre avec les représentants permanents de l’Irlande, de la République de Pologne, de la République portugaise et de la République de Finlande, en présence également d’un secrétaire d’État du Portugal, au sujet de la représentation équilibrée du personnel de la Commission. Le message du 19 juillet 2023, en plus d’être postérieur à la décision attaquée, mentionne une réunion hébergée par la représentation permanente de la Pologne au sujet de la représentation de toutes les nationalités de l’Union au sein de la direction de la Commission. Le message du 15 septembre 2023, lui aussi postérieur à l’adoption de la décision attaquée, cite la conclusion d’un plan d’action conjoint sur l’équilibre géographique avec la République de Pologne ayant pour but de renforcer la présence de ressortissants polonais au sein de la Commission. En outre, tout en affirmant que les rencontres de la directrice générale HR avec l’ambassadeur polonais sont « manifestement plus fréquentes qu’avec d’autres représentants permanents », le requérant reste en défaut d’apporter la moindre preuve à ce sujet. En effet, le requérant n’explique nullement quelle est la fréquence avec laquelle la directrice générale HR aurait rencontré les autres représentants permanents.
117 Ainsi, aucun de ces messages, de nature purement professionnelle, ne prouve l’existence d’un parti pris, d’un préjugé personnel, ou de tout doute légitime quant à un éventuel préjugé de la part de la directrice générale HR qui justifierait un défaut d’impartialité (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2024, Hamers/Cedefop, C‑111/22 P, non publié, EU:C:2024:5, point 47 et jurisprudence citée).
118 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter la seconde branche du quatrième moyen comme non fondée.
2) Sur la première branche du quatrième moyen
119 Par la première branche du quatrième moyen, le requérant fait valoir que la Commission a méconnu l’article 10 de l’annexe IX du statut, en ce que la décision attaquée ne procède pas à une pondération proportionnée des circonstances aggravantes et atténuantes.
120 En premier lieu, en ce qui concerne les circonstances aggravantes, le requérant fait valoir que la décision attaquée tient erronément compte de son attitude pendant la procédure disciplinaire ainsi que de son ancienneté et de son expérience professionnelle.
121 Selon le requérant, d’une part, il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir reconnu le caractère inapproprié de l’échange de courriels litigieux, dès lors que le ton employé était correct et respectable, compte tenu du contexte politique tendu. Le requérant précise en outre que, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, il s’est engagé à ne pas récidiver. En effet, à la question qui lui a été posée de savoir s’il referait la même chose, il aurait répondu qu’il « le ferait différemment, sachant à quel point les droits fondamentaux sont violés au sein de la Commission ». Le requérant prétend également que la décision attaquée tient compte de l’absence d’engagement à ne pas récidiver dans le cadre de l’examen au titre de l’article 10, sous f), de l’annexe IX du statut, alors que cet élément devrait être examiné plutôt au regard de l’article 10, sous h), de cette même annexe. En tout état de cause, selon le requérant, il ressort de la jurisprudence du Tribunal, notamment de l’arrêt du 19 avril 2023, OQ/Commission (T‑162/22, non publié, EU:T:2023:205, point 58), que l’absence de risque de récidive future ne saurait être prise en considération dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la sanction, le fonctionnaire étant, par principe, tenu de s’abstenir de tout comportement qui puisse porter atteinte à la dignité de sa fonction.
122 D’autre part, le requérant relève que, au moment des faits, il n’avait que onze années d’expérience à la Commission et n’occupait pas de fonctions managériales. En outre, le requérant précise que l’appréciation de la circonstance aggravante concernant son ancienneté et son expérience professionnelle est entachée d’une contradiction en ce que la décision attaquée fait état de ce que, au sens de l’article 10, sous h), de l’annexe IX du statut, il n’a fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire dans le passé et de ce que, au regard de l’article 10, sous i), de cette même annexe, sa conduite tout au long de sa carrière a été jugée satisfaisante par la hiérarchie.
123 En second lieu, en ce qui concerne les circonstances atténuantes, le requérant fait valoir que la décision attaquée ne tient pas compte du contexte politique ni du fait qu’il avait fait l’objet d’une campagne de dénigrement en tant que membre de la communauté des personnes lesbiennes, gay, bisexuelles, transgenres ou intersexuées (LGBTI). En outre, il reproche à l’AIPN tripartite d’avoir écarté sa bonne conduite tout au long de sa carrière, au motif qu’il n’y aurait pas de lien entre sa carrière et les faits litigieux. Selon lui, cette appréciation est, d’une part, incohérente avec le fait que la décision attaquée lui reproche de ne pas s’être dissocié de sa qualité de fonctionnaire dans le cadre de l’échange de courriels litigieux et, d’autre part, erronée en droit, en ce que l’article 10, sous i), de l’annexe IX du statut oblige l’AIPN tripartite à prendre en considération la conduite du fonctionnaire tout au long de sa carrière, indépendamment du lien entre cette carrière et les faits litigieux. En outre, le requérant soutient que cette autorité aurait dû tenir compte, en tant que circonstance atténuante, du fait qu’il avait agi dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression.
124 La Commission conteste ces arguments.
125 Premièrement, la Commission fait valoir que c’est sans commettre d’erreur de droit que l’AIPN tripartite a pu prendre en considération les deux circonstances aggravantes mentionnées au point 120 ci-dessus.
126 S’agissant de la première de ces circonstances, à savoir l’attitude du requérant pendant la procédure disciplinaire, la Commission soutient que l’échange de courriels litigieux témoigne d’un comportement non conforme aux obligations statutaires, en ce que les propos étaient déplacés et inappropriés. En outre, elle soutient que le requérant ne s’est pas engagé à ne pas récidiver, celui-ci s’étant limité à accuser son employeur de violer les droits fondamentaux et à faire une allusion à un comportement différent sans pour autant spécifier en quoi consisterait cette différence. Enfin, la Commission fait valoir que l’AIPN tripartite pouvait prendre en considération ladite circonstance au titre de l’article 10 de l’annexe IX du statut, cette disposition ne dressant pas une liste exhaustive de circonstances sur lesquelles cette autorité peut se fonder pour infliger la sanction.
127 En ce qui concerne la seconde circonstance aggravante, la Commission soutient que onze années d’expérience représentent une période significative et que, au vu du grade élevé du requérant à l’époque, à savoir AD 8, il devait adopter un comportement exemplaire. La Commission ajoute que le requérant est un syndicaliste actif et expérimenté au sein du comité du personnel et, de ce fait, il devait avoir une connaissance particulière des droits et des obligations des fonctionnaires de l’Union. En outre, selon la Commission, il n’y aurait pas de contradiction entre cette seconde circonstance aggravante et le fait qu’il n’ait fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire dans le passé et que sa conduite tout au long de sa carrière ait été jugée satisfaisante. En effet, ces deux circonstances ne seraient pas automatiquement atténuantes et, en l’espèce, l’AIPN tripartite a considéré qu’elles ne pouvaient pas atténuer la gravité de son manquement.
128 Deuxièmement, la Commission fait valoir que, en ce qui concerne les circonstances atténuantes, le contexte politique ne saurait exonérer le requérant d’avoir une attitude respectueuse envers les représentants diplomatiques des États membres, d’autant plus que l’échange de courriels litigieux a eu lieu à l’initiative du requérant. Elle ajoute que la bonne conduite du requérant tout au long de sa carrière n’a pas été prise en considération au titre des circonstances atténuantes, puisqu’il n’y a pas de lien entre sa carrière et l’échange de courriels litigieux et, en tout état de cause, puisqu’elle peut décider, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, de ne pas considérer une telle conduite comme étant automatiquement une circonstance atténuante. La Commission soutient que, comme cela est précisé dans le cadre du troisième moyen, le requérant ne saurait invoquer sa liberté d’expression comme circonstance atténuante, d’autant plus que l’ambassadeur polonais est un fonctionnaire et non un homme politique. La Commission conclut en précisant que la sanction infligée au requérant est la plus légère parmi les sanctions financières prévues par l’article 9 de l’annexe IX du statut et que, même à l’échelle de cette sanction de suspension de l’avancement d’échelon, elle se situe dans la moitié inférieure, compte tenu du fait que celle-ci peut aller jusqu’à 23 mois.
129 Avant d’examiner les arguments du requérant, il convient de rappeler que l’article 10 de l’annexe IX du statut dispose ce qui suit :
« La sanction disciplinaire infligée est proportionnelle à la gravité de la faute commise. Pour déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction disciplinaire à infliger, il est tenu compte notamment :
a) de la nature de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise ;
b) de l’importance du préjudice porté à l’intégrité, à la réputation ou aux intérêts des institutions en raison de la faute commise ;
c) du degré d’intentionnalité ou de négligence dans la faute commise ;
d) des motifs ayant amené le fonctionnaire à commettre la faute ;
e) du grade et de l’ancienneté du fonctionnaire ;
f) du degré de responsabilité personnelle du fonctionnaire ;
g) du niveau des fonctions et responsabilités du fonctionnaire ;
h) de la récidive de l’acte ou du comportement fautif ;
i) de la conduite du fonctionnaire tout au long de sa carrière. »
130 Pour apprécier la proportionnalité d’une sanction disciplinaire par rapport à la gravité des faits retenus, le Tribunal doit prendre en considération le fait que la détermination de la sanction est fondée sur une évaluation globale par l’AIPN de tous les faits concrets et des circonstances propres à chaque cas individuel, étant rappelé que le statut ne prévoit pas de rapport fixe entre les sanctions qui y sont indiquées et les différentes catégories de manquements commis par les fonctionnaires et ne précise pas dans quelle mesure l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes doit intervenir dans le choix de la sanction. L’examen du juge de première instance est, dès lors, limité à la question de savoir si la pondération des circonstances aggravantes et atténuantes par l’AIPN a été effectuée de façon proportionnée, étant précisé que, lors de cet examen, ce juge ne saurait se substituer à l’AIPN quant aux jugements de valeur portés à cet égard par celle-ci (voir arrêt du 22 mai 2014, BG/Médiateur, T‑406/12 P, EU:T:2014:273, point 64 et jurisprudence citée).
i) Sur les circonstances aggravantes
131 En ce qui concerne les circonstances aggravantes, à savoir l’attitude du requérant pendant la procédure disciplinaire ainsi que son ancienneté et son expérience professionnelle, il ressort du point 29 et du point 32, sous c), e) et f), de la décision attaquée que celles-ci ont été prises en considération au titre de l’article 10, sous c), e) et f), de l’annexe IX du statut.
132 En premier lieu, en ce qui concerne l’attitude du requérant pendant la procédure disciplinaire, l’AIPN tripartite a précisé, aux points 29 et 32, sous c) et f), de la décision attaquée que le requérant n’avait ni reconnu le caractère inapproprié de l’échange de courriels litigieux ni ne s’était engagé à ne pas récidiver à l’avenir.
133 En particulier, l’AIPN tripartite a relevé, au point 32, sous c), de la décision attaquée que « [le requérant] n’a[vait] ni reconnu ni présenté ses excuses pour les faits survenus en décembre 2021, bien que cette possibilité lui ait été offerte lors de la procédure et notamment lors de l’audition devant le conseil de discipline et l’AIPN tripartite », que, « [a]u lieu de cela, lors de son audition devant l’AIPN tripartite, [le requérant] a[vait] souligné que s’il [devait agir] différemment à l’avenir, ce ne serait que parce qu’il comprenait le fonctionnement de l’IDOC et la manière dont la Commission “censurait” les membres de son personnel ». Au point 32, sous f), de cette même décision, l’AIPN tripartite a relevé que « [le requérant] n’a[vait] fait état, à aucun stade de la procédure, de remords pour ses agissements, ce qui [devait] être considéré comme une circonstance aggravante ».
134 Il convient de relever, à cet égard, que le respect des droits de la défense implique que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir (voir arrêt du 24 mai 2023, AL/Commission, T‑714/21, non publié, EU:T:2023:282, point 16 et jurisprudence citée) et de contester ces éléments, sans qu’une telle contestation puisse constituer une circonstance aggravante. En effet, l’autorité disciplinaire ne saurait imposer au fonctionnaire faisant l’objet d’une procédure disciplinaire l’obligation de fournir des réponses par lesquelles celui-ci serait amené à admettre l’existence du manquement dont il appartient à cette autorité d’établir la preuve (voir, par analogie, arrêt du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, EU:T:1999:80, point 449 et jurisprudence citée).
135 Il en découle que la personne concernée ne saurait être contrainte d’admettre sa propre culpabilité pour qu’une circonstance aggravante ne soit pas retenue. Il en va de même pour l’absence d’engagement à ne pas récidiver à l’avenir. En effet, la personne concernée ne saurait s’engager à ne plus commettre un manquement qu’elle conteste avoir commis, car cela reviendrait à lui imposer de reconnaître le manquement en question. En outre, comme le relève à juste titre le requérant, l’absence d’engagement à ne pas récidiver pour le futur ne saurait constituer une circonstance aggravante, dès lors que, par principe, un fonctionnaire est tenu de s’abstenir de tout comportement qui puisse porter atteinte à la dignité de sa fonction (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2023, OQ/Commission, T‑162/22, non publié, EU:T:2023:205, point 60).
136 Or, en l’espèce, l’AIPN tripartite a clairement pénalisé le requérant pour avoir décidé de contester la qualification juridique des faits liés à l’échange de courriels litigieux, en considérant que, puisqu’il n’avait pas reconnu le caractère inapproprié de cet échange ni ne s’était engagé à ne plus commettre de tels actes, il méritait une sanction plus sévère.
137 Une telle approche constitue une atteinte aux droits de la défense du requérant qui doit être qualifiée d’erreur de droit, de sorte que c’est à tort que l’AIPN tripartite a considéré que l’attitude du requérant pendant la procédure disciplinaire pouvait être qualifiée de circonstance aggravante au titre de l’article 10, sous c) et f), de l’annexe IX du statut.
138 En second lieu, en ce qui concerne l’ancienneté et l’expérience professionnelle du requérant, il ressort du point 29 et du point 32, sous e), de la décision attaquée que celles-ci ont été prises en considération, au titre de l’article 10, sous e), de l’annexe IX du statut. Au point 32, sous e), de cette décision, l’AIPN tripartite a relevé que le requérant était « fonctionnaire titulaire, de grade AD 8, avec plus de 12 ans d’expérience professionnelle à la Commission [et que] ces éléments aggrav[ai]ent [sa] responsabilité ». Au point 103 de la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN compétente a précisé que le requérant avait, au moment des faits, onze années d’expérience.
139 À cet égard, tout d’abord, il convient de constater que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’AIPN tripartite a pu tenir compte de ces éléments au titre des circonstances aggravantes. En effet, les onze années d’expérience du requérant en tant que fonctionnaire qui, au moment des faits, avait atteint un grade élevé, permettaient à l’AIPN tripartite d’exiger de ce dernier plus de prudence et une meilleure connaissance de ce qu’elle considérait être un comportement acceptable de la part du personnel des institutions de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2016, FU/Commission, F‑49/15, EU:F:2016:72, point 128).
140 Ensuite, contrairement à ce qu’affirme le requérant, il ne ressort aucunement de l’article 10, sous e), de l’annexe IX du statut que le grade et l’ancienneté du fonctionnaire peuvent être pris en considération comme circonstance aggravante seulement si le fonctionnaire occupe des fonctions managériales. En effet, le type de fonctions exercées relève plutôt de l’article 10, sous g), de cette annexe, qui concerne le « niveau des fonctions et responsabilités du fonctionnaire ».
141 Enfin, la décision attaquée n’est pas entachée d’une contradiction en ce qu’elle précise, au titre de l’article 10, sous h), de l’annexe IX du statut, que le requérant n’a fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire dans le passé et, au regard de l’article 10, sous i), de cette même annexe, que sa conduite tout au long de sa carrière a été jugée satisfaisante par la hiérarchie. En effet, ces deux derniers critères visent, comme leurs intitulés l’indiquent, des aspects de la carrière du fonctionnaire qui ne sont pas nécessairement liés à son grade ou à son ancienneté. D’une part, l’article 10, sous h), de l’annexe IX du statut vise à établir si le fonctionnaire a déjà accompli le même acte ou a déjà eu le même comportement fautif que celui qui lui est reproché dans le cadre de la procédure disciplinaire, ce qui n’a aucun lien avec son grade ou son ancienneté. D’autre part, l’article 10, sous i), de cette même annexe, permet à l’AIPN d’apprécier, aux fins du choix de la sanction, la conduite du fonctionnaire dans sa globalité, indépendamment du grade et de l’ancienneté que le fonctionnaire possédait au moment des faits qui lui sont reprochés.
142 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure, d’une part, que la Commission a commis une erreur de droit en retenant comme circonstance aggravante l’attitude du requérant pendant la procédure disciplinaire au titre de l’article 10, sous c) et f), de l’annexe IX du statut et, d’autre part, que c’est à juste titre qu’elle a tenu compte de l’ancienneté et de l’expérience professionnelle du requérant comme circonstance aggravante au titre de l’article 10, sous e), de l’annexe IX du statut.
ii) Sur les circonstances atténuantes
143 En ce qui concerne les circonstances atténuantes, tout d’abord, le requérant fait valoir, en substance, que la décision attaquée ne tient pas compte du contexte politique ni du fait qu’il avait fait l’objet d’une campagne de dénigrement en tant que membre de la communauté LGBTI. Ensuite, le requérant reproche à la Commission d’avoir écarté sa bonne conduite tout au long de sa carrière, au motif qu’il n’y aurait pas de lien entre sa carrière et les faits litigieux. Enfin, le requérant soutient que la Commission aurait dû tenir compte du fait qu’il avait agi dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression.
144 En ce qui concerne l’exercice du droit à la liberté d’expression du requérant, il convient de rejeter cet argument pour les motifs relevés aux points 78 à 93 ci-dessus.
145 Ensuite, pour ce qui est du contexte politique et du dénigrement du requérant en tant que membre de la communauté LGBTI, il convient de relever qu’il ne ressort pas du dossier dont dispose le Tribunal que l’ambassadeur polonais ait jamais fait de déclarations sur le requérant, sur la communauté LGBTI ni même sur les actions dont le requérant l’accuse dans l’échange de courriels litigieux. Ce dernier se limite en effet à produire, en tant qu’annexe A.6 à la requête, des articles de presse tirés du journal Le Monde et des tweets écrits par certains membres de la Commission concernant le non-respect par la République de Pologne des droits fondamentaux, lesquels ne citent toutefois aucunement l’ambassadeur polonais, ni d’ailleurs le requérant lui-même. Enfin, ainsi qu’il a été relevé au point 70 ci-dessus, c’est précisément en raison du contexte politique sensible en Pologne et du rôle joué par la Commission dans ce contexte que le requérant aurait dû agir avec circonspection, dès lors que ses propos pouvaient être interprétés comme provenant de la part d’un fonctionnaire de la Commission et comme allant au-delà de la simple opinion personnelle exprimée uniquement en sa qualité de citoyen.
146 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’AIPN tripartite a écarté le contexte politique et le dénigrement du requérant en tant que membre de la communauté LGBTI comme circonstance atténuante.
147 Enfin, s’agissant de l’absence de prise en compte de la bonne conduite du requérant tout au long de sa carrière, il convient de relever que la décision attaquée précise, au point 32, sous i), que « la conduite [du requérant] tout au long de sa carrière a été jugée satisfaisante par la hiérarchie » et que « [l]’AIPN tripartite relève que les faits qui font l’objet de la présente procédure ne sont pas liés aux fonctions [du requérant] et ne la considère pas comme une circonstance atténuante ».
148 Il y a lieu de constater, à cet égard, que les actes reprochés au requérant n’ont pas été commis dans l’exécution des tâches relevant de ses fonctions, qu’ils n’ont pas eu d’impact négatif sur la qualité du travail qu’il a fourni et que l’AIPN tripartite n’était pas tenue de prendre en considération la bonne conduite de ce dernier tout au long de la carrière comme une circonstance atténuante (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2023, OQ/Commission, T‑162/22, non publié, EU:T:2023:205, point 55). En effet, cette autorité pouvait légitimement considérer que, eu égard aux circonstances du cas d’espèce et au fait qu’il était reproché au requérant d’avoir porté atteinte à la dignité de sa fonction, sa conduite « satisfaisante » ne permettait pas d’atténuer la sanction infligée (voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2014, BG/Médiateur, T‑406/12 P, EU:T:2014:273, point 76).
149 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que c’est à juste titre que l’AIPN tripartite a écarté les circonstances atténuantes invoquées par le requérant.
iii) Conclusion sur la pondération des circonstances aggravantes et atténuantes
150 Il convient de constater que, en l’espèce, la prise en compte par l’AIPN tripartite de la circonstance aggravante tirée de l’attitude du requérant pendant la procédure disciplinaire a pu jouer, au détriment de ce dernier, dans le choix de la sanction. En effet, il ne peut pas être exclu que, si l’AIPN tripartite avait écarté cette circonstance, la sanction disciplinaire infligée aurait été moins sévère.
151 Par conséquent, il convient d’annuler la décision attaquée, pour autant que, dans le cadre de son appréciation des circonstances à prendre en considération au titre de l’article 10 de l’annexe IX du statut, l’AIPN tripartite s’est erronément fondée sur l’attitude du requérant pendant la procédure disciplinaire comme circonstance aggravante.
2. Sur les conclusions indemnitaires
152 Le requérant soutient avoir subi, en raison de la décision attaquée, un préjudice d’ordre physique et moral qu’il estime à hauteur de 50 000 euros.
153 Pour ce qui est du préjudice physique, le requérant prétend avoir subi un « stress important » en raison de la procédure disciplinaire ayant débouché sur la sanction disciplinaire, comme le démontrerait le certificat médical de son médecin traitant du 2 août 2022. S’agissant du préjudice moral, il estime que celui-ci découle, d’une part, de la durée déraisonnable de la procédure disciplinaire qui s’est conclue après 19 mois et, d’autre part, de l’atteinte à sa réputation, à son intégrité professionnelle ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression.
154 La Commission conteste ces arguments.
155 Dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire ou par un agent, l’engagement de la responsabilité de l’institution présuppose la réunion d’un ensemble de trois conditions concernant l’illégalité du comportement qui lui est reproché, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué. Les trois conditions d’engagement de la responsabilité sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une de celles-ci n’est pas satisfaite, la responsabilité de l’institution ne peut être engagée. Par ailleurs, le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner ces conditions dans un ordre déterminé (voir ordonnance du 11 juin 2020, Vanhoudt e.a./BEI, T‑294/19, non publiée, EU:T:2020:264, point 70 et jurisprudence citée).
156 En ce qui concerne le préjudice physique, il convient de relever que la condition de l’illégalité du comportement pouvant engager la responsabilité extracontractuelle n’est pas remplie en l’espèce. En effet, ainsi qu’il ressort de l’analyse des conclusions en annulation, la Commission a pu légitimement engager la procédure disciplinaire à l’égard du requérant et lui infliger une sanction disciplinaire pour le comportement adopté dans le cadre de l’échange de courriels litigieux. Ainsi, même si la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que l’AIPN tripartite s’est erronément fondée sur l’attitude du requérant pendant la procédure disciplinaire comme circonstance aggravante, cette erreur ne saurait remettre en question la validité de la procédure disciplinaire dans sa totalité.
157 La demande indemnitaire visant la réparation du prétendu préjudice physique doit dès lors être rejetée comme non fondée.
158 En ce qui concerne le préjudice moral, premièrement, il convient de relever que le requérant se plaint du fait que la procédure disciplinaire a eu une durée déraisonnable de 19 mois, sans pour autant expliquer dans quelle mesure ce délai serait déraisonnable. Force est, en effet, de constater que le requérant n’explique aucunement, ni dans le cadre de la demande indemnitaire ni dans celui des conclusions en annulation, les actes de cette procédure que la Commission n’a pas réalisés avec diligence, compte tenu des circonstances propres de l’affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour lui, de la complexité de l’affaire ainsi que de son comportement et de celui des autorités compétentes [voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2021, IB/EUIPO, T‑22/20, EU:T:2021:689, point 88 (non publié) et jurisprudence citée].
159 Deuxièmement, en ce qui concerne le volet du préjudice moral relatif à l’atteinte à la réputation et à l’intégrité professionnelle du requérant, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir arrêt du 1 er février 2023, TJ/SEAE, T‑365/21, non publié, EU:T:2023:25, point 70 et jurisprudence citée).
160 Or, force est de constater que le requérant attribue à la décision attaquée une atteinte à son image auprès de l’institution et des tiers. Dès lors, il convient de considérer que tout préjudice moral que le requérant pourrait avoir subi en raison de l’adoption de la décision attaquée sera réparé de manière adéquate et suffisante par l’annulation de ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2024, VO/Commission, T‑160/23, non publié, EU:T:2024:791, points 90 et 91).
161 En ce qui concerne le volet du préjudice moral relatif à la violation du droit à la liberté d’expression, celui-ci doit être rejeté comme non fondé, dès lors que, ainsi qu’il a été relevé dans le cadre de l’analyse du troisième moyen, la Commission n’a commis aucune illégalité à cet égard.
162 La demande indemnitaire visant la réparation du prétendu préjudice moral doit dès lors être rejetée comme non fondée.
163 Eu égard à tout ce qui précède, il convient d’annuler la décision attaquée et de rejeter le recours pour le surplus.
Sur les dépens
164 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, l’article 134, paragraphe 3, du même règlement prévoit que, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.
165 En l’espèce, le requérant et la Commission ayant partiellement succombé en leurs demandes, le Tribunal décide que chaque partie supportera ses dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la Commission européenne du 3 juillet 2023 infligeant à M. Rafal Stanecki la sanction disciplinaire de suspension de l’avancement d’échelon pour une période de douze mois est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) M. Stanecki et la Commission supporteront leurs propres dépens.
Svenningsen
Laitenberger
Stancu
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 juillet 2025.
Le greffier
Le président
V. Di Bucci
L. Truchot
* Langue de procédure : le français.
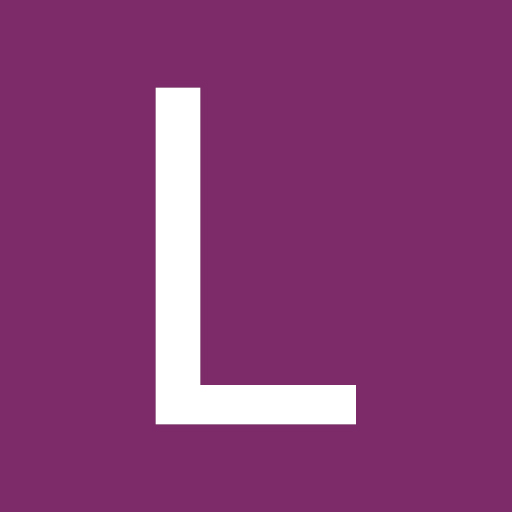
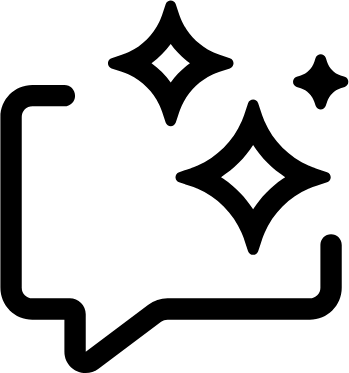 LEXI - AI Legal Assistant
LEXI - AI Legal Assistant