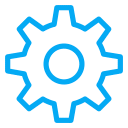Savickis et autres c. Lettonie [GC]
Doc ref: 49270/11 • ECHR ID: 002-13684
Document date: June 9, 2022
- Inbound citations: 0
- •
- Cited paragraphs: 0
- •
- Outbound citations: 0
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 263
Juin 2022
Savickis et autres c. Lettonie [GC] - 49270/11
Arrêt 9.6.2022 [GC]
Article 14
Discrimination
Exclusion des périodes de travail accumulées dans d’autres États de l’ex-URSS du calcul des pensions des non-citoyens résidents permanents, non applicable aux citoyens lettons, justifiée par des considérations très fortes : non-violation
En fait : Nés dans différents territoires de l’Union soviétique, les requérants s’installèrent par la suite en Lettonie, à une époque où celle-ci était encore une république socialiste soviétique de l’Union soviétique. Après le rétablissement de l’indépendance de la Lettonie, les requérants devinrent des « non-citoyens résidents permanents ». Lors du départ en retraite des requérants, les années de travail accomplies par eux en dehors de la Lettonie à l’époque soviétique furent exclues de leur durée totale de travail aux fins du calcul de leurs pensions, en application du premier paragraphe des dispositions transitoires de la loi de 1996 sur les pensions d’État, tandis que les pensions servies aux titulaires de la nationalité lettone étaient calculées sur la base du travail effectué par eux dans n’importe quelle région de l’ex-URSS. Dans son arrêt rendu dans l’affaire Andrejeva c. Lettonie ([GC], 2009), la Cour avait conclu que cette différence de traitement emportait violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1. À la suite de cet arrêt, certains des requérants demandèrent la révision de leurs pensions, mais leurs demandes furent rejetées. En définitive, les cinq requérants se pourvurent devant la Cour constitutionnelle lettone, alléguant que la loi sur les pensions d’État contrevenait à l’interdiction de la discrimination. En février 2011, la Cour constitutionnelle jugea que la disposition litigieuse était compatible avec la Constitution et la Convention. Elle reconnut que les principes arrêtés par le législateur étaient différents selon qu’ils s’appliquaient aux citoyens lettons ou aux « non-citoyens », et que ces deux catégories de personnes étaient traitées de manière différente aux fins du calcul de la durée totale de travail. Toutefois, elle jugea que l’affaire Andrejeva se distinguait nettement de la présente affaire, au motif que M me Andrejeva résidait sur le territoire letton pendant les périodes litigieuses, contrairement aux requérants, qui avaient travaillé en dehors de la Lettonie pendant diverses périodes et qui n’avaient donc établi aucun lien juridique avec ce pays. Après avoir examiné, entre autres, la question de la continuité de l’État, et relevé que la Lettonie n’avait pas succédé aux droits et obligations de l’Union soviétique, la Cour constitutionnelle jugea que la différence litigieuse était fondée sur des motifs objectifs et raisonnables.
En droit : Article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1
La Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter des conclusions pertinentes auxquelles elle était parvenue dans l’affaire Andrejeva , d’où il ressortait que l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 trouvait à s’appliquer et que la « nationalité » – ou plutôt l’absence de citoyenneté lettone des requérants – constituait le seul critère de la distinction incriminée. Elle considère que seules des considérations très fortes sont susceptibles de justifier une différence de traitement en pareil cas, mais qu’il convient néanmoins de tenir compte des circonstances propres au cas d’espèce pour déterminer l’étendue de la marge d’appréciation du gouvernement défendeur. Par ailleurs, elle juge que les requérants peuvent être considérés comme se trouvant dans une situation comparable à celle des personnes qui ont eu la même carrière professionnelle mais qui possèdent la citoyenneté lettone.
La Cour relève que la Cour constitutionnelle lettonne a considéré que la différence de traitement litigieuse poursuivait deux buts légitime. Le premier d’entre eux – et le plus important – consiste à préserver l’identité constitutionnelle de la République de Lettonie par l’application de la doctrine de la continuité de l’État . Selon cette doctrine, la Lettonie (ainsi que la Lituanie et l’Estonie) ont subi, à partir de 1940, une agression et une occupation et une annexion illégales de la part de l’ex-Union soviétique. En conséquence, la Lettonie n’est pas un État successeur de l’URSS ; elle a conservé la qualité d’État qui était la sienne au moment où elle a perdu de facto son indépendance en 1940 à la suite d’une violation flagrante du droit international, qualité qui a néanmoins subsisté de jure pendant toute la période de la guerre froide. Les arguments sur lesquels repose cette doctrine ont influé sur la mise en place du régime contesté de pensions de retraite après le rétablissement de l’indépendance de la Lettonie. La Cour reconnaît que le but poursuivi consiste dans ce contexte à éviter d’entériner rétroactivement les effets de la politique migratoire mise en œuvre pendant l’occupation et l’annexion illégales de la Lettonie. Elle estime que dans ce contexte historique particulier, ce but poursuivi par le législateur letton lors de l’élaboration du régime de pensions de retraite est cohérent avec l’effort de reconstruction nationale entrepris à la suite du rétablissement de l’indépendance. Comme elle l’a admis dans l’affaire Andrejeva , le second but légitime consiste à protéger le système économique national.
La question essentielle qui se pose en l’espèce consiste à savoir si les buts légitimes poursuivis par la Lettonie peuvent justifier la différence opérée entre les citoyens lettons et les « non-citoyens résidents permanents », et si cette différence de traitement est suffisamment justifiée au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce. La Cour doit donc rechercher s’il existe en l’espèce des motifs valables de s’écarter des conclusions auxquelles elle est parvenue dans l’arrêt Andrejeva , au regard notamment du raisonnement approfondi développé par la Cour constitutionnelle lettone dans son arrêt du 17 février 2011.
Un État qui a subi une occupation et une annexion illégales n’est pas obligé d’assumer les obligations de droit public contractées par les autorités publiques illégalement constituées de la puissance occupante ou annexante. La Lettonie n’était pas non plus automatiquement liée par les obligations découlant de la période soviétique ni tenue d’assumer les obligations correspondant aux engagements contractés par l’État occupant ou annexant. Toutefois, après avoir instauré, en 1996, un régime de pensions de retraite professionnelle prévoyant l’inclusion des périodes de travail accumulées en dehors du territoire letton dans le calcul des pensions des citoyens lettons, la Lettonie était tenue de se conformer à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à son égard, à savoir le 27 juin 1997.
La Cour estime en premier lieu qu’il y a lieu d’accorder à l’État une ample marge d’appréciation compte des particularités de la présente affaire et des considérations suivantes, qui découlent de sa jurisprudence :
– Si la marge d’appréciation ne peut pas avoir la même étendue selon qu’elle concerne l’adoption de mesures générales dans le domaine économique ou social ou l’introduction, dans ce domaine, de différences de traitement fondées uniquement sur des critères tels que la nationalité, il est raisonnable de considérer que dans un domaine où l’État bénéficie – et doit bénéficier – d’une ample latitude pour élaborer des mesures générales, l’appréciation de la question de savoir ce qui peut être qualifié de « considérations très fortes » aux fins de l’application de l’article 14 peut elle-même varier selon le contexte et les circonstances. La Cour a déjà reconnu qu’un pays peut avoir des motifs valables d’accorder un traitement spécial à ceux dont les attaches avec lui découlent de leur naissance sur son territoire ou d’un autre lien particulier. En l’espèce, le statut spécial de « non-citoyen résident permanent » a été créé par le législateur letton à la suite du rétablissement de l’indépendance de la Lettonie dans le but de remédier aux conséquences d’une situation qui découlait d’une occupation suivie d’une annexion contraires au droit international.
– La spécificité du champ temporel et du contexte de la mesure incriminée doit aussi être prise en compte. La présente affaire porte sur des périodes de travail accomplies en dehors du territoire de l’État défendeur avant l’instauration par celui-ci d’un régime de pensions de retraite professionnelle. La Cour a déjà reconnu la légitimité d’une différence de traitement fondée sur la nationalité pour des raisons tenant à la date à laquelle les requérants avaient commencé à nouer des liens avec l’État défendeur.
– La présente affaire se caractérise par le contexte particulier dans lequel s’inscrivaient les mesures transitoires litigieuses de ce régime de pensions. Les choix opérés par le législateur letton lors de l’élaboration du régime de pensions de retraite professionnelle et de la fixation des critères permettant d’en bénéficier étaient directement liés au contexte historique et démographique particulier qui était alors celui de la Lettonie et aux contraintes imposées par les graves difficultés économiques qu’elle connaissait à l’époque. La Cour a déjà admis la nécessité de laisser aux États une ample marge d’appréciation lorsque sont en cause des modifications aussi fondamentales du système d’un pays que celles que représentent la transition d’un régime totalitaire à une forme démocratique de gouvernement et la réforme de la structure politique, juridique et économique de l’État, phénomènes qui entraînent inévitablement l’adoption de lois économiques et sociales à grande échelle. En outre, elle peut avoir égard à des faits antérieurs à la ratification de la Convention par l’État défendeur pour autant que l’on puisse les considérer comme étant à l’origine d’une situation qui s’est prolongée au-delà de cette date ou importants pour comprendre les faits survenus après cette date.
– La marge d’appréciation peut aussi dépendre de la question de savoir si la mesure critiquée entraîne une perte des cotisations individuelles versées par ou pour le compte de la personne affectée par la mesure.
– Enfin, il faut également tenir compte du point de savoir si l’inéligibilité à la prestation en question laisse la personne concernée sans couverture sociale.
La Cour doit ensuite apprécier la proportionnalité de la mesure litigieuse au regard de l’ample marge d’appréciation applicable en l’espèce. Elle parvient notamment aux conclusions suivantes :
En premier lieu, le motif sur lequel repose la différence de traitement litigieuse opérée dans les dispositions transitoires relatives au régime de pensions de retraite professionnelle instauré par le législateur letton est directement lié au but principal sur lequel la Cour constitutionnelle lettone s’est fondée. Le traitement plus favorable accordé aux personnes possédant la citoyenneté lettone en ce qui concerne les périodes de travail accomplies par le passé en dehors du territoire letton concorde donc avec ce but légitime.
En deuxième lieu, la différence de traitement incriminée est fondée sur la possession – ou plutôt sur l’absence de possession – de la citoyenneté lettone, statut juridique sans lien avec l’origine nationale des personnes concernées et auquel les requérants auraient pu accéder en leur qualité de « non-citoyens résidents permanents ». Le statut de « non-citoyens résidents permanents » a été conçu comme un régime temporaire visant à permettre aux personnes concernées d’obtenir la nationalité lettone ou de choisir un autre État de rattachement. À cet égard, la Cour admet qu’en ce qui concerne des différences de traitement fondées sur la nationalité, la part de choix personnel liée à ce statut juridique peut, dans certaines situations, avoir une incidence sur la détermination de la marge d’appréciation à laisser aux autorités internes, en particulier lorsque sont en jeu des privilèges, des prestations ou des avantages financiers. Or il ne ressort pas du dossier de l’affaire que l’un quelconque des requérants ait jamais essayé de devenir citoyen de la Lettonie ou qu’il se soit heurté à des obstacles qui l’en auraient empêché. La naturalisation suppose le respect de certaines conditions et peut exiger certains efforts. Toutefois, cela ne change rien au fait que la question du statut juridique – c’est-à-dire le choix de rester non-citoyen résident permanent ou d’acquérir la nationalité lettone – relevait dans une large mesure d’une aspiration personnelle plutôt que d’une situation immuable, compte tenu, en particulier, du laps de temps considérable dont les requérants ont disposé pour exercer ce choix.
En troisième lieu, la différence de traitement litigieuse ne porte que sur des périodes de travail passées, accomplies avant l’instauration du régime de pensions ici en cause. Les choix opérés par le législateur letton lors de la fixation des critères d’acquisition des droits à pension dans ce régime de pensions de retraite professionnelle étaient directement liés aux particularités du contexte historique, économique et démographique dans lequel celui-ci s’inscrivait, qui se caractérisait notamment par un demi-siècle d’occupation et d’annexion illégales. Contrairement à la différence de traitement en cause dans l’affaire Andrejeva , celle dont il est ici question porte uniquement sur des périodes de travail accomplies par les requérants en dehors de la Lettonie à une époque où ils ne s’étaient pas encore installés dans ce pays et n’avaient noué aucun autre lien avec lui.
En quatrième lieu, la différence de traitement incriminée n’a pas non plus remis en cause le droit des requérants à la pension de retraite de base accordée en vertu du droit letton indépendamment de la carrière professionnelle des retraités, et elle n’a entraîné aucune privation, ou perte quelle qu’elle soit, de prestations fondées sur des cotisations versées par les intéressés au titre des périodes de travail litigieuses.
Enfin, s’agissant en particulier du deuxième but légitime poursuivi (la protection de l’économie nationale), la Cour relève que le régime letton de pensions de retraite professionnelle s’appuie sur des cotisations sociales et que son fonctionnement repose sur le principe de solidarité, en ce sens que l’intégralité des cotisations collectées est affectée au financement des pensions courantes dues à l’ensemble des bénéficiaires à un moment donné. Il s’ensuit que le fait de délimiter les périodes de travail ouvrant droit aux prestations influe nécessairement sur le montant de celles-ci et des cotisations nécessaires à leur financement. Ce genre d’arbitrage effectué dans les régimes de sécurité sociale appelle en principe une ample marge d’appréciation. Compte tenu des difficultés particulières et des choix politiques complexes auxquels les autorités lettones ont dû faire face après le rétablissement de l’indépendance, la Cour se doit d’accorder, dans son appréciation globale, une grande latitude au Gouvernement.
En bref, eu égard à l’ensemble des circonstances susmentionnées et à la marge d’appréciation applicable en l’espèce, la Cour estime que la différence de traitement litigieuse concorde avec les buts légitimes poursuivis et que les raisons invoquées par les autorités lettones pour la justifier peuvent être qualifiées de considérations très fortes. En conséquence, l’État défendeur n’a pas outrepassé la marge d’appréciation dont il disposait en ce qui concerne la situation des requérants, et la Cour estime devoir parvenir à une conclusion différente de celle adoptée dans l’affaire Andrejeva .
Conclusion : non-violation (dix voix contre sept)
(Voir aussi Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni , 28 mai 1985, 9214/80 et al. ; Andrejeva c. Lettonie [GC], 55707/00, 18 février 2009, Résumé juridique ; Bah c. Royaume-Uni , 56328/07, 27 septembre 2011, Résumé juridique ; British Gurkha Welfare Society et autres c. Royaume-Uni , 44818/11, 15 septembre 2016, Résumé juridique )
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
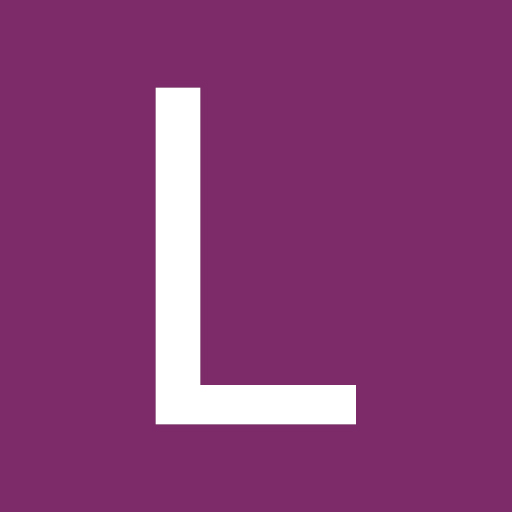
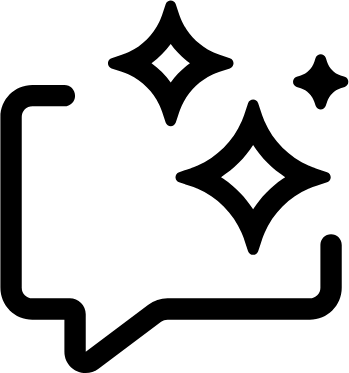 LEXI - AI Legal Assistant
LEXI - AI Legal Assistant