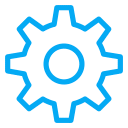Coventry c. Royaume-Uni
Doc ref: 6016/16 • ECHR ID: 002-13826
Document date: October 11, 2022
- Inbound citations: 0
- •
- Cited paragraphs: 0
- •
- Outbound citations: 0
Résumé juridique
Octobre 2022
Coventry c. Royaume-Uni - 6016/16
Arrêt 11.10.2022 [Section IV]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Égalité des armes
Charge excessive et arbitraire supportée par les défendeurs non assurés condamnés à payer des honoraires de succès et primes d’assurance en raison d’un pacte de quota litis conclu par la partie adverse : violation
En fait – Le requérant était l’un des défendeurs succombants à une action engagée pour nuisances. Pour financer leur action, les demandeurs avaient conclu un accord d’exigibilité conditionnelle des honoraires (ou pacte de quota litis : les honoraires ne sont exigibles qu’en cas de succès de l’action) ; ils avaient également souscrit une assurance couvrant le risque qu’ils fussent condamnés aux dépens (ci-après, « l’assurance frais de justice »). Devant la Cour, le requérant se plaignait de ce qu’en vertu de la loi de 1999 sur l’accès à la justice, il avait été condamné à payer au titre des frais et dépens les « honoraires de succès » devant rétribuer le travail des avocats qui avaient conclu un pacte de quota litis dans les affaires où, n’ayant pas obtenu gain de cause, ils ne seraient pas payés par leurs clients, ainsi que la prime de l’assurance frais de justice. Il invoquait l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1. La Cour observe qu’alors que les demandeurs à l’action se sont vu octroyer à peine plus de 20 000 livres sterling (GBP) à titre de réparation de leur préjudice, le requérant (conjointement avec une autre défenderesse, une société qui a depuis lors été mise en liquidation) a été condamné à s’acquitter au titre des frais et dépens des demandeurs des sommes de 623 203 GBP pour la procédure menée devant la High Court et 223 634 GBP pour la procédure menée devant la Court of Appeal. La Cour suprême a été saisie de l’affaire trois fois, et les frais et dépens à verser au titre de la procédure menée devant elle n’ont pas encore été évalués. Plus de la moitié des frais et dépens déjà chiffrés est constituée par les honoraires de succès et les primes de l’assurance frais de justice.
En droit – Article 6 § 1 :
Le fond de la cause du requérant – à savoir le fait que la troisième défenderesse et lui-même étaient respectivement une petite entreprise et un particulier exerçant sans assurance des activités modestes, qui se sont trouvés du fait d’un seul litige dans l’obligation de payer des frais de justice exorbitants – n’a, en grande partie, pas été examiné par les juridictions internes. Il ressort de la procédure que le requérant a engagée par la suite contre ses assureurs que son courtier lui avait affirmé que son assurance ne couvrait pas l’action engagée contre lui pour nuisances. En conséquence, indépendamment de l’issue de la procédure en cours, la Cour admet que, tout au long de la procédure pour nuisances, le requérant croyait être un défendeur non assuré, et que cette croyance n’était pas déraisonnable. Elle examine donc le fonctionnement du système à l’égard des défendeurs non assurés, considérés en tant que catégorie de personnes.
Dans l’arrêt MGN Limited c. Royaume-Uni , la Cour a reconnu que l’instauration du système combinant pacte de quota litis et possibilité de condamner la partie adverse à payer les honoraires de succès avait pour but de permettre l’accès du plus grand nombre à une assistance juridique financée par le secteur privé dans le cadre des procédures civiles, notamment en rééquilibrant les moyens d’accès à la justice : au lieu de faire peser la charge financière sur les deniers publics, par l’intermédiaire du fonds d’aide juridictionnelle, ce système faisait supporter par la partie succombante le coût des litiges financés par un pacte de quota litis . La Cour a toutefois estimé, dans le contexte de l’article 10 de la Convention, que ce système n’était pas proportionné aux buts légitimes visés, et elle a conclu qu’il outrepassait même l’ample marge d’appréciation dont jouissait le Gouvernement en la matière. Elle a fondé cette conclusion en grande partie sur les quatre défauts suivants : premièrement, le système n’était pas ciblé et il n’établissait aucun critère d’admission pour les demandeurs qui souhaitaient conclure un pacte de quota litis ; deuxièmement, il n’y avait aucune incitation à ce que les demandeurs modèrent les frais et dépens engagés en leur nom par leurs représentants et les juges n’évaluaient les sommes correspondantes qu’à l’issue de la procédure, c’est-à-dire une fois qu’il était trop tard pour modérer les dépenses ; troisièmement, le système avait un effet « dissuasif », ou effet de « chantage », étant donné que le montant des frais et dépens que les parties adverses risquaient d’être condamnées à payer était si excessif qu’elles étaient souvent conduites à accepter un règlement amiable anticipé alors qu’elles avaient de bonnes chances de défendre leur cause avec succès ; et quatrièmement, le système donnait aux solicitors et aux barristers la possibilité de choisir de manière sélective, pour travailler dans le cadre de pactes de quota litis entraînant le versement d’honoraires de succès, les causes qui avaient de fortes chances d’aboutir à une issue favorable.
En ce qui concerne le troisième de ces défauts, la Cour confirme en l’espèce que le risque qu’une partie ayant de bonnes chances de défendre sa cause avec succès soit conduite à conclure un règlement amiable anticipé pour ne pas s’exposer à payer des frais et dépens excessifs était l’un des principaux défauts du système, en particulier du point de vue du principe de l’égalité des armes. Elle observe que ce risque était particulièrement important lorsque le défendeur n’était pas assuré. S’il est vrai que les assureurs ne devaient pas rester indifférents face à l’augmentation rapide des frais des parties adverses et qu’ils en tenaient compte pour déterminer la stratégie à adopter dans le cadre de la procédure, il est clair également que les défendeurs qui n’avaient pas d’assurance couvrant le risque d’être condamnés aux dépens se trouvaient dans une situation particulièrement désavantageuse. Il y avait certes un risque évident qu’ils ne soient poussés à accepter un règlement amiable anticipé, cependant la Cour estime que le préjudice potentiel ne se limite pas à ce cadre étroit (dans l’affaire Stankiewicz c. Pologne , elle n’avait pas lié expressément à telle ou telle issue de la procédure civile le déséquilibre dans le montant des frais et dépens que les parties s’exposaient à payer). Au contraire, le caractère très différent des risques financiers auxquels les parties se trouvaient exposées était de nature à affecter chacune des décisions qu’elles prendraient relativement à la conduite de la procédure. Ainsi que le requérant l’a suggéré en l’espèce, ce déséquilibre pouvait aussi faire obstacle à un règlement amiable, même au début de la procédure, si l’une des parties n’était tout simplement pas en mesure de payer les frais et dépens de la partie adverse.
Le risque qu’une partie ayant de bonnes chances de défendre sa cause avec succès fût conduite à accepter un règlement anticipé de l’affaire était exacerbé par une curieuse caractéristique du système : plus les arguments des défendeurs étaient solides et plus le montant des frais et dépens qu’ils étaient condamnés à payer s’ils succombaient était élevé, le montant des honoraires de succès et de la prime d’assurance frais de justice étant inversement proportionnel aux chances de succès des demandeurs. En conséquence, un défendeur qui avait de bonnes chances de défendre sa cause avec succès mais qui succombait finalement risquait de devoir payer, outre l’intégralité de ses propres frais et dépens, jusqu’à trois fois le montant des dépens des demandeurs. S’il n’était pas assuré, il devait payer la totalité de cette somme sur ses propres deniers.
La Cour observe par ailleurs que le troisième défaut du système n’est pas le seul qui soit pertinent en l’espèce. Elle doit déterminer si le système ménageait un juste équilibre entre les parties à un litige où l’une avait conclu un pacte de quota litis , et en particulier si, dans ce type d’affaires, le défendeur se trouvait placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Dans ce cadre, elle estime pertinent le fait que, contrairement à un défendeur non assuré, qui était confronté à une augmentation rapide de ses frais et dépens en sachant qu’il devrait les payer sur ses propres deniers, un demandeur ayant conclu un pacte de quota litis et souscrit une assurance frais de justice n’était normalement tenu de payer ni ses propres frais et dépens ni, s’il n’obtenait pas gain de cause, ceux du défendeur.
Le Gouvernement n’a été en mesure de citer aucune garantie inhérente au système qui aurait été propre à corriger ce déséquilibre. S’il est vrai qu’en principe les défendeurs pouvaient eux aussi souscrire une assurance frais de justice, compte tenu du fait que les demandeurs ne pouvaient généralement obtenir une telle assurance que lorsque leurs chances de succès étaient « supérieures à 50 % », un défendeur dans la même procédure avait très peu de chances, voire aucune chance, de pouvoir souscrire lui aussi une telle assurance. De plus, c’est à la fin de la procédure que les frais et dépens étaient évalués ; or la principale source de préjudice pour le défendeur était l’effet dissuasif lié à la perspective de devoir payer des frais et dépens augmentant rapidement : cette évaluation était donc réalisée trop tard pour corriger le déséquilibre qui existait entre les parties pendant la procédure. En toute hypothèse, même si les juges tenaient compte (quoique de manière limitée) du caractère proportionné des dépens lorsqu’ils déterminaient s’il y avait lieu de condamner la partie succombante à supporter ceux de la partie adverse, ils exigeaient seulement pour la condamnation à payer les honoraires de succès et les primes d’assurance frais de justice que leur montant fût raisonnable. Or, ainsi que la Cour l’a observé dans l’arrêt MGN Limited , le caractère raisonnable ou non des honoraires de succès dépendait essentiellement du pourcentage d’augmentation des honoraires au regard du risque pris par l’avocat lorsqu’il avait accepté de travailler sur l’affaire.
La Cour considère encore que deux autres facteurs sont eux aussi pertinents. D’une part, le système ne faisait pas peser la charge de l’élargissement au plus grand nombre de l’accès aux services juridiques sur la partie succombante quelle qu’elle fût, mais seulement sur les justiciables qui avaient perdu un litige dans lequel la partie adverse avait conclu un pacte de quota litis et souscrit une assurance frais de justice ; et il leur faisait supporter la charge financière d’autres affaires auxquelles ils n’étaient pas parties. Si certains justiciables pouvaient être eux-mêmes assurés, ceux qui ne l’étaient pas devaient supporter une charge financière qui dépassait largement les montants justes et raisonnables engagés par la partie adverse, et ce dans le but d’encourager les avocats à travailler pour d’autres parties dans d’autres affaires.
D’autre part, la Cour prend note des conclusions que la Cour suprême a formulée dans ses arrêts, selon lesquelles priver les demandeurs de la possibilité de recouvrer le montant des honoraires de succès et des primes d’assurance frais de justice qu’ils devaient respectivement à leurs conseillers juridiques et à leurs assureurs risquait d’emporter violation à leur égard du droit protégé par l’article 1 du Protocole n o 1. La Cour suprême a considéré également que les assurances frais de justice protégeaient aussi les défendeurs victorieux, en leur permettant de recouvrer le montant des frais et dépens qu’ils avaient engagés. Elle a conclu que, contrairement à la règle appliquée pour les honoraires de succès, dont le but était de rétribuer les avocats pour le travail qu’ils avaient accompli sur les affaires dans lesquelles ils n’avaient pas gagné, le fait de faire payer les primes d’assurance frais de justice par les défendeurs succombants n’était pas censé contribuer au financement d’autres litiges ni à l’accès du plus grand nombre à la justice. Eu égard à l’ampleur et à la nature des défauts du système, qui ont été mis en évidence dans le cadre d’une consultation publique, qui ont, sur plusieurs points importants, été reconnus par le ministère de la Justice, et qui ont entraîné l’abolition de la possibilité de condamner la partie succombante à payer les honoraires de succès et les primes d’assurance frais de justice de la partie adverse, la Cour considère pour sa part qu’en ce qui concerne les défendeurs non assurés, qui ont supporté une charge excessive et arbitraire dans les procédures où la partie adverse avait conclu un pacte de quota litis , le système litigieux, envisagé dans son ensemble, portait atteinte à la substance même du principe de l’égalité des armes garanti par l’article 6 § 1.
Il apparaît que les faits de l’espèce confirment cette conclusion. La Cour a admis que, tout au long de la procédure pour nuisances, le requérant croyait – sans que cela ne soit déraisonnable – être un défendeur non assuré. De plus, le Gouvernement n’a pas tenté de contester l’affirmation du requérant selon laquelle la troisième défenderesse, avec laquelle il était solidairement responsable, avait été mise en liquidation et n’avait nullement contribué au paiement des frais et dépens des demandeurs. Or, même en excluant les frais et dépens liés à la procédure menée devant la Cour suprême, le montant que le requérant a été condamné à payer aux demandeurs au titre de leurs frais et dépens représentait plus de quatre-vingt fois celui de l’indemnité qu’il a dû verser à titre de réparation de leur préjudice.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 1 du Protocole n o 1 :
Même si le but de la règle selon laquelle la partie succombante doit supporter les frais et dépens de la partie adverse (afin d’éviter les procédures injustifiées et les frais et dépens déraisonnablement élevés en dissuadant les demandeurs potentiels d’engager des actions infondées sans avoir à en subir les conséquences) est très différent de celui que visait le système mis en place par la loi de 1999, la Cour est disposée à admettre que ce système avait une base légale en droit interne et qu’il visait un but légitime. Toutefois, eu égard à sa conclusion selon laquelle ce système imposait une charge excessive aux défendeurs non assurés dans le cadre des procédures où la partie adverse avait conclu un pacte de quota litis , la Cour considère, dans le contexte de l’article 1 du Protocole n o 1, qu’à l’égard de cette catégorie de défendeurs ce système outrepassait même l’ample marge d’appréciation dont jouissait l’État en matière de politique économique et sociale. Il est vrai que les parties à un litige qui avaient conclu un pacte de quota litis pouvaient légitimement espérer, au moment où elles avaient conclu cet accord, que celui-ci serait appliqué, mais cette considération ne peut en elle-même constituer une réponse à la question qui se posait en l’espèce, à savoir celle de la compatibilité avec la Convention du système en lui-même.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : question de la satisfaction équitable réservée.
(Voir aussi Stankiewicz c. Pologne , n o 46917/99, 6 avril 2006, résumé juridique ; MGN Limited c. Royaume-Uni , n o 39401/04, 18 janvier 2011, résumé juridique ; Cindrić et Bešlić c. Croatie , n o 72152/13, 6 septembre 2016, résumé juridique )
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .
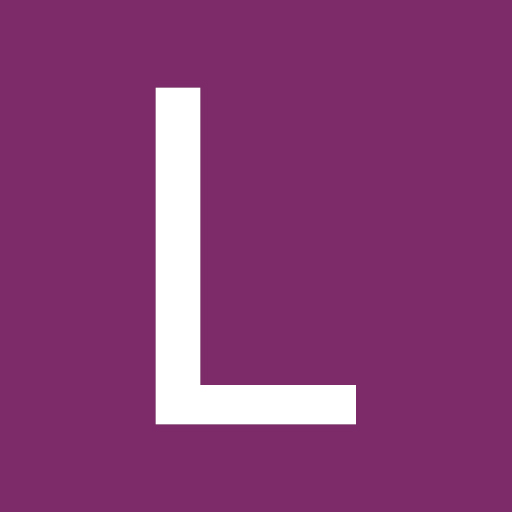
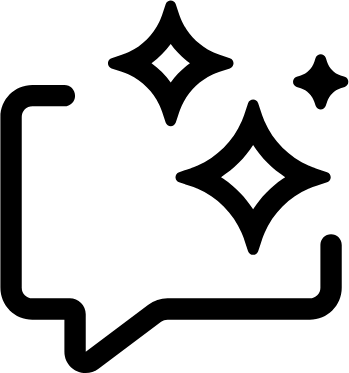 LEXI - AI Legal Assistant
LEXI - AI Legal Assistant