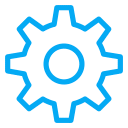Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 18 December 1997.
Frédéric Daffix v Commission of the European Communities.
T-12/94 • 61994TJ0012(01) • ECLI:EU:T:1997:208
- Inbound citations: 44
- •
- Cited paragraphs: 13
- •
- Outbound citations: 16
Avis juridique important
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 18 décembre 1997. - Frédéric Daffix contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Révocation - Pourvoi - Renvoi au Tribunal - Réalité des faits - Charge de la preuve - Abus du pouvoir discrétionnaire - Erreur manifeste d'appréciation - Droits de la défense - Article 7 de l'annexe IX du statut. - Affaire T-12/94. Recueil de jurisprudence - fonction publique 1997 page IA-00453 page II-01197
Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif
Dans l'affaire T-12/94,
Frédéric Daffix, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Mes Georges Vandersanden et Laure Levi, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Benoît Cambier, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 18 mars 1993 portant révocation du requérant et, en tant que de besoin, de la décision implicite de rejet de sa réclamation,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(troisième chambre),
composé de MM. B. Vesterdorf, président, C. P. Briët et A. Potocki, juges,
greffier: M. A. Mair, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 31 janvier 1995,
vu l'arrêt de la Cour du 20 février 1997,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 15 octobre 1997,
rend le présent
Arrê
Faits à l'origine du litige
1 A la date des faits qui sont à l'origine du présent litige, le requérant était fonctionnaire de la Commission de grade B 3. Affecté à la direction générale Information, communication, culture, audiovisuel (DG X), il assumait les fonctions de chargé de production.
2 Le 28 novembre 1990, la SA Newscom, sous-traitante de la Commission pour la gestion des studios situés au sous-sol du bâtiment Berlaymont, à Bruxelles, a demandé à celle-ci le règlement de trois factures, pour un montant total de 450 000 BFR. Ces factures ont été émises dans le cadre de la pratique de Newscom consistant à consentir, sur demande de la Commission et sur présentation par celle-ci d'un bon de commande, des avances aux autres sous-traitants de la Commission.
3 Les factures constituaient la contrepartie de trois bons de commande datés respectivement du 1er juin, du 15 juin et du 2 juillet 1990. Le premier bon de commande portait la signature, pour ordre, du requérant, les deuxième et troisième bons de commande celle de M. M., à l'époque adjoint d'un chef d'unité à la DG X. En outre, ces deux derniers bons portaient respectivement les mentions manuscrites, apposées par le requérant, «reçu le 20/06/1990» et «reçu le 4 07 1990».
4 Le 3 décembre 1990, M. M. a adressé une note à l'attention de son supérieur hiérarchique de l'époque, M. P., directeur à la DG X. Dans cette note, il signalait que sa signature sur les deuxième et troisième bons de commande avait, selon lui, été falsifiée. De plus, après vérification, il lui était apparu que les trois bons de commande ne concernaient aucune prestation demandée à Newscom.
5 Le 10 avril 1991, M. V., directeur à la direction générale Personnel et administration (DG IX), a procédé, en application de l'article 87 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), à l'audition du requérant. Lors de cette audition, celui-ci a déclaré avoir établi les trois bons de commande dans le cadre du projet «Musique du cinéma», dont il aurait été chargé. Il a dit avoir signé pour ordre le premier bon de commande et avoir remis les deux autres bons de commande au secrétariat de M. M., qui les aurait signés. Par ailleurs, il a affirmé avoir reçu la somme de 450 000 BFR de Newscom et avoir remis cette somme à Mlle ou Mme Lombaerts, travaillant pour la «Haute définition TV» à Paris, contre remise de trois reçus encore en sa possession. Il a dit avoir «probablement» remis l'argent à Mme Lombaerts dans le bureau de M. M. Il a expliqué, en outre, que le mot «reçu» sur les bons de commande signifiait qu'il avait reçu, aux dates indiquées, les sommes mentionnées de Newscom.
6 Postérieurement à l'audition, le requérant a remis aux fonctionnaires de la Commission chargés de l'instruction de l'affaire, trois copies desdits reçus, dont les montants s'élevaient respectivement à 65 000 BFR, à 200 000 BFR et à 185 000 BFR. Ces reçus étaient datés respectivement du 1er juin, du 20 juin et du 2 juillet 1990 et portaient la signature de «Régine Lombaerts, Production HDTV».
7 Le 7 juin 1991, M. V. a informé le requérant qu'il avait été impossible de retrouver Mme Lombaerts. Le requérant a alors précisé qu'elle était «productrice déléguée à la Société française à Paris», où elle était «responsable pour certaines productions concernant l'année de la musique».
8 Le 18 juillet 1991, le requérant a été entendu par M. J., chef d'unité à la DG IX. Celui-ci lui a fait savoir que, après vérification, la Commission avait dû constater qu'aucune personne du nom de Régine Lombaerts ne travaillait à la Société française de production, à Paris. Le requérant a néanmoins maintenu sa position, telle qu'elle ressortait des comptes rendus des auditions précédentes. M. J. a expliqué au requérant la gravité de la situation, qui, sauf preuve convaincante contraire, ne laissait guère d'autre possibilité pour la Commission que de conclure qu'il avait conservé par-devers lui la somme de 450 000 BFR.
9 Le 22 juillet 1991, le requérant a été entendu par M. R., directeur à la DG IX. Lors de cette audition, il a avoué avoir conservé l'argent, tout en s'engageant à le restituer selon des modalités à convenir.
10 Postérieurement à cette audition, il a informé M. J. qu'il ne signerait pas le compte rendu de celle-ci, étant donné que cela équivaudrait à une reconnaissance de faux. Il a indiqué que, selon ses informations, Mme Lombaerts ne travaillait plus pour la Société française de production et qu'elle avait été employée à la «Haute définition». Il a ajouté qu'un enquêteur engagé par lui avait retrouvé la trace de Mme Lombaerts, et a manifesté l'intention de communiquer le plus rapidement possible les informations qu'il pourrait obtenir. La Commission soutient cependant qu'elle n'a jamais reçu de telles informations.
11 Le 20 février 1992, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») a saisi le conseil de discipline, en application de l'article 1er de l'annexe IX du statut. Dans le rapport soumis à ce conseil, elle a reproché au requérant «d'avoir falsifié trois bons de commande destinés à un sous-traitant de la Commission, la société Newscom, qui, sur la base de ces bons, a été amenée à lui remettre la somme de 450 000 BFR en liquide, et d'avoir gardé cette somme».
12 Du 4 mai au 8 décembre 1992, les 21 et 22 janvier 1993, et du 26 au 29 janvier 1993, le requérant a été absent de son lieu de travail, le plus souvent pour cause de maladie.
13 Le 14 mai 1992, le conseil de discipline a tenu deux réunions. Au cours de la seconde, le requérant a été entendu. Il a précisé que Mme Lombaerts travaillait à l'époque comme «free-lance», ajoutant qu'il pensait qu'elle se trouvait à ce moment en Amérique. Il a déclaré ne plus se souvenir du lieu où il avait remis l'argent à Mme Lombaerts. Par ailleurs, il a affirmé avoir établi lui-même le premier bon de commande sur proposition de M. M. Il a déclaré que l'établissement des bons de commande et la remise de l'argent à Mme Lombaerts avaient fait l'objet de deux opérations successives, et que, après chaque opération, il avait immédiatement demandé des reçus à Mme Lombaerts. Il n'a pas pu expliquer pourquoi le dernier bon de commande portait la date du 4 juillet 1990, date à laquelle il aurait reçu l'argent, alors que le dernier des trois reçus portait la date du 2 juillet 1990, date à laquelle il aurait remis l'argent à Mme Lombaerts.
14 Le 20 novembre 1992, le conseil de discipline a tenu une troisième réunion. Il a d'abord entendu M. M. Celui-ci a déclaré, notamment, que la signature apposée au bas des deux derniers bons de commande n'était pas la sienne. Selon lui, le responsable qui avait qualité pour signer les bons de commande en cause était Mme C., qui, à la date des faits, était le supérieur direct du requérant. Par ailleurs, il a signalé que les numéros des bons de commande ne correspondaient pas à la numérotation utilisée par la Commission.
15 Lors de la même réunion, le conseil de discipline a entendu le requérant, qui était assisté d'un avocat. Le requérant a dit avoir remis l'argent à Mme Lombaerts soit dans son bureau, soit dans le studio. Il a précisé que celle-ci n'avait pas été «mandatée» directement par la Société française de production, mais par une autre société. Enfin, il a affirmé qu'il supposait avoir reçu instruction de M. M. ou de M. Dewael de remettre l'argent à Mme Lombaerts.
16 Le 2 décembre 1992, le conseil de discipline a entamé une enquête supplémentaire en vertu de l'article 6, premier alinéa, de l'annexe IX du statut. Dans le cadre de cette enquête, il a posé certaines questions écrites au directeur général de la DG IX et au directeur du bureau de sécurité de la Commission.
17 Le 18 février 1993, il a tenu une quatrième réunion. Au cours de celle-ci, il a d'abord entendu Mme C., laquelle a déclaré que, à la date des faits, la DG X était en cours de réorganisation et que, durant cette phase transitoire, elle avait eu connaissance des dossiers de M. M. Elle a indiqué que la présentation des bons de commande en question était celle habituellement retenue, mais que leur numérotation avait déjà été utilisée pour d'autres commandes.
18 Lors de cette quatrième réunion, le conseil de discipline a également entendu M. R. Celui-ci a déclaré que, lors de l'audition du 22 juillet 1991, le requérant avait avoué avoir conservé des sommes appartenant à l'institution. Il a affirmé que, selon lui, cet aveu était fondé et sincère, ajoutant que l'audition s'était déroulée dans un climat cordial.
19 A l'occasion du témoignage de M. R., le requérant, à nouveau assisté d'un avocat, a admis avoir avoué, lors de son audition du 22 juillet 1991, qu'il avait conservé la somme en cause. Toutefois, il a soutenu que cet aveu ne correspondait pas à la vérité et que, en réalité, il n'avait pas conservé l'argent en question.
20 Le jour même de sa quatrième réunion, le conseil de discipline a rendu son avis. Il a considéré que la falsification des bons de commande par le requérant n'était pas établie et que, malgré diverses contradictions relevées tant dans les déclarations de ce dernier qu'entre celles-ci et les témoignages, il n'était pas en mesure d'écarter la possibilité que la somme d'argent en question ait effectivement été remise au prestataire de services indiqué par le requérant. Il a néanmoins conclu que ce dernier, en ne vérifiant pas préalablement l'identité de ce prestataire et en ne s'assurant pas de sa légitimité, avait gravement manqué à ses obligations de fonctionnaire des Communautés européennes. En conséquence, il a recommandé à l'AIPN d'infliger au requérant la sanction de la rétrogradation au grade B 5, échelon 1.
21 Le 4 mars 1993, le requérant a adressé à l'AIPN une lettre dans laquelle il a fait valoir, notamment, que la sanction proposée par le conseil de discipline était, à son avis, lourde et injuste. Il a souligné avoir vu Mme Lombaerts dans le bureau de M. M., en présence de M. Dewalcke, producteur.
22 A la suite de cette lettre, M. M. a de nouveau été interrogé. Il a déclaré n'avoir jamais rencontré ni Mme Lombaerts ni M. Dewalcke.
23 Le 11 mars 1993, le requérant a été entendu par l'AIPN, en application de l'article 7, troisième alinéa, de l'annexe IX du statut.
24 Le 18 mars 1993, l'AIPN a adopté la décision litigieuse.
25 La dernière partie de celle-ci se lit comme suit:
«considérant que le grief retenu à l'encontre de M. Daffix consiste à la fois en l'établissement de manière falsifiée de trois bons de commande destinés à la société Newscom, sous-traitant de la Commission dans le secteur "culture" et à la fois en l'utilisation desdits bons de commande pour amener la société Newscom à lui remettre, au nom et pour compte de la Commission, en trois tranches, aux mois de juin et juillet 1990, une somme importante en liquide;
considérant que M. Daffix a admis lors de l'audition du 10 avril 1991 avoir établi les trois bons de commande, dont un signé par lui personnellement, "pour ordre" de son supérieur hiérarchique sans que celui-ci ait donné une instruction à cet égard;
considérant que M. Daffix a nié lors de la même audition avoir falsifié la signature de son supérieur hiérarchique sur les deux autres bons de commande;
considérant que M. Daffix s'est servi des trois bons de commande pour obtenir le paiement en liquide de la somme précitée par la société Newscom sans avoir obtenu des instructions quelconques à cet égard;
considérant que les déclarations de M. Daffix relatives, d'une part, à la remise à une personne externe à l'institution de la somme qu'il a obtenue auprès de la société Newscom et, d'autre part, quant à l'identité de cette personne ont été divergentes et souvent contradictoires de sorte qu'elles ne peuvent être prises en considération, notamment au vu des autres témoignages recueillis au cours de la procédure disciplinaire;
considérant qu'il est donc légitime de conclure que M. Daffix a gardé la somme de 450 000 BFR qu'il a reçue en liquide de la société Newscom;
considérant que cette conclusion est d'ailleurs corroborée par la déclaration de M. Daffix lui-même lors de l'audition du 22 juillet 1991;
considérant que M. Daffix a lui-même reconnu devant le conseil de discipline qu'il avait effectivement fait cette déclaration le 22 juillet 1991, même si, par la suite, il a refusé de signer le compte rendu de l'audition;
considérant que les faits reprochés à M. Daffix constituent un manquement extrêmement grave à ses obligations, qui, en effet, mettent en cause les bases mêmes des relations de confiance qui doivent exister entre l'institution et chacun des membres de son personnel et qu'un tel comportement justifie l'imposition d'une sanction allant au-delà de la mesure recommandée par le conseil de discipline;
décide:
Article 1er: la sanction disciplinaire visée à l'article 86, paragraphe 2, sous f), du statut, à savoir la révocation sans réduction ou suppression du droit à pension d'ancienneté est infligée à M. Frédéric Daffix;
Article 2: la présente décision prend effet au 1er avril 1993.»
26 Postérieurement à sa notification au requérant, le 29 mars 1993, l'article 2 du dispositif de la décision a été modifié, la date d'effet de la décision étant reportée au 1er juillet 1993.
27 Le 18 juin 1993, le requérant a introduit une réclamation, au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, à l'encontre de cette décision.
28 Le 1er octobre 1993, le requérant, assisté d'un nouveau conseil, Me Levi, a été entendu par le groupe interservice chargé d'examiner sa réclamation. A cette occasion, il a demandé que M. De Valck, auquel il avait auparavant fait référence, par erreur, sous le nom de Dewalcke (voir ci-dessus point 21), soit entendu à propos de Mme Lombaerts et sur l'aspect comptable des rapports entre la société Cobra-films, où M. De Valck travaillait, et la Commission.
29 Le 6 octobre 1993, M. De Valck a été entendu. Il a déclaré avoir signé, en 1989, un contrat avec la Commission pour le montage du film «Musique du cinéma européen». A cet effet, il avait eu des contacts avec M. M., mais non avec le requérant, qui - toujours selon M. De Valck - n'était pas lié à ce programme. Il avait fait la connaissance du requérant dans le cadre d'un autre programme, mais n'avait plus de contacts avec lui depuis un certain nombre d'années. M. De Valck a encore affirmé que, dans le cadre du projet «Musique du cinéma européen», il n'avait pas été question d'avances de la part de la Commission. Enfin, il a déclaré ne pas connaître Mme Lombaerts, n'avoir jamais entendu ce nom et, a fortiori, n'avoir jamais rencontré quelqu'un répondant à ce nom dans le bureau de M. M.
30 Le 18 octobre 1993, la réclamation du requérant du 18 juin 1993 a été implicitement rejetée, faute d'un rejet explicite de la part de l'AIPN dans le délai de quatre mois prévu par l'article 90, paragraphe 2, du statut.
Procédure
31 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 1994, le requérant a introduit un recours visant à l'annulation de la décision de l'AIPN du 18 mars 1993 (ci-après «décision litigieuse»).
32 Par arrêt du 28 mars 1995, Daffix/Commission (T-12/94, RecFP p. II-233), le Tribunal a annulé la décision litigieuse pour insuffisance de motivation et a condamné la Commission aux dépens.
33 Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 mai 1995, la Commission a formé un pourvoi contre cet arrêt.
34 Par arrêt du 20 février 1997, Commission/Daffix (C-166/95 P, Rec. p. I-983), la Cour a annulé l'arrêt du Tribunal, en tant qu'il avait, d'une part, annulé la décision litigieuse pour insuffisance de motivation et, d'autre part, condamné la Commission aux dépens. Elle a renvoyé l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue sur les autres moyens invoqués par le requérant en première instance. Elle a enfin réservé les dépens.
35 Le Tribunal étant ainsi à nouveau saisi de l'affaire en vertu de l'article 117 du règlement de procédure, le requérant a déposé, le 18 avril 1997, un mémoire d'observations écrites, en application de l'article 119, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure.
36 Le 16 mai 1997, la Commission a déposé un mémoire d'observations écrites, en application de l'article 119, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure.
37 Par lettre du 25 juin 1997, le requérant a introduit une demande d'assistance judiciaire gratuite en vertu de l'article 94 du règlement de procédure.
38 Par ordonnance du 15 septembre 1997, le président de la troisième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande et a fixé à 175 000 BFR le montant des frais et honoraires à prendre en charge au titre de l'assistance judiciaire gratuite.
39 Sur rapport du juge-rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables.
40 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l'audience publique qui s'est déroulée le 15 octobre 1997.
Conclusions des parties
41 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler la décision du 18 mars 1993, lui infligeant la sanction disciplinaire de la révocation sans réduction ou suppression du droit à pension d'ancienneté et, pour autant que de besoin, la décision implicite de rejet de sa réclamation;
- condamner la Commission à l'ensemble des dépens.
42 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours comme non fondé;
- statuer sur les dépens comme de droit.
Sur le fond
43 A l'appui de son recours, le requérant invoque quatre moyens, le premier tiré de l'illégalité de la sanction infligée, le deuxième d'un abus du pouvoir discrétionnaire et d'une erreur manifeste d'appréciation, le troisième d'une violation des droits de la défense et le quatrième d'une violation de l'article 7 de l'annexe IX du statut.
Sur le premier moyen, tiré de l'illégalité de la sanction infligée
Arguments des parties
44 Se référant à l'arrêt de la Cour du 5 février 1987, F./Commission (403/85, Rec. p. 645, point 18), ainsi qu'à l'arrêt du Tribunal du 17 octobre 1991, de Compte/Parlement (T-26/89, Rec. p. II-781, point 220), le requérant fait valoir que la légalité de toute sanction disciplinaire présuppose que la réalité des faits reprochés à l'intéressé soit établie.
45 Or, tel ne serait pas le cas en l'espèce. Le requérant renvoie à cet égard à l'avis du conseil de discipline, selon lequel il n'aurait pas été établi qu'il avait conservé l'argent.
46 Par ailleurs, il estime que son aveu du 22 juillet 1991 ne peut pas être retenu comme preuve de la réalité des faits reprochés, dès lors qu'il a été fait sous l'empire d'un état psychologique instable, d'un état physique affaibli et sous la pression exercée sur lui par la Commission. Il souligne qu'il n'a pas signé le compte rendu de l'audition du 22 juillet 1991, ayant estimé, après réflexion, que celui-ci n'exprimait pas la vérité.
47 S'agissant de son état psychologique, il fait valoir que, à l'époque de son aveu, son épouse venait d'obtenir une décision d'autorisation de résidence séparée, décision qui avait eu pour effet de le contraindre, du jour au lendemain, à déménager. Ces circonstances auraient d'ailleurs justifié l'intervention d'un psychiatre et son hospitalisation dans une clinique. Quant à son état physique, il fait remarquer que, à la suite d'un accident, il avait eu un pied dans le plâtre pendant toutes les auditions et, en particulier, le jour de son aveu.
48 La pression exercée sur lui par la Commission aurait consisté dans le fait que, au cours de l'audition du 22 juillet 1991, deux solutions lui avaient été proposées, à savoir soit un aveu entraînant une sanction disciplinaire, soit la saisine des instances pénales belges. Ayant pris peur à la perspective des conséquences inévitablement liées à une information judiciaire, et se trouvant dans l'état psychologique et physique précédemment décrit, il aurait cédé en déclarant avoir «gardé» l'argent.
49 Il estime que son aveu pourrait tout au plus être considéré comme un commencement de preuve, mais que, dans cette hypothèse, il ne libérerait nullement la Commission de son obligation de recourir à d'autres modes de preuve pour établir de façon indiscutable les faits reprochés.
50 Pour démontrer que les faits n'étaient pas établis, il fait encore remarquer que la Commission n'a jamais remis en cause les reçus signés par Régine Lombaerts. Or, l'institution ne pourrait pas l'accuser d'avoir conservé le montant inscrit sur ces trois reçus tout en reconnaissant l'authenticité et la validité de ceux-ci.
51 Par ailleurs, la Commission n'aurait pas mené utilement les recherches pour retrouver Régine Lombaerts. En outre, elle se serait abstenue à tort de faire procéder à une analyse graphologique de la signature de M. M. sur les deuxième et troisième bons de commande. Cette attitude montrerait clairement que la Commission a méconnu son obligation d'instruire à charge et à décharge, à l'instar d'un juge d'instruction.
52 Dans ces circonstances, l'AIPN aurait décidé dans le doute que le requérant était coupable des faits qui lui étaient reprochés. Cette attitude serait contraire au principe selon lequel toute personne est présumée innocente, jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit apportée. A cet égard, en droit disciplinaire, la charge de la preuve appartiendrait toujours à l'AIPN, le fonctionnaire n'ayant que la charge de la preuve contraire.
53 Le requérant conclut que, la réalité des faits n'ayant pas été établie, la sanction disciplinaire infligée par l'AIPN est illégale.
54 La Commission estime que la preuve des faits ressort de l'aveu du requérant, des règles relatives à la charge de la preuve et des faits eux-mêmes.
55 En ce qui concerne l'aveu du requérant, elle considère que celui-ci suffit, à lui seul, à établir la réalité des faits. Pour renverser le caractère probant de cet aveu et donner un effet utile à sa rétractation, le requérant devrait établir qu'il n'a pas librement reconnu les faits ou que ceux-ci ne correspondent pas à la réalité.
56 Le requérant ne pourrait contester la validité de son aveu en tirant argument de sa détresse morale à l'époque, dès lors que la requête en autorisation de résidence séparée a été déposée par son épouse le 10 avril 1992, soit près de neuf mois après ledit aveu. De même, il ressortirait de l'attestation produite par le requérant que l'intervention d'un psychiatre a eu lieu en juillet 1992, soit un an après l'aveu. La Commission est d'avis que ni la séparation des époux Daffix, ni le fait que le requérant avait, à la date de l'aveu, un pied dans le plâtre ne peuvent justifier qu'il ait pu reconnaître des fautes qu'il n'aurait pas commises.
57 Elle dément formellement que des pressions aient été exercées sur le requérant au cours de son audition du 22 juillet 1991. Par ailleurs, le requérant n'aurait pas apporté la preuve de l'inexactitude des faits reconnus.
58 La Commission estime que les faits doivent également être considérés comme établis en application des règles relatives à la charge de la preuve.
59 A cet égard, elle note que le requérant n'a jamais contesté avoir reçu la somme de 450 000 BFR. En vertu de l'adage «actori incumbit probatio», et à la lumière de la jurisprudence de la Cour (arrêt de la Cour du 22 mars 1961, Snupat/Haute Autorité, 42/59 et 49/59, Rec. p. 99, 156, dernier attendu), il lui aurait incombé d'apporter la preuve qu'il avait remis cette somme à un tiers. Dès lors qu'il n'avait pas pu fournir une telle preuve, l'AIPN aurait été en droit de considérer que les faits retenus à sa charge étaient établis. La présomption d'innocence, qui impose à l'autorité disciplinaire d'établir la culpabilité de l'intéressé, aurait donc été renversée en l'espèce.
60 Quant aux reçus signés par Régine Lombaerts, la Commission souligne qu'ils n'ont été établis ni sur un papier à en-tête d'une société ou d'une dame Lombaerts, ni sur un papier à en-tête de la Commission. Elle ajoute qu'ils ne sont pas numérotés et ne font référence à aucune facture ou demande de paiement. Par ailleurs, elle soulève la question de savoir comment elle aurait pu faire procéder à une vérification de l'authenticité de la signature de Mme Lombaerts sur ces reçus, puisque l'on ignore toujours l'identité exacte, la fonction et l'adresse de celle-ci.
61 Enfin, la Commission estime que la réalité des faits ressort des faits eux-mêmes. La présomption d'innocence ne s'opposerait pas à ce que l'autorité disciplinaire déduise des faits de l'espèce, ainsi que du caractère contradictoire et inexact des déclarations du requérant, que celui-ci a commis les actes qui lui sont imputés.
62 Elle conclut que la réalité des faits retenus à la charge du requérant était établie et que la sanction disciplinaire infligée par l'AIPN n'est donc pas illégale.
Appréciation du Tribunal
63 Lorsque la réalité des faits retenus à la charge d'un fonctionnaire est établie, le choix de la sanction disciplinaire adéquate appartient à l'AIPN. Le juge communautaire ne saurait substituer son appréciation à celle de cette autorité, sauf en cas d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (voir, à titre d'exemples, arrêts de la Cour du 29 janvier 1985, F./Commission, 228/83, Rec. p. 275, point 34, et du Tribunal du 15 mai 1997, N/Commission, T-273/94, RecFP p. II-289, point 147).
64 Il ressort de cette jurisprudence que toute sanction disciplinaire présuppose que la réalité des faits retenus à la charge du fonctionnaire concerné soit établie.
65 En l'espèce, au vu de son libellé (voir ci-dessus point 25), et tenant compte de l'arrêt de la Cour (voir notamment point 37 de cet arrêt), la décision litigieuse doit être lue en ce sens que l'AIPN a considéré comme établi, premièrement, que le requérant avait falsifié un bon de commande destiné à la société Newscom, laquelle, sur la base de ce bon, ainsi que de deux autres bons, avait ensuite été amenée à lui remettre une somme de 450 000 BFR en liquide, et, deuxièmement, qu'il avait conservé cette somme.
66 Il y a lieu d'examiner si l'AIPN pouvait effectivement considérer ces faits comme établis au moment où elle a pris la décision litigieuse.
- Sur la preuve de la falsification, par le requérant, d'un bon de commande destiné à Newscom, laquelle, sur la base de ce bon, ainsi que de deux autres bons, a été amenée à lui remettre une somme de 450 000 BFR en liquide
67 Le requérant a établi les trois bons de commande en cause (voir deuxième considérant de la décision litigieuse). En effet, il l'a déclaré a plusieurs reprises, notamment lors de son audition du 10 avril 1991, sans jamais le contester par la suite.
68 Il a signé lui-même le premier de ces bons (voir deuxième considérant de la décision litigieuse) et, se servant des trois bons, a obtenu de Newscom le paiement en liquide d'une somme de 450 000 BFR (voir quatrième considérant de la décision litigieuse), ainsi qu'il l'a également reconnu lors de son audition du 10 avril 1991, sans jamais le contester ensuite.
69 En ce qui concerne la question de savoir si le requérant a obtenu des instructions afin d'obtenir le paiement en liquide de Newscom de la somme de 450 000 BFR (voir cinquième considérant de la décision litigieuse), il y a lieu d'observer que les affirmations du requérant selon lesquelles, d'une part, il aurait agi sur proposition de M. M. (voir audition du 14 mai 1992), et, d'autre part, il supposait avoir reçu instruction de M. M. ou de M. Dewael de remettre l'argent à Mme Lombaerts (voir audition du 20 novembre 1992) ne sont pas cohérentes. Par ailleurs, M. Dewael, dont on ignore l'identité, n'était, en tout état de cause, pas un supérieur hiérarchique du requérant ayant le pouvoir de lui donner des instructions. Quant à M. M. et Mme C., supérieurs hiérarchiques du requérant, ils ont toujours nié lui avoir donné les instructions qu'il invoque.
70 Dans ces circonstances, l'AIPN a pu légitimement considérer que le requérant n'avait pas reçu d'instructions à l'effet de percevoir la somme en cause.
71 Par ailleurs, il y a lieu de constater que tant M. M. (lors de son audition du 20 novembre 1992) que Mme C. (lors de son audition du 18 février 1993) ont souligné que la numération des bons de commande utilisés pour obtenir la remise de la somme de 450 000 BFR par Newscom n'était pas correcte.
72 Quant à la critique du requérant selon laquelle la Commission n'a jamais procédé à une analyse de la signature de M. M. sur les deuxième et troisième bons de commande, il suffit, pour l'écarter comme inopérante, de constater que les faits retenus à charge par l'AIPN ne comprenaient pas la falsification de ces deux bons de commande (voir ci-dessus point 65).
73 Dans ces conditions, l'AIPN était fondée à considérer que le requérant avait falsifié un bon de commande destiné à la société Newscom, laquelle, sur présentation de ce bon, ainsi que de deux autres bons, avait été amenée à lui remettre une somme de 450 000 BFR en liquide.
- Sur la preuve de la conservation par le requérant de la somme qu'il avait reçue de Newscom
74 Le requérant a admis lors de l'audition du 10 avril 1991 avoir reçu la somme de 450 000 BFR de Newscom, «au nom et pour compte de la Commission». Cette somme n'a donné lieu à aucune prestation en faveur de la Commission. En effet, le requérant admet lui-même dans sa réplique que, dans le cas contraire, cette affaire «n'aurait jamais existé».
75 Ces faits ayant été démontrés, l'AIPN pouvait, en l'absence d'une justification valable, considérer que le requérant avait conservé l'argent de la Commission.
76 En appliquant ce raisonnement, l'AIPN n'a pas méconnu le principe de la présomption d'innocence. En effet, si, au début de la procédure disciplinaire, elle devait présumer que le requérant était innocent, elle a pu légalement se départir de cette présomption après établissement des faits susvisés.
77 A l'effet de démontrer qu'il n'a pas conservé l'argent, le requérant ne peut se contenter d'affirmer qu'il l'a remis à une tierce personne, à savoir une dame Régine Lombaerts.
78 Il y a d'abord lieu de constater que ses déclarations sur ce point ont été divergentes et souvent contradictoires, plus particulièrement en ce qui concerne l'activité de Mme Lombaerts, la localisation de ses bureaux et l'endroit où le requérant lui aurait remis l'argent.
79 Il convient ensuite d'observer que plusieurs recherches effectuées par la Commission pour retrouver Mme Lombaerts sont restées infructueuses. A cet égard, le requérant ne peut soutenir que la Commission n'a pas mené utilement ces recherches. En effet, ses indications quant à l'identité, à la fonction et à l'adresse de Mme Lombaerts étaient tellement vagues et contradictoires que l'on ne pouvait exiger de la Commission qu'elle fît encore plus d'efforts pour retrouver cette personne.
80 Le requérant ne saurait davantage prétendre que l'AIPN ne pouvait pas l'accuser d'avoir conservé le montant inscrit sur les trois reçus tout en reconnaissant l'authenticité de ceux-ci. D'une part, l'AIPN n'a jamais reconnu, ni explicitement ni implicitement, l'authenticité desdits reçus. D'autre part, elle ne disposait d'aucune autre écriture attribuée à Mme Lombaerts, de sorte qu'il lui était impossible de faire vérifier par un expert en écritures si la signature apposée sur les reçus était celle de Régine Lombaerts ou d'une autre personne.
81 En toute hypothèse, les reçus ne pouvaient être considérés comme crédibles, dès lors qu'ils n'avaient été établis ni sur du papier à en-tête d'une société ou d'une dame Lombaerts, ni sur du papier à en-tête de la Commission et que, en outre, ils n'étaient pas numérotés et ne faisaient référence à aucune facture ou demande de paiement. En ce qui concerne plus particulièrement le dernier reçu, sa valeur probante était éminemment douteuse, dans la mesure où il était censé démontrer que le requérant avait remis à Régine Lombaerts, le 2 juillet 1990, une somme de 185 000 BFR qu'il n'aurait lui-même reçue de Newscom que le 4 juillet 1990.
82 Dans ces circonstances, l'AIPN a pu légitimement estimer que les reçus signés «Régine Lombaerts» ne constituaient pas des éléments à décharge.
83 Il ressort de ce qui précède qu'elle était fondée à considérer que le requérant avait conservé la somme qu'il avait reçue de Newscom.
84 Sans qu'il soit besoin d'apprécier la valeur probante de l'aveu du requérant - aveu qui, selon la décision litigieuse elle-même, ne faisait que corroborer la conclusion de l'AIPN selon laquelle le requérant était coupable des faits retenus contre lui -, il y a lieu de conclure que l'AIPN a pu légalement considérer que les faits reprochés au requérant étaient établis.
85 Il s'ensuit que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré d'un abus du pouvoir discrétionnaire et d'une erreur manifeste d'appréciation
Arguments des parties
86 Le requérant rappelle, en ce qui concerne la sanction adéquate, que, en cas d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir, le juge communautaire doit substituer sa propre appréciation à celle de l'AIPN (arrêt du 5 février 1987, F./Commission, précité, point 18).
87 Il fait remarquer que la révocation est la sanction la plus lourde visée par le statut. En lui infligeant cette sanction, l'AIPN aurait abusé de son pouvoir discrétionnaire et commis une erreur manifeste d'appréciation. Il souligne avoir travaillé pendant plus de 23 ans pour la Commission et que, durant cette période, ses rapports de notation ont toujours été très bons ou excellents. En outre, aucun passé disciplinaire n'aurait pu lui être reproché.
88 La Commission fait valoir qu'il ne saurait lui être reproché ni un abus du pouvoir discrétionnaire, ni une erreur manifeste d'appréciation. En particulier, l'AIPN aurait pu à juste titre considérer, en raison de la gravité des faits, que l'ancienneté du requérant au sein de la Commission et ses états de service n'étaient pas susceptibles de l'amener à prendre une sanction autre que celle de la révocation.
Appréciation du Tribunal
89 Il y a lieu d'observer que le régime disciplinaire mis en place par le statut n'établit pas un rapport fixe entre la sanction et le manquement commis (arrêts du Tribunal du 26 janvier 1995, D/Commission, T-549/93, RecFP p. II-43, point 98, et du 7 mars 1996, Williams/Cour des comptes, T-146/94, RecFP p. II-329, point 107).
90 En l'espèce, il apparaît que, eu égard à la gravité des faits retenus, la sanction infligée par l'AIPN au requérant n'était pas disproportionnée et n'était pas de nature à démontrer que l'AIPN avait abusé de son pouvoir discrétionnaire ou commis une erreur manifeste d'appréciation.
91 Il est utile de rappeler à ce propos que, dans la décision litigieuse, l'AIPN a souligné:
«[...] les faits reprochés à M. Daffix constituent un manquement extrêmement grave à ses obligations, qui, en effet, mettent en cause les bases mêmes des relations de confiance qui doivent exister entre l'institution et chacun des membres de son personnel [...]»
92 Il doit être admis qu'il s'agit là d'une appréciation pertinente, qui justifiait le prononcé d'une révocation.
93 Par ailleurs, s'il est vrai que, en statuant sur la sanction adéquate, l'AIPN doit prendre en considération l'ancienneté du fonctionnaire au sein de la Commission et ses états de service, il ne ressort pas des éléments du dossier que, dans le cas d'espèce, l'AIPN ait commis une erreur manifeste d'appréciation en infligeant au requérant la sanction de la révocation.
94 Enfin, le requérant n'a pas démontré l'existence d'indices objectifs, pertinents et concordants de nature à établir que la décision litigieuse a été adoptée à des fins autres que la sanction du manquement dont il s'est rendu coupable, comme le requiert la jurisprudence pour établir, dans un cas comme celui de l'espèce, un détournement de pouvoir dans le chef de l'AIPN (arrêts du Tribunal du 12 juillet 1990, Scheuer/Commission, T-108/89, Rec. p. II-411, points 49 et 50, et D/Commission, précité, point 88).
95 Dans ces conditions, le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré d'une violation des droits de la défense
96 Le troisième moyen soulevé par le requérant s'articule en deux branches, tirées respectivement d'une méconnaissance du devoir d'instruction de la Commission et d'une violation du droit d'être entendu.
Sur la première branche du moyen, tirée d'une méconnaissance du devoir d'instruction
- Arguments des parties
97 Le requérant fait grief à la Commission de ne pas avoir entendu M. De Valck, producteur de Cobra-films. Or, son témoignage aurait été important, puisqu'il aurait pu confirmer l'existence de Mme Lombaerts et préciser si son budget pour le projet «Musiques du cinéma européen» présentait un «trou» de 450 000 BFR, ce qui aurait justifié les demandes d'avances. Bien que M. De Valck ait finalement été entendu, son témoignage n'aurait pas de valeur probante. En effet, le requérant n'aurait pas eu l'occasion de l'interroger, alors qu'une confrontation directe avec lui aurait constitué une étape importante dans l'instruction du dossier.
98 Le requérant souligne également que la comptabilité de Cobra-films n'a pas été examinée.
99 Enfin, il critique l'absence de M. M. aux réunions du groupe interservice, estimant qu'une confrontation directe entre lui-même et M. M. aurait été, à nouveau, déterminante.
100 La Commission fait observer que le requérant n'a pas demandé l'audition de M. De Valck par le conseil de discipline. Selon elle, le défaut de demande d'une audition signifierait que le requérant avait renoncé, au moins implicitement, à en tirer argument pour contester la régularité de la procédure administrative. Par ailleurs, l'absence d'audition de M. De Valck par le conseil de discipline ne ferait pas grief au requérant, dès lors que ce conseil a estimé qu'il n'était pas établi que le requérant avait conservé l'argent. En tout état de cause, le témoignage ultérieur de M. De Valck se serait avéré accablant pour le requérant, de sorte que, devant le conseil de discipline, il n'aurait pu que le desservir.
101 La Commission fait valoir qu'elle n'a pas les pouvoirs requis pour examiner la comptabilité de Cobra-films. Au demeurant, cet examen aurait été superflu, notamment en raison des déclarations faites par M. De Valck lors de son audition.
102 Le grief du requérant selon lequel il n'a pas été confronté à M. M. serait irrecevable, puisque ce grief n'a été soulevé ni devant le conseil de discipline ni dans la réclamation. En toute hypothèse, la Commission fait valoir que les comptes rendus des différentes auditions, notamment de celle de M. M., ont été versés au dossier et que le requérant aurait pu, s'il l'avait voulu, en prendre connaissance en temps utile et faire valoir ses observations éventuelles.
- Appréciation du Tribunal
103 Aux termes de l'article 4 de l'annexe IX du statut, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, le fonctionnaire incriminé a le droit de citer des témoins devant le conseil de disciplinaire. Il appartient à ce conseil d'apprécier la pertinence des témoignages proposés par rapport à l'objet du litige et la nécessité de procéder à l'audition des témoins cités (arrêts de la Cour du 11 juillet 1968, Van Eick/Commission, 35/67, Rec. p. 481, 501, et du Tribunal du 28 juin 1996, Y/Cour de justice, T-500/93, RecFP p. II-977, point 43).
104 Toutefois, pour exercer son droit de citer des témoins, le fonctionnaire incriminé doit demander que la personne de son choix soit appelée à témoigner. A défaut d'une demande en ce sens, l'intéressé ne saurait invoquer ensuite le fait qu'il n'y a pas eu d'audition d'une personne dont il aurait souhaité qu'elle fût entendue (voir, dans le même sens, arrêt N/Commission, précité, point 88).
105 En l'espèce, le dossier ne révèle pas que le requérant ait demandé l'audition de M. De Valk au cours de la procédure disciplinaire et notamment devant le conseil de discipline. Plus particulièrement, les comptes rendus des auditions devant le conseil de discipline ne relatent aucune demande du requérant sur ce point.
106 En tout état de cause, comme la Commission l'a observé à juste titre, lorsque M. De Valck a finalement été entendu par le groupe interservice, après l'achèvement de la procédure disciplinaire, son témoignage s'est avéré accablant pour le requérant.
107 Dans ces conditions, le grief du requérant concernant l'absence d'audition de M. De Valck au cours de la procédure disciplinaire n'est pas fondé.
108 S'agissant du grief tiré de ce que la Commission aurait dû procéder à un examen de la comptabilité de Cobra-films, il suffit d'observer que le requérant n'a présenté une demande en ce sens que très tard au cours de la procédure et que, ainsi que la Commission l'a fait valoir à juste titre, un examen de la compatibilité de Cobra-films n'aurait eu aucun sens à la suite des déclarations faites par M. De Valck lors de son audition.
109 Quant au grief tiré de l'absence de M. M. aux réunions du groupe interservice, il y a lieu de constater que la consultation de ce groupe ne fait pas partie de la procédure disciplinaire susceptible d'aboutir à une sanction disciplinaire (voir annexe IX du statut). Par ailleurs, le groupe interservice n'est intervenu qu'après l'achèvement de la procédure disciplinaire et l'adoption de la décision sur la sanction adéquate. Dans ces conditions, une éventuelle irrégularité en ce qui concerne sa consultation ne pourrait pas avoir d'incidence sur la régularité et la validité de la procédure disciplinaire elle-même. Il s'ensuit que le grief est inopérant.
110 Dans ces circonstances, la première branche du troisième moyen doit être rejetée.
Sur la seconde branche du moyen, tirée d'une violation du droit d'être entendu
- Arguments des parties
111 Le requérant fait valoir que ni lui-même ni son conseil de l'époque, qui n'avait pas d'expérience en matière de fonction publique, n'avaient connaissance du déroulement d'une procédure disciplinaire. Dans ce contexte, ils auraient été persuadés qu'ils disposeraient d'un temps de parole avant la fin des réunions du conseil de discipline pour plaider et réinterroger les témoins, alors que cela ne correspond pas à la pratique. Le requérant n'aurait donc pas pu présenter utilement sa défense, ce qui constituerait une violation de ses droits de la défense.
112 Dans sa réplique, le requérant invoque par ailleurs une violation du devoir de sollicitude incombant à la Commission.
113 La Commission relève que les fonctionnaires et leurs conseils sont censés connaître le statut. En l'espèce, il ne serait pas démontré que le requérant et son conseil ignoraient le fonctionnement de la procédure disciplinaire. En tout cas, l'AIPN aurait raisonnablement pu supposer que les droits du requérant étaient sauvegardés, dès lors qu'il était assisté d'un avocat.
114 La Commission estime que le requérant a eu l'occasion de présenter utilement ses moyens de défense et de contredire les différents témoignages. Elle souligne notamment que le requérant a formulé des observations dans sa lettre du 4 mars 1993 et que l'AIPN l'a invité à prendre la parole lors de sa dernière audition par celle-ci.
115 Dans sa duplique, la Commission rétorque, en ce qui concerne la violation alléguée de son devoir de sollicitude, qu'il s'agit d'un moyen nouveau, qui, n'ayant pas été invoqué lors de la phase précontentieuse ni même dans la requête, est irrecevable (arrêt de la Cour du 20 mai 1987, Geist/Commission, 242/85, Rec. p. 2181, point 9). Au demeurant, le requérant n'aurait pas avancé d'élément précis à l'appui de son grief, de sorte que la Commission ne serait pas en mesure d'y répondre. Pour cette raison également, ledit grief serait irrecevable.
- Appréciation du Tribunal
116 Il ressort de la jurisprudence que les fonctionnaires sont censés connaître le statut (arrêts de la Cour du 17 janvier 1989, Stempels/Commission, 310/87, Rec. p. 43, point 10, et du Tribunal du 1er février 1996, Chabert/Commission, T-122/95, RecFP p. II-63, point 32). Le déroulement de la procédure disciplinaire fait l'objet de l'annexe IX du statut, laquelle fait partie intégrante du statut. Les fonctionnaires sont donc également censés connaître le déroulement de la procédure disciplinaire.
117 Par conséquent, la Commission pouvait légalement supposer que le requérant connaissait le déroulement de la procédure disciplinaire. Dès lors, celui-ci ne saurait tirer argument de sa prétendue ignorance à cet égard.
118 Ce raisonnement vaut d'autant plus que le requérant était assisté d'un avocat à partir de la deuxième audition devant le conseil de discipline. Il est en effet légitime de supposer que l'avocat choisi par un fonctionnaire pour l'assister lors d'une procédure disciplinaire connaît le statut ou, en tout état de cause, les règles régissant le déroulement de la procédure disciplinaire. Le requérant ne saurait donc reprocher à la Commission de n'avoir pas pu utilement se défendre au motif que l'avocat qu'il avait choisi n'était pas compétent en la matière.
119 De surcroît, il convient de constater que, au cours de l'ensemble de la procédure disciplinaire, le requérant a été en mesure de faire connaître utilement son point de vue. En effet, il a été entendu à plusieurs reprises, a également formulé ses observations par écrit et a pu se défendre contre tous les griefs retenus contre lui.
120 S'agissant du grief tiré d'une violation du devoir de sollicitude, il y a lieu d'observer que, selon une jurisprudence bien établie, les conclusions des recours de fonctionnaires doivent avoir le même objet que celui de la réclamation administrative préalable et contenir des chefs de conclusions reposant sur la même cause que celle de la réclamation (voir, à titre d'exemples, arrêts du Tribunal du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T-57/89, Rec. p. II-143, point 9, et du 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T-118/95, RecFP p. II-835, point 43).
121 Or, dans la présente espèce, ni la réclamation ni même la requête ne se réfèrent à une violation du devoir de sollicitude. Dans ces circonstances, le grief tiré d'une violation du devoir de sollicitude doit être déclaré irrecevable.
122 Il s'ensuit que la seconde branche du troisième moyen doit être rejetée.
123 Partant, le troisième moyen doit être rejeté dans son ensemble.
Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation de l'article 7 de l'annexe IX du statut
Arguments des parties
124 Le requérant fait remarquer que, selon l'article 7 de l'annexe IX du statut, le conseil de discipline doit rendre son avis motivé dans un délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai étant porté à trois mois lorsque le conseil a fait procéder à une enquête.
125 Or, en l'espèce, un délai d'un an se serait écoulé entre la date de saisine du conseil de discipline (20 février 1992) et la date à laquelle celui-ci a rendu son avis (18 février 1993). Le requérant fait valoir que ses absences de son lieu de travail n'ont pas pu avoir d'incidence sur le cours normal du traitement de son dossier par le conseil de discipline, dès lors que deux des trois réunions du conseil de discipline se sont tenues, en sa présence, à des dates auxquelles il était absent de la Commission.
126 Tout en admettant que les délais inscrits à l'annexe IX du statut ne présentent pas un caractère impératif, il estime qu'une saine administration de la justice disciplinaire suppose que les affaires disciplinaires soient traitées dans des délais raisonnables. Considérant qu'un délai d'un an n'est pas un délai raisonnable, il fait valoir qu'il y a eu violation de l'article 7 de l'annexe IX du statut, de nature à entraîner l'annulation de la décision litigieuse.
127 La Commission renvoie à la jurisprudence de la Cour, selon laquelle le délai prévu à l'article 7 de l'annexe IX du statut ne présente pas un caractère impératif et n'est pas sanctionné par la nullité des actes pris après son expiration (arrêt de la Cour du 4 février 1970, Van Eick/Commission, 13/69, Rec. p. 3, points 3 et 7).
128 En outre, en l'espèce, le retard incriminé serait en grande partie imputable au requérant, qui a été absent de son travail, notamment pour cause de maladie, pendant près de cinq mois. Au demeurant, le délai utilisé par le conseil de discipline pour rendre son avis s'expliquerait par les nécessités de l'instruction, résultant du caractère contradictoire des déclarations successives du requérant.
Appréciation du Tribunal
129 Aux termes de l'article 7, premier alinéa, de l'annexe IX du statut, le conseil de discipline transmet son avis à l'AIPN «dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi. Le délai est porté à trois mois lorsque le conseil a fait procéder à une enquête».
130 Il ressort de la jurisprudence que les délais prévus à l'article 7 de l'annexe IX du statut, et notamment celui dans lequel le conseil de discipline doit émettre son avis, ne sont pas péremptoires, mais constituent des règles de bonne administration dont le but est d'éviter, dans l'intérêt tant de l'administration que des fonctionnaires, un retard injustifié dans l'adoption de la décision qui met fin à la procédure disciplinaire. Il en découle que les autorités disciplinaires ont l'obligation de mener avec diligence la procédure disciplinaire et d'agir de sorte que chaque acte de poursuite intervienne dans un délai raisonnable par rapport à l'acte précédent. La non-observation de ce délai - qui ne peut être appréciée qu'en fonction des circonstances particulières de l'affaire - peut non seulement engager la responsabilité de l'institution, mais est également susceptible d'entraîner la nullité de l'acte pris hors délai (arrêt de Compte/Parlement, précité, point 88).
131 Le conseil de discipline peut avoir besoin d'un délai plus long que celui prescrit à l'article 7 pour procéder à une enquête suffisamment complète et présentant pour l'intéressé toutes les garanties voulues par le statut (arrêts de la Cour du 29 janvier 1985, F./Commission, précité, point 30, et du Tribunal du 26 novembre 1991, Williams/Cour des comptes, T-146/89, Rec. p. II-1293, point 49).
132 En l'espèce, le conseil de discipline a été saisi le 20 février 1992 et a rendu son avis le 18 février 1993. Pendant cette période de presque un an, il a tenu quatre réunions à trois dates différentes, les 14 mai 1992, 20 novembre 1992 et 18 février 1993. Lors de ces réunions, le conseil a entendu deux fois le requérant (les 14 mai et 20 novembre 1992) et a entendu trois témoins: M. M. (le 20 novembre 1992), Mme C. (le 18 février 1993) et M. R. (également le 18 février 1993). En outre, le 2 décembre 1992, le conseil de discipline a entamé une enquête supplémentaire afin de recueillir de plus amples informations.
133 Les délais ainsi écoulés entre les différents actes du conseil de discipline n'ont pas été déraisonnables. Étant confronté à un dossier complexe au plan des faits, en raison notamment des déclarations contradictoires du requérant, le conseil de discipline a instruit l'affaire d'une façon intensive et complète. Dans ces conditions, l'article 7, premier alinéa, de l'annexe IX du statut n'a pas été violé.
134 Il en résulte que le quatrième moyen doit également être rejeté. 135 Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
136 L'arrêt du Tribunal du 28 mars 1995, qui avait condamné la Commission aux dépens, a été annulé. Dans son arrêt sur pourvoi, la Cour a réservé les dépens. Il appartient donc au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur tous les dépens afférents aux différentes étapes de la procédure.
137 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.
138 Par conséquent, chaque partie devra supporter ses propres dépens
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
(troisième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera la totalité de ses propres dépens afférents aux procédures devant le Tribunal et la Cour
Related cases
Select a keyword to display the most cited other cases
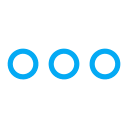
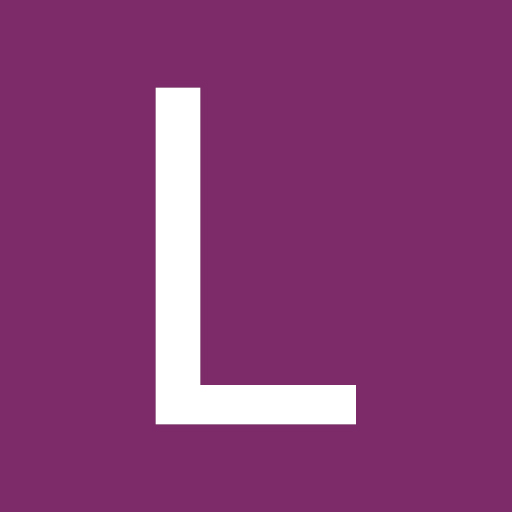
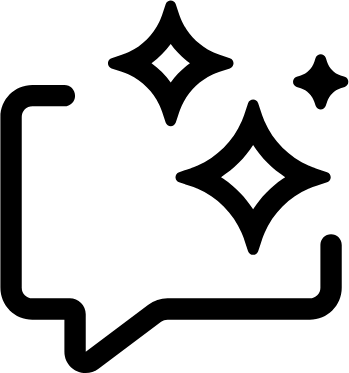 LEXI - AI Legal Assistant
LEXI - AI Legal Assistant